| |
| |
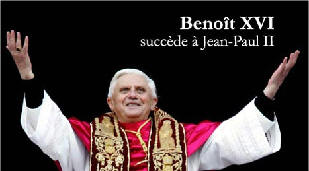
 du 2 septembre 2005 du 2 septembre 2005
Rome
Benoît XVI encourage le premier « parlement
universitaire » latino-américain
La voix de Joseph Ratzinger: droits d’auteurs à Radio
Vatican
1506-2006 : 500 ans de présence suisse au Vatican
« Les miracles de Jean-Paul II », publication
International
Irak: Une violence planifiée et perverse, analyse Mgr
Sleiman
France: La question du statut de « l'être prénatal »
Diocèse de Paris: Les activités pour les jeunes dans le
« Guide jeunes », gratuit!
Chine: Décès d’Allen Yuan, 92
ans, pasteur protestant de Pékin
|
|
 |
|
|
| |
|
Rome
Benoît XVI
encourage le premier « parlement universitaire » latino-américain
Pour la recherche du bien commun et la communion
ROME, Jeudi 1 septembre 2005 (ZENIT.org)
– Le pape Benoît XVI encourage les étudiants du premier « parlement
universitaire » latino-américain à la recherche sincère du bien dans
un esprit de communion, à la lumière de l’Evangile et des valeurs
humaines authentiques.
Le pape a en effet adressé un message à Mgr Alfredo Zecca, recteur
de l'Université catholique argentine (UCA), qui accueille les
étudiants participant au premier Parlement universitaire
latino-américain, qui s’est tenu à Buenos Aires du 31 août au 2
septembre.
Parmi les thématiques abordées: l’intégration entre les différents
pays, la démocratie, le développement, la promotion de la famille,
la formation aux responsabilités politiques, le trafic des
stupéfiants, la promotion de la jeunesse.
L’initiative a eu le soutien de l’archevêque de Buenos Aires, grand
chancelier de l’université, le cardinal Jorge Bergoglio, et des
présidents des commissions épiscopales du monde universitaire et
pour les laïcs.
ZF05090201
TOP
La voix de Joseph
Ratzinger: droits d’auteurs à Radio Vatican
ROME, Vendredi 2 septembre 2005 (ZENIT.org)
– Les droits d’auteurs de la voix de Joseph Ratzinger, y compris
avant son élection au siège de Pierre iront à Radio Vatican, indique
un communiqué de la salle de presse du Saint-Siège.
« Benoît XVI a confié à Radio Vatican l’exercice et la protection
des droits d’auteurs et de propriété intellectuelle aussi sur tous
les enregistrements sonores de sa voix remontant à la période
antécédente à son élévation à la chaire de Pierre, les droits
légitimement acquis par des tiers restant saufs ».
En tant que radio du Saint-Siège, Radio Vatican, précise la note, «
en vertu de son statut (art. 15), a pour tâche de constituer, de
garder et gérer les archives sonores du Saint-Père, en en assurant
la sauvegarde, et en ayant soin, en exclusivité, sous tous leurs
aspects, les droits d’auteur et de propriété intellectuelle relatifs
».
ZF05090202
TOP
1506-2006 : 500
ans de présence suisse au Vatican
Les événements du Jubilé de la Garde Suisse
pontificale
ROME, Jeudi 1 septembre 2005 (ZENIT.org)
– L’année 2006 sera l’année des 500 ans de la Garde suisse
pontificale. Le site de la garde présente les événements de ce
jubilé exceptionnel, à commencer, les 24 et 25 septembre 2005, par
des manifestations organisées à Lucerne pour célébrer le départ du
premier contingent (cf.
http://212.77.1.245/roman_curia/swiss_guard/index_fr.htm).
La petite armée de l’Etat de la Cité du Vatican compte 110 recrues
suisses, de religion catholique.
Le site rappelle que la Garde a été fondée par le pape Jules II
della Rovere.
Durant le sac de Rome par les lansquenets de Charles Quint, le 6 mai
1527, ce sont 147 des 189 gardes qui seront massacrés pour défendre
la vie du pape Clément VII qui pourra se réfugier au Château
Saint-Ange par le fameux « passetto ». Parmi les victimes, on compte
de nombreux ressortissants de la ville de Zurich.
Le 6 mai est aujourd’hui la journée commémorative annuelle durant
laquelle les nouvelles recrues prêtent serment.
En 1970, lorsque le pape Paul VI a aboli tous les corps militaires
pontificaux, seule la Garde suisse est restée en service.
L’uniforme des gardes est attribué de façon erronée à Michel Ange,
car il a été dessiné par le commandant Jules Repond (1910-1921) qui
s’est inspiré des fresques de Raphaël.
Lucerne va célébrer le départ du premier contingent. En effet, dans
une lettre datée du 21 juin 1505, le pape Jules II demande à la
Diète helvétique de lui fournir d'urgence un contingent de 200
hommes pour assurer sa garde personnelle. Le recrutement commence à
la fin du mois d'octobre 1505, principalement dans les cantons de
Lucerne et de Zurich.
Un premier contingent de 150 hommes part en plein hiver, empruntant
le col du Saint-Gothard. Il fait son entrée à Rome le 22 janvier
1506 et prend immédiatement son service. Dès lors, ce jour est
considéré comme la date officielle de la création de la Garde Suisse
Pontificale.
ZF05090203
TOP
« Les miracles de
Jean-Paul II », publication
Un livre de Andrea Tornielli
ROME, Vendredi 2 septembre 2005 (ZENIT.org)
– L’historien italien Andrea Tornielli raconte dans un livre les «
Les miracles de Jean-Paul II » (« I miracoli di Papa Wojtyla », éd.
Piemme, 135 pages, 12,90 euro).
On se souvient que lors des funérailles du pape Jean-Paul II, le 8
avril dernier, la foule avait scandé « Santo Subito »: une
acclamation renouvelée le 28 juin dernier, en la basilique
Saint-Jean du Latran lors de l’ouverture de sa cause de
béatification.
Andrea Tornielli a précisé à Zenit qu’il préfère parler de « grâces
» reçues – le titre ayant été choisi par l’éditeur – parce que,
dit-il, « il n’est pas possible d’affirmer qu’il s’agit de miracles
» comme c’est le cas une fois que la congrégation pour les causes
des saints s’est prononcée.
Il s’agit d’un recueil de « témoignages » qui se sont fait connaître
dès la nouvelle du décès du pape Wojtyla. Dans certains cas, ces
récits étaient déjà connus de l’auteur, mais sous réserve de ne rien
publier du vivant du pape.
Dans la plupart des cas, ce sont des témoins oculaires: les
personnes bénéficiaires elles-mêmes ou leurs parents.
« Pour un cas, celui du Juif américain guéri en recevant la
communion des mains du pape, le témoin est Mgr Stanislas Dziwisz »,
précise Tornielli.
Mais l’auteur se défend d’avoir voulu « accélérer » le procès de
béatification. « J’ai précisé dès le début, dit-il à Zenit, que mon
travail n’entend pas interférer avec le procès de béatification. Il
s’agit avant tout de grâces survenues alors que le pape Wojtyla
était encore en vie et donc, pour cela, inutilisables pour le
procès, qui ne prend en considération que les éventuels miracles
survenus par l’intercession du Serviteur de Dieu après sa mort ».
D’autre part, en recueillant ces témoignages, l’auteur insiste que
le fait qu’il « n’a pas voulu non plus anticiper le jugement de
l’Eglise sur la sainteté de Jean-Paul II, mais plutôt faire voir
combien de fois autour du pape et grâce à sa prière des personnes
ont reçu des grâces ». « J’ai voulu, dit-il, écrire un chapitre à la
fin du livre racontant des épisodes semblables qui sont arrivés à
d’autres papes en odeur de sainteté ».
Pour ce qui est de la connaissance que Jean-Paul II a pu avoir de
ces événements, Andrea Tornielli est affirmatif: « Il en était
conscient parce que parfois il se rendait compte que quelque chose
se passait, d’autres fois parce que les personnes lui en faisaient
part immédiatement, et le remerciaient. Mais toujours, il exigeait
qu’on n’en parle pas, qu’on se taise. Et surtout, il tenait à
souligner que les miracles et les grâces c’était le Seigneur qui les
faisaient, pas le pape! Lui, il ne faisait que prier pour que les
demandes des personnes souffrantes soient exaucées ».
Mais pour Andrea Tornielli, il ne faudrait pas réduire l’influence
du pape Jean-Paul II à ces événements, il souligne non seulement son
rôle dans l’écroulement du Mur de Berlin, mais aussi des gestes «
prophétiques » comme sa visite à la mosquée de Damas en mai 2001 «
quelques mois avant le 11 septembre »: « C’était comme s’il
indiquait à l’avance le chemin à suivre ».
ZF05090204
TOP
|
|
|
 |
|
|
| |
International
Irak: Une
violence planifiée et perverse, analyse Mgr Sleiman
Le quotidien tragique de cette situation
ROME, Vendredi 2 septembre 2005 (ZENIT.org)
– Une violence « planifiée » frappe l’Irak, la « confusion »
actuelle du pays est marquée par le retour du « tribalisme » et
du « fatalisme », et le quotidien est « tragique », affirme
aujourd’hui Mgr Jean-Benjamin Sleiman, ocd, évêque latin de
Bagdad au micro de Radio Vatican.
L’Irak vit trois jours de deuil, décrétés à la suite de la mort
de plus de mille personnes à Bagdad, lors d’une bousculade
mortelle qui a eu lieu le 31 août, à l’occasion d’une procession
religieuse chiite, au pont al Aimah sur le Tigre. Mais les
bombes ne se taisent pas pour autant et les affrontements armés
ne cessent pas non plus. A Bassorah les chiites sont descendus
dans la rue pour manifester leur soutien au projet de
constitution qui devra être soumis à un referendum dans un mois
et demi, le 15 octobre prochain.
« Substantiellement, a déclaré l’évêque, depuis la fin de la
guerre et jusqu’à aujourd’hui, nous sommes dans une grande
confusion. Nous sommes dans un pays vraiment sans règles. Sont
réapparues, très fortes, des réalités que l’on croyait mortes,
comme le tribalisme, le fatalisme. Ce sont vraiment des réalités
fortes aujourd’hui. Nous sommes donc encore dans une grande
confusion, mais la parole confusion n’exprime peut-être pas le
quotidien tragique de cette situation. La confusion, en effet,
est alimentée par une violence, je ne voudrais pas dire «
aveugle », parce qu’elle semble au contraire bien planifiée et
donc perverse ».
Pour ce qui est du risque d’une guerre civile, Mgr Sleiman
répond: « J’espère que non. Qu’il y ait des risques,
certainement, ils sont sérieux, mais je pense que de nombreux
responsables sont au courant de cela et sont en train de faire
tout leur possible pour éviter une guerre civile ».
En ce qui concerne la résolution de la division entre sunnites
et chiites, Mgr Sleiman fait remarquer que « jusqu’ici, on s’est
mis en route pour résoudre ces problèmes profonds, historiques.
La situation actuelle a aussi sa nouveauté. Tant de conflits
sont vraiment enracinés dans une culture et une histoire assez
conflictuelle et violente. Pour assainir tout cela, il faut un
effort supplémentaire, pour aider cette population à se
réconcilier avec elle-même, avec son passé, avec ses problèmes,
à encourager une nouvelle culture et une nouvelle mentalité ».
Enfin, pour ce qui est du chemin de la démocratie, Mgr Sleiman
déclare: « Elle peut arriver vite ou ne jamais arriver. Je pense
que le problème de la démocratie est un problème qui va au-delà
d’un texte constitutionnel, qui va au-delà du scrutin lui-même.
La démocratie est l’expression politique d’une philosophie,
d’une anthropologie, d’une culture et je pense qu’il faudra
faire encore beaucoup d’efforts. Ce sont des difficultés qui ne
sont pas visibles, mais réelles, en plus du problème politique:
il y a ceux qui ne veulent pas la démocratie, non pour la
démocratie en tant que telle, mais parce que ce sont les autres
qui sont en train de la construire. Donc il y a aussi des
conflits politiques internes, internationaux, en superficie,
mais l’arrière-fond social anthropologique est vraiment à
réviser ».
ZF05090205
TOP
France: La
question du statut de « l'être prénatal »
Après une macabre découverte
ROME, Vendredi 2 septembre 2005 (ZENIT.org)
– A la suite de la découverte de l'existence de 351 corps de
fœtus ou enfants mort-nés, à l'hôpital Saint Vincent de Paul, à
Paris (cf. revue de presse du mois d'août), le professeur Claude
Sureau, ancien président de l'Académie nationale de médecine et
membre du Comité consultatif national d'éthique pose la question
du statut de « l'être prénatal », annonce « Gènéthique », la
revue de presse de la Fondation Jérôme Lejeune (genethique.org).
Selon lui les remous autour de cette affaire ont été
disproportionnés. Les politiques devraient plutôt s'attacher « à
la reconnaissance d'un statut spécifique pour l'être prénatal à
partir de la viabilité. Depuis le droit romain, le monde
juridique considère deux catégories du droit : les personnes et
les choses. Qu'en est-il de l'embryon? Il n'est pas considéré
comme sujet de droit ni comme objet de droit : il n'est rien.
Nous devons sortir de cette conception binaire », explique t-il.
Il reconnaît que les parlementaires n'osent pas donner un statut
à l'embryon « de peur de remettre en cause le droit à
l'interruption volontaire de grossesse ». « Mais cela n'a rien à
voir » conclut-il.
ZF05090206
TOP
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Diocèse de Paris: Les
activités pour les jeunes
dans le « Guide jeunes »,
gratuit!
« Autant
d’invitations à découvrir
une Église qui vit »
ROME, Jeudi 1 septembre 2005
(ZENIT.org)
– L’Eglise catholique de
Paris lance un « Guide
jeunes 2005 » de 52 pages,
illustrant toutes les
activités pour la jeunesse à
Paris.
Il est possible de consulter
le Guide Jeunes en version «
pdf » en ligne, à l’adresse
suivante :
http://catholique-paris.cef.fr/jeunes/guide/guideintro.htm.
« Toutes les propositions
qui jalonnent ces pages sont
autant d’invitations à
découvrir une Église qui
vit, et qui, à l’image de
son Dieu, est toujours une
Église jeune », souligne
pour sa part Mgr André
Vingt-Trois, archevêque de
Paris.
Ce guide gratuit sera
diffusé à 200 000
exemplaires, pendant ce mois
de septembre dans les
paroisses, les aumôneries,
les établissements de
l'enseignement catholique à
Paris.
« Les parents aspirent à
trouver des projets adaptés
pour permettre à leurs
enfants de s’épanouir. Mais
beaucoup ignorent encore
l’aide que l’Eglise peut
leur apporter dans leur rôle
d’éducateurs. C’est pourquoi
le diocèse de Paris a décidé
d’éditer un guide pour
présenter l’ensemble des
projets », indique un
communiqué du diocèse (http://www.catholique-paris.com).
Après l’accueil des enfants
pour le catéchisme, puis
l’aumônerie, et la
préparation aux sacrements
du baptême, de
l’eucharistie, et de la
confirmation, l’Église
invite les jeunes à
participer à des activités
variées : sports et loisirs,
rencontres à thème, groupes
de prière et de réflexion,
rassemblements et
pèlerinages.
En outre, de nombreux
mouvements de jeunes sont
liés à l’Église catholique
propose aussi des activités
très diversifiées.
Enfin, l’Eglise offre des
possibilités d’engagement et
de service : chorale,
encadrement des plus jeunes,
service aux personnes âgées,
seules ou démunies.
Mgr Vingt-Trois explique
encore : « À Paris pour la
Toussaint 2004, une grande
croix était dressée sur le
parvis de la cathédrale
Notre-Dame, au cœur de la
cité. Recouverte de feuilles
et de fleurs, elle fut, pour
ceux qui l’ont regardée, un
signe d’espérance. Elle
évoquait la mort du Christ,
mais surtout la Vie dans
laquelle, par sa
Résurrection, Jésus nous
fait entrer pour toujours.
Signe de la foi qui habite
le cœur de tous les baptisés
: quelle que soit notre vie,
Jésus peut la transfigurer.
C’est cette espérance, cette
foi et cet amour, que
l’Église catholique souhaite
annoncer au plus grand
nombre, pour leur bonheur.
Et en tout premier lieu, à
ceux qui commencent le
chemin de leurs vies, les
plus jeunes. Dans notre
ville, il y a une espérance
qui ne déçoit pas : c’est le
Christ. Celui qui veut le
suivre, celui qui choisit
d’écouter sa parole, de
l’accueillir et de la mettre
en pratique, celui-là ne
sera jamais déçu. Toutes les
propositions qui jalonnent
ces pages sont autant
d’invitations à découvrir ou
à redécouvrir la force de
cet appel lancé à tout homme
et particulièrement aux plus
jeunes. La richesse de ces
initiatives est le signe
toujours plus fort d’une
Église qui vit, et qui, à
l’image de son Dieu, est
toujours une Église jeune. »
ZF05090207
TOP
Chine: Décès d’Allen
Yuan, 92 ans, pasteur
protestant de Pékin
Une
personnalité des milieux
chrétiens protestants non
officiels
ROME, Vendredi 2 septembre
2005 (ZENIT.org)
– Allen Yuan, pasteur
protestant de Pékin et
personnalité des milieux
chrétiens protestants non
officiels, est décédé à
Pékin à l’âge de 92 ans,
annonce « Eglises d’Asie »,
l’agence des Missions
étrangères de Paris dans son
édition du 1er septembre
2005 (eglasie.mepasie.org),
EDA n° 424).
Yuan Xiangchen, plus connu
sous le nom de pasteur Allen
Yuan, est décédé dans un
hôpital de Pékin le 16 août
dernier. Agé de 92 ans, il
est mort entouré de son
épouse et de ses six enfants
et a été inhumé le 19 août
dans le cimetière de
Babaoshan, situé dans
l’ouest de la capitale
chinoise, en présence d’une
foule estimée à près de 2
500 personnes. La police
était également très
présente sur les lieux et a
empêché plusieurs centaines
de personnes d’accéder à la
cérémonie funéraire. Le
pasteur Allen Yuan était une
des personnalités les plus
connues des milieux
protestants de la capitale.
Il était notamment réputé
pour son opposition résolue
et tranquille aux structures
mises en place par les
autorités pour contrôler les
Eglises protestantes ; il
refusait ainsi toute
affiliation avec le
Mouvement des trois
autonomies, équivalent pour
les protestants de
l’Association patriotique
des catholiques chinois, et
le Conseil chrétien de
Chine, qui réunit les
Eglises protestantes
affiliées au Mouvement des
trois autonomies.
Né en 1912 (ou en 1913, les
sources divergent), Yuan
Xiangchen était étudiant en
1932, date à laquelle il
fréquentait le YMCA (Young
Men’s Christian Association)
de Pékin. Son père l’y avait
envoyé étudier l’anglais,
contre son gré, le jeune
étudiant jugeant qu’il
n’avait rien de bon à
apprendre de la langue des
puissances coloniales et
tenant en piètre estime la
religion chrétienne. A
l’époque, il n’était pas
plus attiré par le
bouddhisme, estimant que
cette religion n’apportait
aucune réponse aux temps
présents, ou par le
confucianisme, estimant que
cette pensée n’offrait
aucune réponse aux défis
s’annonçant à l’horizon.
C’est pourtant à cette
époque, le soir du 29
décembre 1932 très
exactement, que Yuan
Xiangchen s’est converti au
christianisme. « Je ne peux
pas vous décrire précisément
comment ni pourquoi, mais
Dieu s’est révélé à moi et
m’a donné la foi de croire
en Lui. (…) J’ai confessé
mes péchés et j’ai accepté
Jésus pour mon sauveur »,
racontera-t-il plus tard,
retraçant sa « renaissance »
dans le Christ.
Converti, baptisé dans une
église pentecôtiste, il se
plongea dans l’étude de la
Bible avant de partir
prêcher dans les campagnes
chinoises, durant les années
de la guerre contre les
Japonais, puis de la guerre
civile entre communistes et
nationalistes. Après la
prise du pouvoir par Mao
Zedong et l’instruction des
nouvelles autorités à tous
les mouvements protestants
de s’affilier au Mouvement
des trois autonomies, lancé
au tout début des années
1950, Allen Yuan, désormais
pasteur, ainsi que d’autres
dirigeants protestants,
refusent la nouvelle
politique. En 1957, il se
voit affubler de l’étiquette
de « droitier ». L’année
suivante, âgé de 44 ou 45
ans et père de six enfants,
il est emprisonné, condamné
à la prison à vie pour «
crimes
contre-révolutionnaires » et
envoyé en camp de
rééducation par le travail.
Sa détention durera jusqu’au
20 décembre 1979. Dans le
récit de sa vie, écrit des
années plus tard, il a
décrit « les souffrances
endurées par [sa] femme pour
survivre et éduquer [ses]
enfants ». Envoyé dans un
camp près de la frontière
avec l’Union soviétique, il
a passé près de 22 ans sans
bible et sans rencontrer un
protestant. « J’ai seulement
croisé quatre prêtres
catholiques, qui étaient
dans la même situation que
moi pour avoir refusé de
rejoindre l’Association
patriotique »,
racontera-t-il.
Remis en liberté et de
retour à Pékin, le pasteur
Allen Yuan a immédiatement
recommencé à prêcher
l’Evangile, réunissant des
chrétiens et des curieux
chez lui et fondant ainsi
une des premières « Eglises
domestiques » de la
capitale. A ceux qu’il
rencontrait, Allen Yuan
expliquait qu’il ne se
cachait pas pour accomplir
sa mission et qu’il ne
considérait pas que son
action était « clandestine »
ou « souterraine ». « En
tant que responsable d’une
Eglise domestique à Pékin,
il n’avait pas peur. Il ne
cachait jamais ce qu’il
faisait », témoigne John
Short, missionnaire
australien qui a connu Allen
Yuan. En 1994, lors de la
visite de Billy Graham en
Chine, c’est chez Allen Yuan
que le télé-évangéliste
américain se rendit pour
prêcher. L’année suivante,
en 1995, Allen Yuan était à
la Maison Blanche, invité du
gouvernement américain, et
prenait part à une session
de la « White House Morning
Prayer Fellowship ». Cette
visibilité sur la scène
internationale n’empêchait
pas la police chinoise
d’intervenir régulièrement
auprès d’Allen Yuan et de le
placer en résidence
surveillée lorsque le
pasteur baptisait plusieurs
centaines de personnes sans
autorisation (1).
Selon les statistiques du
Mouvement des trois
autonomies, les communautés
chrétiennes protestantes
rassemblent aujourd’hui en
Chine environ dix millions
de fidèles. Selon les
responsables des diverses «
Eglises domestiques », très
nombreuses, les chrétiens
seraient très nettement plus
nombreux, le chiffre –
invérifiable – de 50
millions de fidèles étant
parfois avancé.
(1) Voir EDA 271. Une
biographie d’Allen Yuan a
été écrite par une proche du
pasteur. Lydia Lee : A
Living Sacrifice: The
Biography of Allen Yuan,
Sovereign World Ltd,
Londres, 2003, 256 p.
ZF05090208
TOP
Pour offrir un abonnement à
Zenit, en cadeau, cliquez
sur :
http://www.zenit.org/french/cadeau.html
----------------------------------------
|
|
|
|