| |
| |
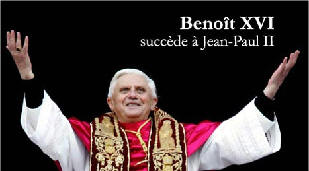
 12 septembre 2005 12 septembre 2005
Rome
Visite du roi Abdallah de Jordanie au
Vatican
Commission pour les relations avec l’islam : Nomination
de six consulteurs
Le card. Tomko envoyé du pape en Slovaquie et en
Espagne
Arméniens : Mgr Manuel Batakian premier évêque de N.-D.
de Nareg à New York
Au service des personnes handicapées ou malades, place
Saint-Pierre
International
Lyon : « Les religions, clef nécessaire
pour trouver un sens à l’existence »
Ars 2005 : Mgr Rylko encourage la retraite sacerdotale
mondiale
Un missionnaire belge, Père Blanc, arrêté au Rwanda
- Documents -
France : La loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat,
« originale », « équilibrée »
|
|
 |
|
|
| |
Rome
Visite du roi
Abdallah de Jordanie au Vatican
Promouvoir le dialogue interreligieux
ROME, Lundi 12 septembre 2005 (ZENIT.org)
– Le pape Benoît XVI a reçu ce matin en audience privée le roi
Abbdallah II de Jordanie, ainsi que la reine Rania et leur suite :
le dialogue interreligieux était à l’ordre du jour.
En route pour le sommet de l’ONU à New York (14-16 septembre), le
roi Abdallah est arrivé dimanche à Rome. Il s’agit de la deuxième
audience à des souverains, après la visite du roi Juan Carlos et de
la reine Sofia d’Espagne, lundi dernier.
Le Vatican n’a pas publié de communiqué à la suite de cette
rencontre. Mais un communiqué de la cour de Jordanie repris par
l’AFP en français indiquait à la veille de cette visite au Vatican
qu’elle devait offrir l’occasion de « promouvoir le dialogue
interreligieux », d’affirmer « les valeurs nobles de l'humanité pour
combattre l'extrémisme, le terrorisme et les tentatives de porter
atteinte à l'image réelle de l'islam ».
Le roi et la reine de Jordanie avaient accueilli le pape Jean-Paul
II à Amman, à l’occasion de son pèlerinage jubilaire sur les pas de
Moïse, en l’an 2000. Et le souverain s'était rendu au Vatican pour
assister aux funérailles de Jean-Paul II le 8 avril 2005.
En juillet dernier, le roi avait promu à Amman un congrès
international sur le thème : « Le véritable islam et son rôle dans
la société moderne ».
Le thème de l’intervention du roi de Jordanie au sommet de l’ONU
sera : « Le rôle clé de la Jordanie pour parvenir à une paix et une
stabilité régionale et internationale ».
A cette occasion, le roi Abdallah devrait rencontrer des
représentants du christianisme, du judaïsme et de l’islam, pour
souligner, indique la même source que l’islam « est une religion de
tolérance, de paix et de respect mutuel », toujours selon le
communiqué.
ZF05091201
TOP
Commission pour les relations avec l’islam : Nomination de six
consulteurs
ROME, Lundi 12 septembre 2005 (ZENIT.org)
– Le pape Benoît XVI a nommé comme consulteurs de la commission du
Vatican pour les Rapports religieux avec l'Islam du Conseil
pontifical pour le Dialogue inter-religieux, pour cinq ans :
un prêtre italien, le P. Andrea Pacini,
un prêtre espagnol, le P. José Luis Sánchez Nogales,
un jésuite australien, le P. Daniel A.Madigan, SJ,
une religieuse du Sacré-Cœur des Indes, Sr Gerardette Philips,
deux laïcs des Etats Unis, Mme Sandra Keating et M. Lamin Sanneh.
ZF05091202
TOP
Le card.
Tomko envoyé du pape en Slovaquie et en Espagne
ROME, Lundi 12 septembre 2005 (ZENIT.org)
– Le pape Benoît XVI a nommé comme son envoyé spécial à la clôture
du congrès eucharistique national slovaque, à Bratislava-Petrzlka,
dimanche prochain 18 septembre, le cardinal Jozef Tomko, président
du Comité pontifical pour les Congrès eucharistiques internationaux,
et préfet émérite de la Congrégation romaine pour l’Evangélisation
des Peuples..
Le cardinal Tomko sera accompagné par Mgr Hubertus Matheus Maria Van
Megen, secrétaire de la nonciature de Bratislava, du P. Cyril
Jancisin, secrétaire de la conférence épiscopale slovaque, et du P.
Tibor Hajdu, du clergé diocésain de Bratislava-Trnava.
Le cardinal Tomko sera également l’envoyé spécial de Benoît XVI au
premier congrès eucharistique international universitaire qui se
tiendra en Espagne, à Murcia, du 9 au 13 novembre.
ZF05091203
TOP
Arméniens : Mgr Manuel Batakian premier évêque de N.-D. de Nareg à
New York
ROME, Lundi 12 septembre 2005 (ZENIT.org)
– Pour les fidèles catholiques arméniens aux Etats-Unis, le pape
Benoît XVI a érigé l'Eparchie de Notre-Dame de Nareg à New York des
Arméniens ("Our Lady of Nareg in New York for Armenian Catholics").
Cette éparchie correspond à l'ancien Exarchat apostolique pour les
fidèles catholique de rite arménien résidents aux Etats-Unis
d'Amérique et au Canada, avec la même configuration territoriale :
elle regroupe 36 000 catholiques, 14 prêtres, et 20 religieux.
Le pape a nommé comme premier évêque arménien de Notre-Dame de Nareg
à New York Mgr Manuel Batakian, qui était jusqu'ici exarque
apostolique pour les fidèles de rite arménien résidents aux
Etats-Unis et au Canada.
Mgr Manuel Batakian est né en 1929 à Athènes, et, durant la seconde
guerre mondiale, il s’est transféré avec sa famille au Liban.
IL a étudié la philosophie et la théologie à Rome de 1946 à 1954,
année de son ordination sacerdotale, avec incardination dans le
clergé patriarcal de Bzommar. Après un apostolat dans différentes
paroisses, il a été, de 1978 à 1984, vicaire patriarcal pour
l’Institut du clergé de Bzommar et supérieur du couvent.
De 1984 à 1990, il a été curé de la cathédrale arménienne catholique
de Paris et, en 1990, il a été recteur du collège pontifical
arménien de Rome. Il a dans le même temps travaillé comme juge au
tribunal ecclésiastique de l’Eparchie de Beyrouth.
Au cours du synode des évêques de l’Eglise arménienne catholique,
qui s’est tenu du 1er au 11 novembre 1994, il avait été élu
auxiliaire du patriarche de Cilicie des Arméniens pour l’Eparchie
patriarcale de Beyrouth. Le pape Jean-Paul II avait donné son
consentement à l’élection, le 8 décembre 1994 en l’élevant au siège
titulaire de Césarée de Cappadoce. Il a été consacré le 12 mars
1995.
Le 20 novembre 2000, il avait été nommé exarque apostolique pour les
Arméniens catholiques aux Etats-Unis et au Canada.
ZF05091204
TOP
Au service
des personnes handicapées ou malades, place Saint-Pierre
Une tente de l’UNITALSI
ROME, Lundi 12 septembre 2005 (ZENIT.org)
– La fameuse organisation italienne « Union nationale italienne pour
le transport des malades à Lourdes et aux sanctuaires internationaux
» (UNITALSI, www.unitalsi.it) a
installé sa tente place Jean XXIII, au début de la rue de la
Conciliation pour accueillir et aider les personnes handicapées ou
malades présentes aux rendez-vous de la place Saint-Pierre, en
particulier les audiences du mercredi et les angélus du dimanche.
Le service a été lancé ce dimanche 11 septembre. Des volontaires
seront présents le mercredi et le dimanche pour aider et accueillir.
Ce stand sera aussi un point d’information sur les opérations de
solidarité et les initiatives de l’UNITALSI (d’Italie numéro vert :
800.062.026).
Fondée en 1903, l’UNITALSI est « une association qui, grâce à son
réseau de bénévoles, se propose de réaliser la croissance humaine et
chrétienne de ses adhérents et de promouvoir une action
d’évangélisation et d’apostolat envers les personnes malades ou
handicapées ».
L’association compte plus de trois cent mille adhérents, de tous
horizons sociaux et professionnels.
ZF05091205
TOP
|
|
|
 |
|
|
| |
International
Lyon : « Les
religions, clef nécessaire pour trouver un sens à l’existence »
« Le courage d’un humanisme de paix »
ROME, Lundi 12 septembre 2005 (ZENIT.org)
– « Les religions sont la clef nécessaire aux hommes pour
trouver un sens à leur existence » : cette phrase du ministre
français Nicolas Sarkozy est aujourd’hui relevée par Radio
Vatican.
M. Nicolas Sarkozy, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et
de l’Aménagement du territoire, est en effet intervenu dimanche
11 septembre, dans le cadre du 19e congrès « Hommes et religions
» organisé à Lyon (http://catholique-lyon.cef.fr)
par la communauté de
Sant’Egidio, pour la première fois en France, du 11 au 13
septembre 2005, sur le thème : « Le courage d’un humanisme de
paix ».
Radio Vatican souligne encore : « Défenseur de la laïcité
française, qui, spécifie le ministre, n’est pas ennemie des
religions, Sarkozy rappelle son propre engagement en faveur
d’une représentation reconnue de l’Islam français ».
M. Sarkozy a en effet affirmé d’emblée: « La France célèbre
cette année le centième anniversaire de sa loi de séparation de
l’Eglise et de l’Etat, aussi appelée loi de 1905. C’est une loi
originale, plutôt rare dans le monde, souvent mal comprise (…).
C’est un texte pourtant équilibré, qui garantit dans un même
article, dans une même affirmation, la liberté de conscience et
la liberté de culte » (texte intégral ci-dessous, documents).
« Un islam, qui condamne le terrorisme, qui l’interdit, qui ne
le justifie pas », soulignait pour sa part ce matin lors d’une
table ronde réunissant aussi le grand rabbin d'Israël Yona
Metzger et le cardinal Walter Kasper, M. Ezzeddin Ibrahim,
conseiller présidentiel des Emirats arabes unis.
« Le terrorisme ne fait aucune différence entre une jeune
chrétienne, une jeune juive ou une jeune musulmane, il est
aveugle », a-t-il souligné lors de la table ronde.
En effet, la fille de M. Ezzedin, tout comme celle de
l’archevêque de Canterbury et primat de l'Eglise anglicane, le
Rév. Rowan Williams, a échappé de justesse aux attentats du 7
juillet dernier à Londres.
« Mais que dire pour toutes les autres jeunes filles victimes de
ces attaques? », a-t-il déploré, en faisant remarquer que les
musulmans ne sont pas les seuls à avoir des responsabilités dans
le terrorisme.
« Le terrorisme est un échec humain pour le monde entier, il n'a
pas de religion ou de nationalité », a-t-il insisté.
Radio Vatican souligne également ce propos du cardinal Walter
Kasper, président du Conseil pontifical pour la Promotion de
l’Unité des chrétiens : « Un terrorisme auquel il faut enlever
son masque religieux et montrer qu’en dessous se profile du
nihilisme et que les terroristes sont des criminels et non des
hommes religieux ».
Pour le cardinal Kasper, le dialogue entre les religions doit
être intensifié pour lutter contre le terrorisme.
Il s’agit donc d’établir et de définir une collaboration
toujours plus grande entre Orient et Occident », a souligné pour
sa part le cardinal syrien Ignace Moussa Ier Daoud, préfet de la
congrégation romaine pour les Eglises orientales. Il
interrogeait : « Y a-t-il vraiment entre Orient et Occident un
conflit, un affrontement, un choc de civilisation ? Peut-il y
avoir un dialogue ? »
« Certainement oui !, répond le président de l’assemblée des
rabbins d’Italie, Giuseppe Laras, si les religions cessent de
justifier les conflits et les guerres pour s’engager – dans leur
diversité – à découvrir le rôle de service en faveur de l’homme
et des peuples ».
« Oui » répond aussi le théologien musulman Ali Taskhiri, si
l’on accueille cette invitation de Jean-Paul II : « la confiance
dans les autres religions du livre ».
Quant au rabbin Metzger, il suggérait que les responsables
religieux s’engagent par serment à lutter contre la violence, un
peu comme les médecins s’engagent à servir la vie par le serment
d'Hippocrate.
ZF05091206
TOP
Ars 2005 : Mgr Rylko
encourage la retraite sacerdotale mondiale
Transmission en direct par Radio Espérance
ROME, Lundi 12 septembre 2005 (ZENIT.org)
– « Je considère ce projet comme une très belle initiative, fort
utile pour les prêtres eux-mêmes et pour le Renouveau. La
spiritualité du lieu même contribuera certainement à
l’excellente réussite de cet événement ! », a déclaré Mgr
Stanislas Rylko, président du Conseil pontifical pour les Laïcs,
à propos de la retraite sacerdotale mondiale organisée à Ars.
Il s’agit d’une retraite « charismatique » de cinq jours
proposée aux prêtres du monde entier dans la ville du saint curé
d’Ars, saint Jean Marie Vanney, patron des curés du monde
entier, pour « se laisser renouveler dans la grâce du sacerdoce
». Elle s’adresse aussi aux cardinaux et aux évêques. Elle se
déroulera du dimanche 25 septembre au soir au samedi matin 1er
octobre 2005.
La retraite sera retransmise en direct par Radio Espérance,
basée à Saint-Etienne, avec une quinzaine d’émetteurs en France
et sur satellite WorldSpace (www.radio-esperance.com),
pour permettre à tous les prêtres qui ne pourront se déplacer de
participer aussi à cette retraite.
« Je considère cette retraite fort utile et importante car elle
donnera l’occasion aux participants d’approfondir davantage le
rapport entre le charisme d’un mouvement et la vocation et
mission sacerdotale. En effet, l’expérience nous montre que la
participation des prêtres à la vie des mouvements ecclésiaux et
communautés nouvelles leur procure à la fois le soutien
nécessaire à la vocation et la formation permanente tant
recommandée par l’Église », dit encore Mgr Rylko, qui sera l’un
des intervenants de cette semaine.
La retraite est organisée conjointement par le Service
International du Renouveau Charismatique Catholique
(International Catholic Charismatic Renewal Services, ICCRS, cf.
www.iccrs..org), la
Communauté des Béatitudes (cf.
www.beatitudes.org,
pour information : retraite.ars2005@beatitudes.org) et la
Société Jean-Marie Vianney (cf.
http://www.arsnet.org/sjmv/sjmv.html).
La retraite sera prêchée par une religieuse irlandaise reconnue
dans le monde entier pour son don pour les retraites
sacerdotales, Sr Briege McKenna, o.s.c..
Sr Briege est née en Irlande et est entrée chez les sœurs de
sainte Claire à l’âge de quinze ans. Après son arrivée à Tampa
en Floride pour enseigner, elle devient paralysée à la suite
d’arthrite rhumatoïde. A vingt-quatre ans, elle est
miraculeusement guérie au cours d’une célébration de
l’Eucharistie. Elle reçoit peu de temps après dans la prière le
don de guérison pour lequel elle est désormais largement connue.
En 1974, c’est de nouveau dans la prière qu’elle reçoit la
certitude profonde qu’elle est appelée à aider le sacerdoce.
Depuis lors, évêques et prêtres du monde entier l’invitent à
prêcher et à exercer son ministère au cours de retraites ou
rassemblements. Son livre « Je crois aux miracles » a été
traduit en de nombreuses langues dans le monde. C’est depuis
1985 que Sr Briege exerce son ministère auprès des prêtres avec
le père Kevin Scallon.
Le second prédicateur est un lazariste, irlandais également, le
P. Kevin Scallon, c.m. Après son ordination sacerdotale en 1961,
il exerce son ministère en Angleterre pendant trois ans puis au
Nigeria pendant six ans. En 1970, diplômé de l’Université
Catholique d’Amérique, il est nommé Directeur spirituel du
Séminaire « All Hallows » à Dublin, Irlande. En 1976, le père
Kevin démarre le projet « Intercession pour les prêtres » à
Dublin : il s’agit d’une retraite d’un mois au cours de laquelle
les prêtres peuvent venir prier pour le renouveau spirituel de
leur sacerdoce. En 1982, il est nommé directeur des missions et
retraites de la communauté lazariste. C’est en 1985 qu’il
commence à exercer son ministère auprès des prêtres à plein
temps avec Sr Briege McKenna.
Le programme, retransmis à la radio, prévoit chaque jour :
Le matin, les enseignements de Sr Briege McKenna, osc, et du
Père Kevin Scallon, cm
L’après-midi, des carrefours avec d’autres intervenants…
Chaque journée sera rythmée par des temps de louange, la
liturgie des heures, l’Eucharistie, l’adoration du
Saint-Sacrement, la prière du chapelet…
Le vendredi, les retraitants feront un pèlerinage à
Paray-le-Monial, cité du Cœur de Jésus : le curé d’Ars disait
que le sacerdoce c’est l’amour du Cœur du Christ.
Le samedi, la retraite s’achèvera avec la consécration du
sacerdoce à la Vierge Marie.
Voici les thèmes de chaque jour :
Dimanche 25 septembre :
Accueil à partir de 16h00 à Ars
Lundi 26 : La Spiritualité du curé d’Ars.
Eucharistie présidée par Mgr Ricard.
Carrefour animé par Mgr Bagnard.
Mardi 27 : Repentance et réconciliation.
Eucharistie présidée par le Cardinal Barbarin (Lyon - France).
Sacrement des malades proposé aux prêtres malades ou âgés.
Carrefour sur sexualité, chasteté, célibat.
Mercredi 28 : Guérison, la mission.
Eucharistie présidée par Mgr Rylko (Conseil pontifical pour les
laïcs).
Carrefour sur la mission avec sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.
Jeudi 29 : L’Eucharistie, Jésus-Christ grand prêtre.
Eucharistie présidée par le card. Turkson (Cape Coast - Ghana)
suivie d'une procession du Saint-Sacrement dans le village.
Carrefour animé par Mme Jo Croissant (Communauté des Béatitudes
- France)
Vendredi 30 : La réparation.
Pèlerinage à Paray-le-Monial, cité du coeur de Jésus.
Eucharistie présidée par Mgr Ternyak (Congrégation pour le
clergé - Vatican).
Temps de prière animé par le père Jacques Marin (Mission de
France).
Samedi 1er octobre : Consécration à Marie.
Eucharistie présidée par Mgr Grech (ICCRS - Melbourne,
Australie), avec consécration du sacerdoce à Marie.
Parmi les célébrants :
- Cardinal Philippe Barbarin (Archevêque de Lyon - France)
- Cardinal Peter Turkson (Archevêque de Cape Coast et président
de la Conférence épiscopale du Ghana)
- Mgr Guy Bagnard (Evêque de Belley-Ars)
- Mgr Joe Grech (Melbourne, Australie, représentant l'Océanie
pour l'ICCRS)
- Mgr J.-P. Ricard (Archevêque de Bordeaux et président de la
Conférence des évêques de France)
- Mgr Stanislas Rylko (Président du Conseil pontifical pour les
laïcs-Vatican)
- Mgr Csaba Ternyak (Secrétaire pour la Congrégation pour le
clergé-Vatican)
ZF05091207
TOP
Un missionnaire belge,
Père Blanc, arrêté au Rwanda
ROME, Lundi 12 septembre 2005 (ZENIT.org)
– Un missionnaire belge, Père Blanc, a été arrêté au Rwanda et
sera jugé. L’agence missionnaire italienne
Misna fait le point sur le
sort du prêtre catholique.
Dans un communiqué diffusé par Bruxelles, le ministère des
Affaires étrangères belge fait savoir que le ministre Karel De
Gucht « a pris note de la décision du tribunal populaire de
Kigali (Gacaca) de renvoyer le dossier d’accusations contre le
père belge Guy Theunis au parquet national », le tribunal
populaire ayant inséré l’accusé dans la « Catégorie 1 » des «
Planificateurs » du génocide de 1994 dans le Pays des Mille
Collines, indique l’agence missionnaire.
La note officielle ajoute que le ministre belge « aura à ce
propos une conversation approfondie avec son collègue rwandais,
Charles Murigande, en marge du Sommet du Millénaire » des
Nations unies, qui s’ouvrira à New York le 14 septembre. Le
gouvernement belge confirme que l’assistance consulaire apportée
au missionnaire « sera poursuivie ». Entre temps, les
initiatives de soutien en faveur du prêtre belge - arrêté mardi
soir à l’aéroport international de Kigali et retenu dans la
prison centrale de la capitale rwandaise – se multiplient : des
communiqués de défense et de dénonciation de son arrestation
transmis à la presse (comme celui de Reporters Sans Frontières)
à la tenue d’une réunion d’organisations non gouvernementales (Ong)
belges, prévue pour cet après-midi. Pour leur part, les
Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs), la congrégation à
laquelle père Theunis appartient, préoccupés par la décision du
Gacaca, se posent de nombreuses questions sur la façon dont la
justice rwandaise va traiter le dossier d’accusations concernant
leur confrère.
La direction générale des Pères Blancs s’active, indique Misna,
pour d’une part prendre des contacts, notamment avec les
autorités belges, et de l’autre rassembler des preuves en
défense de père Theunis, comme ses écrits dans le cadre de la
revue ‘Dialogue’ (dont il était le directeur) ou les lettres
transmises par fax en Europe durant la période initiale du
génocide (avril 1994), faits qui sont à l’origine des
accusations de la justice rwandaise à l’encontre du missionnaire
belge.
Les neuf juges du Gacaca d’Ubumwe, district de Nyarugenge dans
le centre de Kigali (Rwanda), ont renvoyé devant un tribunal
rwandais ordinaire le dossier de père Guy Theunis, de la
congrégation des Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs), après
avoir évalué que les preuves réunies à son encontre portent à
l’insertion du missionnaire belge dans la « catégorie 1 », celle
dans laquelle figurent ceux qui sont considérés comme les
planificateurs du génocide de 1994 dans le Pays des Mille
Collines.
« Après avoir examiné les informations récoltées dans les
témoignages, nous avons décidé que père Theunis doit être jugé
par un tribunal conventionnel » a dit Jean Raymond Kalisa,
président du Gacaca (tribunal populaire) d’Ubumwe. Père Theunis
s’est présenté au centre de la cour intérieure de la petite
école, siège du Gacaca, dans le centre de Kigali, portant
l’uniforme rose typique des prisonniers rwandais, entouré d’un
public de 300 personnes (mille selon le journal gouvernemental
‘New Times’).
De nombreux témoins en sa faveur ne se sont pas présentés, sauf
un membre de ‘Human Rights Watch’, l’historienne Alison de
Forges, qui est intervenue à plusieurs reprises en défense du
missionnaire, font savoir à Misna les confrères du religieux qui
ont assisté à l’audience. De nombreux fonctionnaires rwandais
étaient présents, dont certains sont intervenus contre le
missionnaire. « Vous avez été accusé d’avoir incité au génocide,
que répondez vous? » a demandé Khalisa à père Theunis. « Je ne
comprends absolument pas les accusations formulées à mon
encontre » a répondu le missionnaire. Au sujet des accusations
formulées contre lui – à savoir d’avoir publié sur la revue
‘Dialogue’, qu’il dirigeait, des extraits d’une publication
rwandaise extrémiste ‘Kangura’ – père Theunis a affirmé que les
passages de ‘Kangura’ republiés sur sa revue faisaient seulement
partie d’une revue de presse dans laquelle étaient proposés et
traduits des articles et déclarations présents sur les médias
rwandais.
Les témoignages de certains des présents à l'audience du Gacaca
ont ensuite ajouté de nouveaux éléments à l’encontre du
missionnaire, jugés par les 9 magistrats du tribunal populaire
comme suffisants pour l'insérer dans la catégorie 1. « Il se
porte bien physiquement comme mentalement » a dit à la MISNA le
Supérieur Général des Missionnaires d’Afrique, père Gérard
Chabanon, contacté à Rome. « Il est courageux et solide. Nous
nous posons beaucoup de questions. Nous nous demandons quel type
de tribunal le jugera, où et quand. Ils nous ont seulement fait
savoir que ‘pour le moment il restera dans la prison centrale de
Kigali’ », conclut Misna.
ZF05091208
TOP
|
|
|
|
 |
|
|
| |
-
Documents -
France : La loi de
séparation de l’Eglise et de
l’Etat, « originale », «
équilibrée »
Allocution de M. Sarkozy
ROME, Lundi 12 septembre
2005 (ZENIT.org)
– « La France célèbre cette
année le centième
anniversaire de sa loi de
séparation de l’Eglise et de
l’Etat, aussi appelée loi de
1905. C’est une loi
originale, plutôt rare dans
le monde, souvent mal
comprise (…). C’est un texte
pourtant équilibré, qui
garantit dans un même
article, dans une même
affirmation, la liberté de
conscience et la liberté de
culte » a souligné M.
Sarkozy hier à Lyon.
Voici le texte intégral de
l’allocution de M. Nicolas
Sarkozy, Ministre d’Etat,
ministre de l’Intérieur et
de l’Aménagement du
territoire, le 11 septembre,
dans le cadre du 19e congrès
« Hommes et religions »
organisé à Lyon par la
communauté de Sant’Egidio (www.santegidio.org),
pour la première fois en
France, du 11 au 13
septembre 2005, sur le thème
thème : « Le courage d’un
humanisme de paix ».
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les
représentants des grandes
religions,
Mesdames et Messieurs les
ministres,
Mesdames, Messieurs, chers
amis,
Je suis heureux et très
honoré d’être parmi vous
aujourd’hui pour ouvrir les
19ème rencontres
internationales pour la
paix, qui se tiennent pour
la première fois en France.
A ceux qui ne sont pas
français, permettez-moi de
souhaiter d’abord la
bienvenue dans notre pays.
***
La France célèbre cette
année le centième
anniversaire de sa loi de
séparation de l’Eglise et de
l’Etat, aussi appelée loi de
1905. C’est une loi
originale, plutôt rare dans
le monde, souvent mal
comprise. Le contexte de son
élaboration, marqué par un
conflit de pouvoir entre
l’Etat et l’Eglise
catholique, puis les
conditions de sa mise en
œuvre, ont assombri sa
naissance et relégué à
l’arrière-plan la puissance
de son texte. C’est un texte
pourtant équilibré, qui
garantit dans un même
article, dans une même
affirmation, la liberté de
conscience et la liberté de
culte.
Contrairement à l’image
qu’elle a héritée de son
histoire mouvementée, la
laïcité à la française n’est
pas l’ennemie des religions.
Elle est une construction
politique, juridique et
humaine, qui s’efforce de
concilier le droit de tout
individu de pratiquer un
culte et l’interdiction
faite à tous de méconnaître
ce bien si cher qu’est la
liberté de conscience. Elle
organise une coexistence
pacifique de toutes les
religions, grâce à l’égalité
des droits, à l’égalité des
dignités, à la neutralité de
l’Etat, à la liberté de
croire et de pratiquer ainsi
qu’à celle de ne pas croire.
La loi récente relative aux
conditions dans lesquelles
les élèves des
établissements scolaires
peuvent porter des signes
religieux est le
prolongement de cet édifice.
Elle prévoit que les enfants
peuvent porter un symbole de
leur foi, mais que celui-ci
doit rester suffisamment
discret pour ne pas
provoquer, choquer ou
diviser. Je n’étais pas
favorable à que ce soit une
loi qui édicte une telle
règle, car je pensais que le
dialogue était préférable
pour atteindre le même
résultat. Je suis en
revanche fermement convaincu
que l’école doit faire
grandir nos enfants dès le
plus jeune âge dans un
esprit de tolérance envers
ceux qui croient et de
respect envers ceux qui ne
croient pas et que la règle
retenue est donc la bonne.
Depuis la fin de la première
guerre mondiale et la
réconciliation entre les
pouvoirs publics et l’Eglise
catholique autour d’une
interprétation moins rigide
de la loi de séparation, la
laïcité est unanimement
reconnue comme un des
piliers de la démocratie
française, une condition de
son équilibre, un facteur de
paix entre les citoyens. La
laïcité n’est pas le seul
modèle de coexistence
pacifique de plusieurs
religions et de l’incroyance
dans un pays démocratique.
Mais, dans notre pays, où
les conflits internes ont
souvent un caractère
passionnel et laissent des
traces profondes, elle
constitue aujourd’hui un
point d’équilibre
consensuel. Toutes les
religions de notre pays lui
sont profondément attachées,
leurs représentants qui sont
ici peuvent en témoigner.
C’est la raison pour
laquelle, dans un ouvrage
récent, et à la lumière de
mon expérience de ministre
des cultes, j’ai plaidé pour
que la place de l’islam en
France soit davantage
reconnue. Lorsque la loi de
1905 a été adoptée, il n’y
avait pas de musulmans en
France. Il y en a
aujourd’hui cinq millions.
L’Etat a le devoir de
permettre à ces croyants de
prier et de pratiquer leur
culte dans les mêmes
conditions de dignité et de
droit que les croyants des
religions plus anciennes,
qui bénéficient par exemple
des édifices cultuels dont
la France s’est couverte
tout au long de son
histoire.
Je propose qu’à la lettre du
texte de 1905, nous
préférions son esprit. La
question de la présence
d’une nouvelle religion en
France ne se posait pas en
1905. Elle se pose
aujourd’hui. C’est le
fondement même de la laïcité
qui est en jeu si nous
n’adaptons pas notre pays à
la réalité d’une présence
musulmane importante en
France. C’est possible et
c’est nécessaire, tout en
respectant les grands
équilibres de la laïcité
française.
De même, j’ai œuvré de
toutes mes forces pour que
l’islam de France se dote
d’un conseil représentatif
avec lequel l’Etat puisse
discuter, comme c’est le cas
de toutes les autres grandes
religions. Le Conseil
français du culte musulman
est également une instance
nécessaire au dialogue
inter-religieux, une
préoccupation qui est au
cœur de vos rencontres
annuelles.
Dans le Conseil français du
culte musulman, tous les
courants de l’islam de
France sont représentés, y
compris ceux dont les
positions sont
fondamentalistes, sans être
pour autant intégristes. Les
fondamentalistes sont à mon
sens ceux qui veulent vivre
leur foi de manière
fondamentale, c’est-à-dire
en pratiquant de la manière
la plus rigoureuse possible
les prescriptions de leur
religion. C’est un désir
naturel tant il est vrai que
les convictions religieuses
touchent le cœur de la
personne humaine. Il n’y a
rien de plus normal, pour
celui qui croit, de mettre
toute sa vie en adéquation
avec sa foi, en tout cas
d’essayer. Vivre dans un
monastère catholique est une
forme de fondamentalisme.
L’intégrisme consiste en
revanche à imposer les
prescriptions de sa croyance
aux autres, ce qui est
différent. Il doit être
condamné.
Cette décision d’intégrer
les fondamentalistes au
conseil représentatif de
l’islam de France a été
critiquée. On a raillé ma
naïveté ou l’on a dénoncé
une complaisance excessive
avec des courants de l’islam
dont les positions ne sont
pas toujours claires au
regard de la séparation
entre le temporel et le
spirituel, de la liberté de
conscience ou de l’égalité
entre l’homme et la femme.
Ma conviction, et je sais
qu’elle n’est pas étrangère
aux préoccupations de votre
assemblée, est que
l’ouverture et le dialogue
sont beaucoup plus à même
d’aider les fondamentalistes
à clarifier leur position,
plutôt que l’exclusion qui
mène à la radicalisation.
Si nous devons regretter les
brutalités de sa mise en
œuvre, c’est un fait que la
loi de 1905 a eu sur
l’Eglise catholique une
influence utile. Elle l’a
aidée à repenser
l’articulation entre la
Révélation chrétienne et
l’histoire humaine, et à
admettre le pluralisme comme
un processus historique pas
nécessairement inconciliable
avec le projet de Dieu sur
l’homme. De la même manière,
je pense que l’inscription
de l’islam dans le contexte
cultuel français, où les
religions sont séparées de
l’Etat et se respectent
entre elles, peut
constituer, pour tout le
monde musulman, un exemple
de ce que l’islam peut
s’intégrer dans une société
démocratique, pluraliste et
sécularisée, sans renier
pour autant la profondeur de
ses convictions.
***
Le fondement de mon action
et de mes propositions n’est
pas seulement juridique. Je
ne cherche pas uniquement à
établir une égalité
parfaite, formelle et
réelle, entre les
différentes religions de
France. Le but principal de
mon engagement est de
convaincre mes compatriotes
qu’il n’y a pas de solution
aux difficultés
d’intégration et d’harmonie
sociale que nous
connaissons, si nous
n’aidons pas les musulmans
de France à se construire
une identité, dans ce pays
tout à la fois de tradition
judéo-chrétienne et
profondément laïcisé.
Cette identité passe par le
respect de la dignité de
chacun, en particulier par
la lutte contre les
discriminations. Elle passe
par la promotion sociale,
tant il vrai qu’une identité
humiliée est une identité
radicalisée. Elle passe par
la possibilité de pratiquer
sa religion dans des
conditions dignes,
respectées, naturelles.
Le progrès technique,
l’amélioration des
conditions générales de vie,
la démocratisation,
l’émergence d’une société du
savoir, n’ont pas aboli le
besoin fondamental de
l’homme d’espérer. D’une
certaine manière, ils l’ont
même consolidé ou
réactualisé.
Après la barbarie des deux
conflits mondiaux et
l’effondrement du bloc
communiste, les hommes et
les femmes de notre temps
ont pu croire que l’humanité
allait enfin converger vers
un monde de paix et de
respect mutuel. En réalité,
il n’en a rien été. Ce que
les hommes ont gagné en
liberté et en prospérité,
ils l’ont perdu en
prévisibilité et en
simplicité d’analyse de
l’histoire. Les conflits se
sont multipliés tandis que
les facilités de circulation
des capitaux, des personnes
et des biens ébranlent la
hiérarchie traditionnelle
des puissances et brouillent
celle des priorités.
La mondialisation économique
soumet les territoires à une
obligation de compétitivité.
La croissance de la richesse
mondiale augmente. Mais la
pertinence de sa répartition
n’apparaît pas avec
évidence. Dans les pays
émergents, les inégalités
sont considérables et les
performances économiques de
certaines zones cohabitent
avec des situations de
pauvreté extrême. Dans les
pays occidentaux, la
mondialisation ébranle des
secteurs entiers de
l’économie et hypothèque le
sort des travailleurs les
moins qualifiés. L’Afrique
semble pour sa part s’être
arrêtée sur la montre du
temps.
Aujourd’hui, les hommes et
les femmes voient bien que
la prospérité matérielle ne
suffit pas à satisfaire les
aspirations profondes de
l’homme. Elle n’est d’aucun
secours pour distinguer le
bien du mal. Elle ne donne
pas de sens à l’existence.
Elle ne répond pas aux
questions fondamentales de
l’être humain : pourquoi y a
t’il une vie et quel est le
sens de la mort ? Même la
liberté et la démocratie ne
donnent pas de réponse.
Les sociétés, notamment
occidentales, sont entrées
dans cette époque curieuse
d’une frénésie croissante de
biens matériels toujours
plus sophistiqués et, en
même temps, d’un immense
besoin de croyances
surnaturelles sur lesquelles
fonder une espérance et une
identité. La mondialisation
uniformise les conditions de
production, les modes de vie
et peut-être les cultures.
Elle ne répond pas au besoin
de sens.
***
C’est pourquoi, et nous le
voyons tous les jours, les
religions jouent un rôle
déterminant dans cette
réorganisation du monde, des
sociétés, des idées. Elles
qui sont, par nature,
transnationales, elles
peuvent aider les hommes à
trouver un sens à leur
existence indépendamment des
frontières ou des identités
nationales, ou en complément
de celles-ci.
Mais elles sont aussi la
proie des amalgames et des
extrémismes. La religion est
instrumentalisée par tous
ceux qui rejettent, parce
qu’ils les craignent, la
multiplication des échanges,
la circulation des idées, le
mélange des cultures. Ce
n’est pas un phénomène
nouveau. Toutes les
religions ont été et sont
menacées par le risque de
l’intégrisme et de
l’intolérance, même si,
aujourd’hui, l’une d’entre
elles est particulièrement
concernée. En ce jour où
nous célébrons le quatrième
anniversaire des attentats
du 11 septembre, comment ne
pas songer à l’extrême
gravité des événements qui
se sont produits à New York,
en Egypte, en Indonésie, au
Maroc, à Istanbul, à Madrid,
à Londres et en bien
d’autres endroits encore ?
Les démocraties sont
ébranlées, parce qu’elles
sont fondées sur le respect
des croyances, la garantie
des libertés individuelles
et la confiance dans l’Etat
pour assurer la sécurité de
tous. Mais les religions le
sont également, et plus
encore les croyants. Ils
peuvent se radicaliser à
leur tour ou être victimes
d’amalgames, comme on l’a vu
par exemple à la suite des
attentats de Londres. Le
discrédit que jette le
terrorisme sur les religions
peut priver les hommes des
raisons d’espérer ou les
conduire à se réfugier dans
des croyances nouvelles, peu
structurées.
Des rencontres
inter-religieuses comme
celle qui s’ouvre
aujourd’hui sont
déterminantes pour résister
aux amalgames, répondre aux
inquiétudes, promouvoir la
paix. C’est un progrès
capital du vingtième siècle
que d’avoir ouvert les
portes du dialogue entre les
religions. Force est de
reconnaître qu’il n’y en a
pas eu beaucoup d’autres. Je
tiens à convoquer ici la
mémoire de Jean-Paul II dont
le rôle en la matière a été,
une fois encore,
déterminant.
Ma conviction, c’est que les
religions ont entre elles
beaucoup plus de choses qui
les rassemblent que de
choses qui les divisent. Les
grandes religions de
l’humanité délivrent au fond
un message homogène : la vie
humaine doit être protégée
parce qu’elle a quelque
chose à voir avec
l’existence de Dieu ; le
bien-être matériel ne suffit
pas au bonheur humain ; la
mort n’est pas la fin de
toute vie. Il ne s’agit pas
de faire du syncrétisme. Il
s’agit de reconnaître cette
évidence que les grandes
religions convergent
finalement vers un noyau dur
de croyances fondamentales
qui répondent aux
aspirations humaines.
C’est pourquoi les grandes
religions peuvent satisfaire
le besoin d’identité et de
sens sans provoquer
l’intolérance. Elles peuvent
favoriser le dialogue entre
les cultures et les
croyances sans craindre le
relativisme. Elles peuvent
et elles doivent se
rassembler pour rappeler au
monde que la prospérité
économique n’a aucun sens si
elle se fait aux dépens du
bonheur de l’homme.
Nous résisterons au choc des
civilisations car toutes les
religions et tous les
courants de pensée
philosophique peuvent s’unir
dans une même affirmation, à
laquelle je crois
profondément : il n’y a
qu’une civilisation, la
civilisation humaine. C’est
un motif d’espérance pour
notre temps.
***
Mesdames et Messieurs, le
choix de la ville de Lyon
pour organiser ces 19ème
rencontres internationales
pour la paix est un bon
choix. Lyon a en effet une
place particulière pour la
France des religions et des
croyants. C’est à Lyon
qu’est née la première
communauté chrétienne. C’est
à Lyon que Frédéric Ozanam a
créé le catholicisme social.
Plus récemment, Lyon a
accueilli la construction
d’une grande Mosquée, à
laquelle se sont associées
sans arrière pensée l’Eglise
catholique, l’Eglise
réformée, l’Eglise
apostolique arménienne et la
communauté juive, offrant à
la Nation toute entière un
remarquable exemple de
tolérance et de dialogue
entre les religions. Comment
ne pas évoquer aussi le
martyre du peuple juif,
auquel la communauté
lyonnaise a payé un lourd
tribut, et l’unification de
la Résistance contre la
barbarie nazie ?
Chaque année,
le 8 décembre,
d’innombrables bougies
illuminent la ville en
souvenir de sa dévotion
mariale et rassemblent des
milliers de personnes de
toute origine et de toute
croyance. Elles brilleront
cette année avec une pensée
particulière pour la
communauté de Sant’Egidio et
son œuvre de paix, de
dialogue, de prière,
d’éducation, d’aide aux plus
démunis.
Je souhaite que vos travaux
soient le plus fructueux
possibles, car le courage,
l’humanisme et la paix sont
assurément ce dont le monde
aura toujours le plus
besoin.
ZF05091209
TOP
----------------------------------------
Pour offrir un abonnement à
Zenit, en cadeau, cliquez
sur :
http://www.zenit.org/french/cadeau.html
----------------------------------------
|
|
|
|