| |
| |
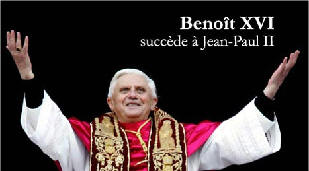
 30 septembre 2005 30 septembre 2005
Rome
Benoît XVI visite les enfants malades
Un prêtre québécois nommé évêque au Honduras
L’enseignement social de l’Eglise dans le monde
agricole
Méditation
« Le royaume de Dieu vous sera enlevé » : Médiation du
prédicateur de la Maison pontificale
International
Retraite à Ars : « Savez-vous la différence entre un
prêtre et un curé ? »
Etats-Unis : Nomination de J. Roberts à la présidence
de la Cour suprême
Le Christ de Rio sur la façade de la cathédrale Notre
Dame de Paris
Spécial Chine
Le card. Etchegaray souhaite unité et dialogue entre
les chrétiens de Chine
Des prêtres catholiques chinois à l’audience du pape
Benoît XVI
Disponibilité du Saint-Siège à mener « un dialogue
constructif » avec Pékin
- Documents -
Intention missionnaire : « Contribuer économiquement à
l’œuvre missionnaire »
Revue de Presse autre que Zénit.
Benoît XVI ouvre un Synode dépoussiéré
|
|
 |
|
|
| |
Rome
Benoît XVI visite les enfants
malades
Témoigner de l’Evangile aux personnes souffrantes
ROME, Vendredi 30 septembre 2005 (ZENIT.org)
– Le pape Benoît XVI a rendu visite ce vendredi matin aux enfants
malades soignés à l’hôpital pédiatrique de l’Enfant Jésus (« Bambino
Gesù »), propriété du Saint-Siège, et référence internationale en
matière de médecine des enfants et de recherche médicale.
Rappelons, comme le soulignait le docteur Francesco Silvano,
directeur de cette institution, que l’hôpital du « Bambino Gesù »
est né en 1896, grâce à la générosité de la famille Salviati, qui en
a ensuite fait don au pape Pie XI, il y a 80 ans. Devenu une
institution du Saint-Siège, l’hôpital pédiatrique est donc placé
sous l'autorité de la Secrétairerie d'Etat.
C’était la première visite de Benoît XVI dans un hôpital. Mais lors
des audiences générales, le pape a toujours manifesté une
sollicitude particulière aux malades. Le pape a parcouru les
différents services de l'hôpital, saluant les enfants malades et
leurs familles, avant de rencontrer les dirigeants et le personnel
médical.
Benoît XVI a expliqué qu’il avait tenu à rendre visite dans cet
hôpital parce qu’il « appartient au Saint-Siège », mais aussi pour «
y témoigner de l'amour de Jésus pour les enfants ». « C'est Jésus
qui nous accueille en tout malade, et plus encore s'il est petit et
malade », a souligné le pape.
Le pape a souligné combien l’engagement du personnel de cet hôpital
pas comme les autres « exige » à la fois « une grande disponibilité
», la recherche continue d’ouvrir « davantage de services », de «
l'attention », un « esprit de sacrifice », de la « patience » et un
sens de la gratuité, de façon à ce que les familles y trouvent «
espérance » et « sérénité », même dans des moments de grande «
inquiétude ».
Il encourageait le personnel en ces termes : « Ayez à cœur d'assurer
des soins excellents non seulement au plan médical mais aussi humain
», et il ajoutait : « Ceci vaut pour tout hôpital, mais doit
caractériser tout spécialement ceux qui s'inspirent des principes
évangéliques ».
Le pape a exprimé sa gratitude envers le personnel pour ce travail
qui revêt une « valeur humaine élevée » et un véritable « apostolat
».
L’Eglise, continuait le pape, « doit être au cœur de l'hôpital:
trouvez en Jésus Eucharistie, doux médecin des corps et des âmes, la
force spirituelle de soigner et réconforter les malades ».
Au « Bambino Gesù », « au contact de l'humanité souffrante, il est
possible d'offrir un témoignage concret et efficace à l'Evangile »,
ajoutait le pape qui invitait : « Prions ensemble pour que l'on
proclame ici, en acte, la puissance du Christ, dont l'Esprit guérit
et transforme l'existence humaine ».
ZF05093001
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
Un prêtre québécois nommé évêque
au Honduras
ROME, Vendredi 30 septembre 2005 (ZENIT.org)
– Le pape Benoît XVI a créé un nouveau diocèse, celui de Yoro, au
Honduras, issu du démembrement du territoire de l’archidiocèse de
Tegucigalpa, et il a procédé à la nomination du Père Jean-Louis
Giasson, P.M.E., comme premier évêque de ce diocèse.
Le site de la conférence épiscopale du Canada (www.cecc.ca)
indique que Mgr Giasson est né en 1939 à l’Islet-sur-Mer, dans le
diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, au Québec. Il a été ordonné
pour la Société des prêtres des missions étrangères du Canada
(P.M.E.) en 1965.
L’évêque élu connaît bien le Honduras, précise ce communiqué,
puisqu’il y œuvre comme missionnaire depuis 1966. Il y a occupé
diverses fonctions : directeur spirituel et recteur de séminaire,
curé de paroisses ainsi qu’accompagnateur spirituel. Depuis 2003, il
agissait à titre de supérieur régional pour le Honduras de la
Société des missions étrangères de la Province de Québec.
Le nouvel évêque sera ordonné évêque de Yoro, le 12 décembre
prochain, lors d’une célébration qui aura lieu à Progreso, la plus
importante ville du diocèse.
Au total, dix évêques d’origine canadienne exercent leur ministère
ailleurs dans le monde. Outre Mgr Giasson et deux confrères de la
Société des Missions étrangères qui sont en poste au Honduras, six
Canadiens ont une charge diocésaine en Nouvelle-Guinée, au Pérou, au
Malawi, au Tchad, en Ouganda et aux États-Unis. Le dixième, Mgr
Michael Miller, C.S.B., est en poste à Rome comme secrétaire de la
Congrégation pontificale pour l’éducation catholique.
ZF05093002
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
L’enseignement
social de l’Eglise dans le monde agricole
ROME, Vendredi 30 septembre 2005 (ZENIT.org)
– L’enseignement social de l’Eglise concerne aussi la mise en œuvre
de l’Evangile dans le monde agricole, comme le soulignait le
cardinal Renato Raffaele Martino, président du Conseil pontifical
Justice et Paix, qui a présenté l’abrégé de la doctrine sociale de
l’Eglise devant des représentants de la confédération générale de
l’Agriculture italienne, la « Confagricoltura » (www.confagricoltura.it)
dans une conférence intitulée : « Un nouvel humanisme visant à
découvrir le bien commun ».
La rencontre était organisée, le 29 septembre, à Rome, par le
président de la
« Confagricoltura » (qui existe depuis un siècle), Roberto Vecchioni,
avec la participation du ministre italien de l’environnement, Altero
Matteoli.
« L’abrégé est comme un manifeste pour réaliser un nouvel humanisme
», a déclaré le cardinal Martino. « Il convient que la richesse de
l’Evangile revive et se diffuse dans l’ethos social et culturel des
peuples, pour l’espérance de toute génération ».
Pour ce qui concerne le bien commun, le cardinal a expliqué que «
l’agir moral des individus se réalise en accomplissant le bien,
ainsi, l’agir social arrive à sa plénitude en réalisant le bien
commun ».
Le bien commun est donc entendu « comme la dimension sociale et
communautaire du bien moral », soulignait encore le cardinal Martino.
Le cardinal Martino a ensuite abordé la question du rapport avec la
terre et la création, soulignant les passages du « compendium »
consacrés à la sauvegarde de l’environnement, tout en exprimant «
réserves et perplexités face aux nombreuses formes d’idolâtrie de la
nature, qui débouchent aujourd’hui sur un « écologisme » radical ».
Il rappelait qu’à l’occasion de la conférence internationale du
Caire sur Population et Développement, en 1994, le Saint-Siège s’est
en effet opposé « à l’idée marquée par un « écologisme » radical »
selon laquelle l’augmentation de la population, dans les décennies à
venir, serait propre à bouleverser les équilibres naturels de la
planète et à en freiner le développement.
« Ces thèses, soulignait le cardinal Martino, sont désormais
réfutées et heureusement en régression, même si, en même temps, «
ceux qui proposaient cette vision malthusienne, animés par ce
radicalisme écologique, proposaient, comme moyen de freiner les
naissances et empêcher le présumé désastre environnemental, le
recours à l’avortement et à la stérilisation de masse des pays
pauvres et à natalité élevée ».
Pour le cardinal Martino, « la nature ne peut pas être considérée
seulement dans la perspective d’une idolâtrie de la nature », et
elle ne doit pas être considérée comme « un domaine d’exercice de la
technique sans discernement ».
Le compendium, soulignait le cardinal Martino, propose une vision
réaliste des choses en « manifestant sa confiance dans l’homme, et
dans sa capacité toujours nouvelle à chercher ses solutions aux
problèmes que l’histoire nous pose ; capacité qui lui permet de
réfuter les prévisions catastrophiques récurrentes, malheureuses et
improbables ».
Pour sa part, le président de la « Confagricoltura » a exprimé
combien il apprécie l’enseignement social de l’Eglise surtout dans
les domaines où elle parle de destination universelle des biens et
du reste de l’environnement.
« Nous, agriculteurs, a souligné M. Vecchioni, nous sommes
parfaitement conscients de l’importance de ces concepts. Préserver
l’environnement, le terroir, le paysage, et les ressources
naturelles, du sol et de l’eau, signifie avant tout préserver notre
maison, notre travail ».
Il se réjouissait de la capacité de l’Eglise à « voir loin » et à «
fournir des indications qui échappent à la logique des intérêts
particuliers ».
Il soulignait : « Même si la « Confagricoltura » a toujours maintenu
une ligne de laïcité, nous ne nous sentons pas étrangers ni
indifférents à ce message. Beaucoup d’entre nous en ont fait une
règle de conduite ».
ZF05093003
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
Méditation
« Le royaume de Dieu vous sera
enlevé » : Médiation du prédicateur de la Maison
pontificale
Commentaire de l’Evangile du dimanche 2 octobre
ROME, Vendredi 30 septembre 2005 (ZENIT.org)
– Nous publions ci-dessous le commentaire de l’Evangile de ce
dimanche (Mt 21, 33-43) que proposait cette semaine le père Raniero
Cantalamessa OFM Cap, prédicateur de la Maison pontificale, dans
l’hebdomadaire catholique italien « Famiglia cristiana ».
XXVII Dimanche du
temps ordinaire (Année A) - 2 octobre 2005
« Le royaume de Dieu vous sera enlevé »
Evangile de
Jésus-Christ selon saint Matthieu 21,33-43.
« Écoutez une autre parabole : Un homme était propriétaire d'un
domaine ; il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un
pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à
des vignerons, et partit en voyage.
Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs
auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne.
Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un,
tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième.
De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux
que les premiers ; mais ils furent traités de la même façon.
Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : 'Ils
respecteront mon fils.'
Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : 'Voici
l'héritier : allons-y ! tuons-le, nous aurons l'héritage !'
Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent.
Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces
vignerons ? »
On lui répond : « Ces misérables, il les fera périr misérablement.
Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons, qui en
remettront le produit en temps voulu. »
Jésus leur dit : « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures : La
pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre
angulaire. C'est là l'oeuvre du Seigneur, une merveille sous nos
yeux !
Aussi, je vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour
être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit.
© AELF
La parabole des vignerons infidèles, surtout dans sa conclusion («
Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui
lui fera produire son fruit »), évoque le thème du fameux « refus
d’Israël ». Une interprétation simpliste et triomphaliste de cette
page et d’autres pages semblables de l’Evangile, a contribué à créer
le climat de condamnation des juifs, avec les conséquences
dramatiques que nous connaissons. Nous ne devons pas abandonner les
certitudes de foi qui nous viennent de l’Evangile, mais il suffit de
peu pour constater combien notre comportement en a souvent déformé
l’esprit authentique.
Dans ces terribles paroles du Christ c’est d’abord l’extraordinaire
amour de Dieu et non une froide condamnation qui s’exprime à l’égard
d’Israël. Jésus pleure lorsqu’il parle de l’avenir de Jérusalem ! Il
s’agit en outre d’un rejet pédagogique non définitif. Dans l’Ancien
Testament aussi il y avait eu des refus de Dieu. L’un d’eux est
décrit par Isaïe, dans la première lecture, avec cette même image de
la « vigne » (« Et maintenant, que je vous apprenne ce que je vais
faire à ma vigne ! en ôter la haie pour qu’on vienne la brouter, en
briser la clôture pour qu’on la piétine » 5,5) mais ceci n’a pas
empêché Dieu de continuer à aimer Israël et à veiller sur lui.
Saint Paul nous assure que même ce dernier refus, annoncé par Jésus,
ne sera pas définitif. Il permettra en réalité aux païens d’entrer
dans le royaume (cf. Rm 11, 11.15). Il va plus loin encore : par la
foi d’Abraham – qui constitue les prémices et la racine – tout le
peuple juif est saint, même si certaines branches ont défailli (cf.
Rm 11, 16). L’Apôtre des gentils, retenu à tort comme responsable de
la fracture entre Israël et l’Eglise, nous suggère le comportement
juste,
face au peuple juif. Non pas une auto-assurance et une vanité
stupide (« nous sommes désormais le nouvel Israël, nous sommes les
élus ! »), mais crainte et tremblement devant le mystère insondable
de l’action divine (« que celui qui se flatte d'être debout prenne
garde de tomber ! »), et plus encore amour pour Israël qui est la
racine et le tronc sur lesquels nous sommes greffés. Paul affirme
être disposé à rester séparé du Christ si cela pouvait profiter à
ses frères (cf. Rm 9, 1-3). Si les chrétiens dans le passé avaient
cherché à avoir ces sentiments en parlant des juifs, le cours de
l’histoire aurait été différent.
Si les juifs parviennent un jour (comme l’espère Paul) à un jugement
plus positif sur Jésus, cela sera le fruit d’un processus interne,
l’aboutissement d’une recherche propre (ce qui est en partie en
train d’advenir). Ce n’est pas à nous, chrétiens, d’essayer de les
convertir. Nous avons perdu le droit de le faire à cause de la
manière dont cela a été fait dans le passé. Les blessures devront
d’abord être guéries à travers le dialogue et la réconciliation.
Je ne vois pas comment un chrétien qui aime vraiment Israël pourrait
ne pas désirer que celui-ci parvienne un jour à découvrir Jésus que
l’Evangile définit « gloire de son peuple, Israël » (Lc 2, 32). Je
ne crois pas que cela soit du prosélytisme.
Mais pour le moment, le plus important est d’ôter les obstacles que
nous avons mis à cette réconciliation, la « mauvaise image » que
nous leur avons donnée de Jésus. Ceci vaut aussi pour les obstacles
présents dans le langage : combien de fois le mot « juif » prend un
sens péjoratif, ou négatif dans notre manière de parler. Les
relations entre les chrétiens et les juifs se sont améliorées après
le Concile Vatican II. Le décret sur l’œcuménisme a reconnu à Israël
un statut à part, parmi les religions. Pour nous chrétiens, le
judaïsme n’est pas « une autre religion » ; il fait partie
intégrante de notre religion. Nous adorons le même « Dieu d’Abraham,
d’Isaac et de Jacob » qui pour nous est aussi « le Dieu de
Jésus-Christ ».
[Texte original en italien publié dans « Famiglia cristiana » -
Traduction réalisée par Zenit]
ZF05093004
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
International
Retraite à Ars : « Savez-vous la
différence entre un prêtre et un curé ? »
En direct sur les ondes
ROME, Vendredi 30 septembre 2005 (ZENIT.org)
– « Savez-vous la différence entre un prêtre et un curé ? » « Le
curé d’Ars la connaissait bien », répondait Mgr Bagnard, évêque de
Belley Ars, lors de son intervention au début de la retraite
sacerdotale internationale réunissant, au village du Saint Curé, des
prêtres venus de 71 pays.
Il s’agit d’une retraite « charismatique » de cinq jours proposée
aux prêtres du monde entier dans la ville de saint Jean Marie
Vianney, patron des curés du monde entier, pour « se laisser
renouveler dans la grâce du sacerdoce ». Elle s’adresse aussi aux
cardinaux et aux évêques. Elle se déroule depuis dimanche 25
septembre et jusqu’à samedi matin, 1er octobre. Mgr Guy Bagnard
présidera la messe de conclusion, et la « consécration du sacerdoce
» des retraitants à la Vierge Marie.
La retraite est retransmise en direct par Radio Espérance, basée à
Saint-Etienne, avec une quinzaine d’émetteurs en France (www.radio-esperance.com),
pour permettre à tous les prêtres qui ne peuvent se déplacer de
participer aussi à cette retraite. Et ceci également par satellite
WorldSpace en Afrique et au Moyen Orient, grâce au transistor « du
troisième millénaire ».
Denis Jagou, envoyé spécial de Radio Espérance rapporte, pour les
lecteurs de Zenit, ces quelques « flash » de cette retraite,
organisée conjointement par le Service International du Renouveau
Charismatique Catholique (International Catholic Charismatic Renewal
Services, ICCRS, la Communauté
des Béatitudes et la
Société Jean-Marie
Vianney).
La retraite est prêchée par une religieuse irlandaise reconnue dans
le monde entier pour son don pour les retraites sacerdotales, Sr
Briege McKenna, o.s.c., et par un Lazariste, le P. Kevin Scallon,
irlandais également.
Etre prêtre, une joie ; être curé, une épreuve
« Nous savons tous, continuait Mgr Bagnard, ce que représente le
sacrement de l’ordre devant l’image de Jésus Bon Pasteur, la prière,
l’adoration, le mystère de la réconciliation, de l’Eucharistie… Pour
cela, « être prêtre, c’est une joie. Mais, être curé, c’est une
épreuve ». »
Dans l’église souterraine du sanctuaire d’Ars, les applaudissements
qui ont suivi cette remarque sont révélateurs de la situation des
850 prêtres venu vivre ces cinq jours de grâce exceptionnels.
Face aux difficultés que rencontre les prêtres dans le monde
d’aujourd’hui, il était bon de leur donner l’occasion d’un
renouvellement en profondeur des grâces liées à leur ministère
sacerdotal. C’est du moins ce que pense Cathy Brenti, organisatrice
du projet.
La joie de la première messe
« Le Père Kevin Scallon et Sister Briege McKenna ont un ministère de
prédication depuis plus de vingt ans auprès des prêtres, et
connaissent bien leurs difficultés, leurs peines, leur souffrance.
Ils n’ont pas manqué, fait observer Denis Jagou, d’aborder des
sujets délicats comme la chasteté, le célibat, le mariage des
prêtres, les problèmes d’abus... Ces questions ont été l’occasion
d’exhorter les prêtres à revenir à la grâce du « premier amour », à
retrouver la joie de la première messe. Tous ont été invités à se
rappeler combien est puissant leur ministère, combien cet appel est
un don de Dieu dont il faut être convaincu. Sister Briege citait le
Curé d’Ars : « Si le prêtre connaissait le sacerdoce, il mourrait
d’amour » . »
C’est un mystère a approfondir pour être, comme le soulignait
également Mgr Bagnard, ces « guetteurs sur la Maison d’Israël », ces
« bergers qui défendent les brebis contre les loups », ces «
gagneurs d’âmes à Dieu », à l’image de Jean Marie Vianney.
Le sacerdoce, c’est l’amour du cœur de Jésus. En prêchant sur ce
thème, Le Père Kevin Scallon a invité les retraitants à retrouver
leur « identité sacerdotale » : « Plus que « faire », un prêtre doit
« être »…Le prêtre est présence du Christ à l’endroit où il est…
Beaucoup ont de multiples charges, mais ils doivent être prêtres
avant tout... Le prêtre est un homme qui rend Jésus Christ
présent... Ses mains qui bénissent sont les mains du Christ. »
« La prière, c’est le langage de l’Espérance »
Tout cela implique « que le curé soit un homme proche du Christ,
très proche et donc soit un homme de prière et un homme d’espérance
». Pour le prédicateur, les deux vont de pair, et de citer Benoît
XVI : « la prière, c’est le langage de l’Espérance ».
En invitant les prêtres à recevoir une nouvelle effusion de l’Esprit
Saint, il les a exhortés à « convertir leur sacerdoce » pour ne pas
mettre de limite à ce que Jésus veut accomplir en eux.
« Ces « paroles de feu » ont conduit les participants à une démarche
de repentance et de réconciliation. « Il était touchant de voir ces
prêtres se confesser mutuellement tout au long de la deuxième
journée de la récollection, de se pardonner les uns les autres au
nom de Jésus Christ. Ils ont fait l’expérience d’une grande
fraternité sacerdotale avant de vivre un temps de guérison (le
sacrement des malades a été donné durant la messe du mercredi) et,
avec l’effusion de l’Esprit, de renouvellement des promesses
sacerdotales », rapporte Denis Jagou.
Tout invite les prêtres à recentrer leur vie sur le Saint Sacrement,
à être comme le rappelait Sister Briege « des prêtres eucharistiques
». L’adoration perpétuelle est assurée tout au long de la retraite.
A entendre Cathy Brenti, de la Communauté des Béatitudes, beaucoup
de détails de cet événement « prophétique » sont la « signature de
Dieu ». Cette retraite est partie d’une « distraction », de ces
distractions dont le Père Emiliano Tardif disait qu’elles étaient «
la manière de parler de l’Esprit Saint », raconte-t-elle. A la fin
d’une retraite sacerdotale, Cathy Brenti a demandé à Sister Briege
et au Père Kevin : « Bien sûr, vous avez déjà prêché à Ars ». A son
étonnement, la réponse est négative… L’idée du projet est née.
Ensuite se sont enchaînées ce qu’elle appelle des « coïncidences de
la Providence ».
Pour des raisons pratiques, continue Cathy Brenti, il a fallu
reporter deux fois la date de cette retraite qui se trouve
correspondre aujourd’hui avec la fin de l’année de l’Eucharistie, et
avec le centenaire de la béatification du Curé d’Ars et pratiquement
avec la reconnaissance officielle du renouveau charismatique
catholique.
Des prêtres d’horizons très différents
Elle interroge : « Qui aurait imaginé un tel événement, il y a 20
ans, à l’époque où la communauté des Béatitudes organisait à Ars ces
grandes sessions charismatiques qui laisseraient presque
nostalgiques les anciens de la communauté revenus pour participer à
cette retraite? Qui aurait imaginé une telle démonstration d’unité.
Ce rassemblement réunit dans un même lieu des prêtres d’horizons
très différents. Des Dominicains, des Jésuites, des Franciscains,
les communautés nouvelles et de nombreux curés diocésains dans une
même démarche de prière dite « charismatique ». « C’est ça, la
beauté de l’Eglise , s’exclame Cathy Brenti. Certains – et de tous
âges - ont même reçu pour la première fois l’effusion de l’Esprit ».
Elle précise que toutes les instances ecclésiales ont bien accueilli
cette retraite, à commencer par Mgr Csaba Ternyak, secrétaire de la
Congrégation romaine pour le Clergé qui a présidé la célébration
eucharistique de ce vendredi 30 septembre. Les vêpres de mardi ont
été présidées par Mgr Renato Boccardo, responsable des voyages
pontificaux.
Et face aux craintes d’afficher la dimension « charismatique » sur
les tracts, les encouragements n’ont pas manqué. « Qu’est-ce qui est
le plus important » ? confiait à peu près en ces termes à Cathy
Brenti lors de la préparation, le président du Conseil pontifical
pour les Laïcs, Mgr Stanislas Rylko : « Que les prêtres qui
viendront puissent accueillir la grâce qui vous a été donnée, à la
communauté des Béatitudes et au Renouveau. Vous avez reçu une grâce,
vous avez des prêtres dans votre communauté qui l’ont reçue. Ils
seront un témoignage pour les autres ».
Contemplatifs et missionnaires avec Thérèse de Lisieux
Dans son homélie, mercredi 28 septembre, Mgr Rylko n’a pas manqué de
présenter le renouveau charismatique comme une « ressource pour le
sacerdoce, une école de communion et de mission, une nouvelle voie
pour l’évangélisation ».
Cette retraite a également reçu le soutien de la conférence des
évêques de France en la personne de Mgr Ricard venu présider la
première célébration eucharistique, souligne Denis Jagou. Le
cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon et primat des Gaules,
est venu se joindre aux évêques présents. Il est difficile de
compter le nombre d’évêques qui seront passés. Ils sont à peu près
15 à chaque messe. Le cardinal Peter Kodwao Appiah Turkson,
archevêque de Cape Coast, a présidé la messe de jeudi 29 septembre.
A noter également la présence d’une invitée surprise : les reliques
de Sainte Thérèse ont été apportées par Mgr Guy Gaucher à l’occasion
de son carrefour, mercredi 28 septembre, sur ce docteur de l’Eglise,
modèle sacerdotal et patronne des missions, sur le thème :
"Contemplatifs et missionnaires avec Thérèse de Lisieux, docteur de
l'Eglise".
Denis Jagou précise que « ce rassemblement est une expérience de
communion pour les prêtres mais aussi pour les communautés
contemplatives de France qui ont été sollicitées pour porter dans la
prière ce temps de renouvellement : leur liste est affichée au fond
de l’église. En moyenne, 8 communautés de sœurs contemplatives
(Bénédictine, Carmélites, Clarisses… ) portent la retraite dans la
prière chaque jour de cette semaine. On compte aussi la
participation de la Chartreuse du diocèse de Belley Ars. Mais la
retraite s’appuie aussi sur la participation par la prière des
auditeurs de Radio Espérance, car elle est retransmise intégralement
en direct. A ce sujet, un témoignage a été donné devant les
retraitants. Un auditeur qui ne s’était pas confessé depuis
longtemps s’est décidé, en voyant l’exemple de repentance des
prêtres, à venir sur place et a demandé un Père pour recevoir le
sacrement de réconciliation ».
Devant tant d’encouragements, face à un tel signe de communion,
quand Cathy Brenti se souvient de sa « distraction », elle ne peut
s’empêcher de dire avec sourire et spontanéité : « ça, c’était
vraiment du Saint Esprit. »
La consécration du sacerdoce à Marie
Les prêtres ont également vécu jeudi une célébration eucharistique
en commémoration de l’institution de la Cène, et vendredi un
pèlerinage à Paray le Monial, au sanctuaire du Cœur du Christ, pour
une journée consacrée à la réparation. La retraite se conclura
demain, en la fête de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la
Sainte Face, par l’eucharistie - une messe d’envoi en mission, le
jour de la fête de la Patronne des Missions - , et la consécration
du sacerdoce à Marie.
« En faisant cette expérience d’un renouvellement sacerdotal, dans
cette rencontre fraternelle, les prêtres entrent plus avant dans le
mystère de l’Eglise. Assemblés dans la basilique, ils évoquent
l’image des apôtres montés dans la chambre haute, dans l’attente
d’une nouvelle Pentecôte. La joie et l’espérance ont pris le pas sur
les soucis…. Là, sauraient-ils encore nous dire s’il sont prêtres ou
curés ? », conclut Denis Jagou.
ZF05093005
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
Etats-Unis : Nomination de J.
Roberts à la présidence de la Cour suprême
ROME, Vendredi 30 septembre 2005 (ZENIT.org)
– Aux Etats-Unis, le sénat a confirmé la nomination du juge John
Roberts à la tête de la Cour suprême. Avec 78 voix pour et seulement
22 contre, c'est beaucoup plus de voix en sa faveur que prévu,
indique la revue de presse de la fondation Jérôme Lejeune (www.genethique.org).
Le juge Roberts a donc réussi à convaincre non seulement les
Républicains, qui lui étaient acquis, mais aussi plus de la moitié
des Démocrates.
Pendant son audition devant la commission de la Justice du Sénat,
durant deux jours, il a répondu avec souplesse aux questions
épineuses, en rassurant les uns et les autres. Il a certifié qu'il
n'avait pas de programme, et qu'il n'était pas un idéologue, malgré
ses positions antérieures contre l'avortement.
Certains démocrates ne sont toutefois par convaincus par cette
attitude, et se méfient de ce plus jeune président de la Cour
suprême depuis deux siècles. A 50 ans, et nommé à vie, il peut
influencer durablement la société américaine et en particulier
remettre en cause la loi sur l'avortement aux Etats-Unis.
Le juge Roberts avait été précédemment nommé à la Cour suprême en
remplacement de la juge Sandra O'Connor, ce poste est donc à nouveau
libre. On parle de la nomination possible de Harriet Miers, 60 ans,
conseillère juridique de la Maison Blanche, ou d'un juge d'origine
hispanique. En attendant son successeur, Sandra O'Connor reprendra
son poste lors de la rentrée judiciaire, dès lundi.
ZF05093006
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
Le Christ de Rio sur la façade de
la cathédrale Notre Dame de Paris
L’Eglise de Paris à l’heure du Brésil
ROME, Vendredi 30 septembre 2005 (ZENIT.org)
– Le Christ de Rio de Janeiro apparaîtra sur la façade de Notre Dame
de Paris, de la tombée de la nuit à l’orée du jour, samedi 1er
Octobre : un événement sans précédent dû à l’artiste Agnès Winter (catholique-paris.cef.fr).
Une messe à l’intention du Brésil et de la France sera célébrée le
même jour à 18 heures 30 par l’archevêque de Paris et l’évêque
auxiliaire de Rio de Janeiro, invité à cette occasion : c’est en
effet à la fois la « Nuit Blanche » à Paris et l’année du Brésil en
France.
Dans le cadre de l’année du Brésil en France, la projection de cette
illumination sur la façade de la cathédrale Notre Dame de Paris est
un hommage à la joie de vivre et à la générosité des habitants de ce
pays. Symbole franco-brésilien par excellence, il célèbre aussi les
liens unissant les cultures des deux pays.
La statue du Christ Rédempteur sur le Mont Corcovado, inaugurée le
12 octobre 1931, a été conçue et réalisée par l’ingénieur brésilien
Heitor da Silva Costa et le sculpteur français d’origine polonaise
Paul Landowski.
En octobre 2003, cette statue a été illuminée en bleu en faveur de
la Paix dans le Monde par l’artiste Agnès Winter, et de nouveau le
1er Mars 2005, date anniversaire des 440 ans de la ville de Rio de
Janeiro.
Une messe sera célébrée à 18 h 30, à l’intention de la France et du
Brésil, par l’archevêque de Paris et l’évêque auxiliaire de Rio de
Janeiro, avec la participation du « Turicum Ensemble » et de la
Maîtrise de Notre-Dame de Paris.
A 21 h, le Turicum Ensemble donnera un concert de musique baroque
brésilienne, avec au programme la « Missa Pequena » et le « Credo
abreviado » de José Maurício Nunes Garcia (1763-1830), en
partenariat avec « Le Couvent - Centre International des Chemins du
Baroque » de Sarrebourg, et avec le soutien de la Fondation BNP
Paribas.
La soirée prévoit aussi, à 22h 30 , la projection du documentaire «
Cristo Redentor », par Maria Isabel Noronha , arrière petite fille
de l’ingénieur Heitor da Silva Costa.
Ce projet est soutenu par le commissariat général de l’année du
Brésil en France et il a reçu l’appui de la ville de Rio de Janeiro
et le soutien de Madame Bethy Lagardère. Il est associé à la « Nuit
Blanche ».
ZF05093007
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
|
|
|
 |
|
|
| |
Spécial Chine
Le card. Etchegaray souhaite
unité et dialogue entre les chrétiens de Chine
ROME, Vendredi 30 septembre 2005 (ZENIT.org)
– Le cardinal Etchegaray appelle de ses vœux une plus grande
unité et le développement d’un dialogue en profondeur entre les
différentes dénominations chrétiennes de Chine, indique «
Eglises d’Asie », l’agence des Missions étrangères de Paris
(EDA, eglasie.mepasie.org),
dans son édition du 1er octobre.
Une édition dont nous reproduisons trois articles, à la veille
de l’ouverture du synode auquel quatre évêques chinois ont été
invités par Benoît XVI, et pour ce cinquième anniversaire de la
canonisation des premiers martyrs de Chine, le 1er octobre 2005.
Du 16 au 20 septembre dernier, le collège bénédictin
Saint-Anselme, à Rome, accueillait la cinquième Conférence
œcuménique européenne pour la Chine (1). La conférence,
organisée par la branche allemande du Comité œcuménique pour la
Chine, a réuni 150 participants, venus d’Europe et de Chine et
représentants diverses confessions chrétiennes. Parmi les
personnalités qui ont pris la parole lors de la conférence se
trouvait le cardinal Roger Etchegaray, président émérite du
Conseil pontifical ‘Justice et paix’. Le cardinal français, qui
s’est rendu à plusieurs reprises en Chine populaire au cours de
ces vingt dernières années, a appelé les chrétiens de Chine et
leurs Eglises à « un dialogue plus profond et empreint d’une
plus grande confiance ». Il y a urgence, dans la Chine
d’aujourd’hui, a-t-il souligné, à développer ce dialogue car «
la crédibilité » du témoignage que la minorité chrétienne de
Chine rend au Christ « dépend de la visibilité de son unité ».
Le cardinal a souligné combien, aujourd’hui, l’œcuménisme était
embryonnaire en Chine. Selon lui, c’est ce qui le rend plus
urgent, chaque Eglise étant par ailleurs fragilisée par ses
propres divisions internes et devant faire face seule à un Etat
puissant. Aujourd’hui, pour la première fois de leur histoire,
les Eglises en Chine, a-t-il dit, « ne dépendent que
d’elles-mêmes pour affronter un pouvoir séculier (…). Ces
Eglises chrétiennes vont avoir à prendre le chemin d’un dialogue
laborieux, mais nécessaire, dans un pays où l’intégration des
religions à l’ordre politique remonte à l’ère impériale du
‘mandat céleste’ ». Un dialogue qui n’est pas encouragé par la
classification des religions retenue par l’Etat, où catholicisme
et protestantisme apparaissent comme deux religions différentes
et où l’orthodoxie n’apparaît même pas.
Pour le cardinal, l’urgence de ce dialogue œcuménique n’est pas
dictée par le seul face-à-face avec le pouvoir politique. La
société « est tiraillée » entre « un matérialisme galopant » et
« une idéologie claudicante », constate-t-il, ajoutant que «
cela ne laisse pas beaucoup d’espace pour vivre une vie de foi
». Dans ce contexte, « la crédibilité du témoignage donné par
les Eglises, en Chine plus qu’ailleurs, dépend de l’unité
visible témoignée par elles ». La Chine attend le dévoilement de
l’Eglise du Christ, dont les membres témoignent humblement et
ensemble d’un même amour du Seigneur pour son peuple, a continué
le cardinal. Pour lui, les dirigeants politiques et religieux
chinois de même que les chrétiens concernés par l’annonce de
l’Evangile en Chine ne peuvent faire l’économie de deux
questions : « Dans quelle mesure le christianisme est-il
réellement entré en Chine ? Dans quelle mesure la Chine a-t-elle
rejoint le concert mondial ? »
A propos des Eglises protestantes en Chine, le cardinal
Etchegaray a déclaré regretter que leur réalité ne soit pas plus
reflétée par les médias. Par le nombre, les protestants sont
plus nombreux que les catholiques, a-t-il noté (2), et, en 1981,
les anglicans, les luthériens, les méthodistes et d’autres
communautés ont officiellement déclaré former une seule
dénomination. Même si cette unité officielle porte en elle le
risque que « chaque tradition confessionnelle perde son
caractère unique », il est de la plus grande importance pour la
mission d’évangélisation que les Eglises chrétiennes en Chine
s’engagent dans un dialogue en confiance, a-t-il souligné.
La participation des chrétiens de Chine populaire à cette
conférence a été marquée par plusieurs absences. Invités par les
organisateurs allemands de la conférence, deux évêques
catholiques n’ont pu venir, faute d’être autorisés à quitter le
territoire chinois (3). De même, une délégation du Conseil
chrétien de Chine, qui réunit les Eglises protestantes «
officielles », s’est vue elle aussi refuser une autorisation de
sortie. Pour les organisateurs de la conférence, ces
interdictions sont le signe de la « division qui persiste entre
la politique et la réalité des Eglises en Chine ».
(1) La première Conférence œcuménique a été organisée en 1991.
Elle a eu lieu en Allemagne, les suivantes prenant place
successivement à Londres, en Norvège et en Irlande. L’origine de
ces échanges entre catholiques et protestants d’Europe et de
Chine remonte au Colloque international de Louvain, en Belgique,
en septembre 1974. L’initiative en avait été prise par le groupe
d’étude du marxisme chinois des Eglises luthériennes basé à
Genève et le Centre catholique d’études sociologiques Pro Mundi
Vita de Louvain.
(2) En 2000, selon des statistiques publiées par les autorités
chinoises, les catholiques étaient quatre millions et les
protestants dix millions. Depuis, des responsables
gouvernementaux ont dit que les catholiques étaient cinq
millions. En novembre 2004, le Centre d’études du Saint-Esprit,
du diocèse catholique de Hongkong, estimait que le nombre des
catholiques en Chine était de douze millions. Par ailleurs,
selon les structures officielles du protestantisme chinois, les
protestants sont seize millions en Chine.
(3) Voir EDA 425
ZF05093008
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
Des prêtres catholiques
chinois à l’audience du pape Benoît XVI
Aucune inquiétude à leur retour en Chine
ROME, Vendredi 30 septembre 2005 (ZENIT.org)
– Des prêtres catholiques, qui avaient eu l’heureuse surprise de
prendre part à une audience papa-le à Rome, n’ont pas été
réprimandés par les autorités à leur retour à Pékin indique «
Eglises d’Asie », l’agence des Missions étrangères de Paris (EDA,
eglasie.mepasie.org),
dans son édition du 1er octobre.
En voyage d’études durant trois semaines cet été en Europe, une
délégation de vingt-deux directeurs de séminaires et directeurs
spirituels a eu l’heureuse surprise, le 3 août dernier, de
prendre part à une audience générale au Vatican. Saluée par le
pape Benoît XVI, la délégation avait pris place, parmi plusieurs
milliers de fidèles, dans le grand hall Paul VI. De retour
quelques jours plus tard à Pékin, les prêtres de la délégation
ont rendu compte aux autorités chinoises de l’ensemble de leur
séjour européen et ils ont eu la bonne surprise de ne pas voir
ces dernières se formaliser outre mesure de leur rencontre avec
le pape.
Pour les vingt-deux prêtres (cinq recteurs, six vice-recteurs et
onze directeurs spirituels), responsables de grands séminaires à
Pékin, Chengdu, Jilin, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Wuhan,
Xi’an et ailleurs, cette visite en Europe, organisée par les
moines bénédictins des monastères allemands de Saint-Ottilien,
était l’occasion de se familiariser avec la spiritualité
bénédictine ainsi que de se former au contact de différents
lieux d’Eglise en Europe, à Münsterschwarzach, en Allemagne, à
Camaldoli, en Italie, ainsi qu’à Fiecht, en Autriche, Cologne,
en Allemagne et Florence, en Italie. L’escale romaine de leur
périple ne prévoyait pas de participation à l’audience générale
que le pape tient les mercredi lorsqu’il est au Vatican. En ce
début du mois d’août, la présence du pape à Rome était
d’ailleurs improbable.
La surprise fut donc grande pour les vingt-deux prêtres
lorsqu’il leur fut annoncé que Benoît XVI se trouvait à Rome le
mercredi 3 août et qu’ils pouvaient assister à l’audience.
Contacté le 31 août dernier par l’agence Ucanews (1), le P.
Zheng Xuebin, recteur du séminaire de Pékin, témoigne de ce
moment : « Nous avions pris place parmi les milliers de
catholiques et de personnes présentes dans le grand hall Paul VI.
Nous étions assis au premier rang, près de l’allée centrale.
Plusieurs d’entre nous – dont moi – avons pu serrer la main du
Saint-Père tandis qu’il descendait l’allée pour gagner la scène.
Nous n’avons pas eu d’entretien particulier, ni rencontre
spéciale avec lui. » En dépit de la brièveté de l’événement, le
P. Zheng garde un souvenir intense, « inexprimable avec des mots
», de sa « rencontre – la première de [sa] vie – avec le
représentant du Christ sur terre ». Lorsque, peu après, Benoît
XVI a salué la présence des prêtres chinois, ceux-ci se sont
levés et ont entonné l’hymne en mandarin « Le grand pape ».
Selon le témoignage d’un des vingt-deux prêtres, « certains
d’entre nous ont regretté de ne pas oser monter sur la scène
pour saluer le pape et baiser son anneau », mais ont compris que
la solennité des audiences générales ne permettait pas un tel
geste.
Selon le témoignage de prêtres de la délégation, au moment même
de l’audience, ils ont bien réalisé qu’ils encouraient des
sanctions disciplinaires une fois de retour en Chine pour avoir
rencontré le pape sans en avoir référé au préalable, mais «
cette expérience inoubliable », selon l’expression de l’un
d’eux, valait la peine de courir ce risque. De retour à Pékin,
les prêtres ont effectivement été réunis au grand séminaire
national de Pékin. Là, le 8 août, ils ont raconté leur séjour
européen à trois hauts responsables de l’Administration d’Etat
pour les Affaires religieuses, ainsi qu’à des responsables de
l’Association patriotique et de la Conférence des évêques «
officiels ».
A l’agence Ucanews, plusieurs prêtres se sont exprimés sur cette
rencontre du 8 août, à condition que leur anonymat soit
préservé. L’un d’eux rapporte ainsi qu’« un officiel nous a
rappelé l’importance d’observer ‘la discipline’ lors des voyages
à l’étranger ». Cet officiel a continué en disant que la
délégation représentait l’Eglise de Chine et que, par
conséquent, le groupe avait voyagé « selon le programme approuvé
(au préalable) par les autorités de l’Eglise et aurait dû se
montrer prudent quant à la participation à des événements qui
n’étaient pas approuvés ». Toujours selon ce prêtre, l’officiel
a ajouté que le groupe aurait dû au minimum informer à l’avance
Pékin ou l’ambassade de la République populaire de Chine auprès
de l’Italie de la participation à l’audience papale. Selon un
autre prêtre, ce même officiel a dit que de tels gestes ne
favorisaient pas – au contraire – l’amélioration des relations
entre la Chine et le Saint-Siège. Mais, à la grande surprise des
prêtres de la délégation, les critiques des autorités chinoises
se sont arrêtées là ; il ne leur a pas été demandé de faire leur
autocritique et un des officiels leur a même déclaré apprécier
pleinement leurs sentiments religieux en tant que catholiques et
leur vif désir de rencontrer le pape. Le responsable de la
section ‘christianisme’ de l’Administration d’Etat pour les
Affaires religieuses a déclaré que les autorités ne prendraient
pas de sanction pour cette fois-ci et qu’à l’avenir, avant
d’entreprendre d’éventuelles visites à l’étranger, la
communication avec les organes de l’Eglise devrait être
améliorée.
A Hongkong, un observateur des questions liées à l’Eglise en
Chine a mis en garde contre la tentation de « sur-interpréter »
la présence des vingt-deux prêtres à l’audience générale du 3
août, un événement qui appartient au domaine des relations entre
l’Eglise de Chine et l’Eglise universelle, et non à celui des
relations entre le Vatican et la Chine populaire. A Pékin,
Anthony Lui Bainian, vice-président de l’Association
patriotique, est allé dans le même sens, en déclarant, le 5
septembre à l’agence Ucanews : « Le pape Benoît exprimait son
amitié envers la Chine, mais cela ne signifie pas que les
relations entre le Saint-Siège et la Chine s’améliorent, tout
particulièrement du fait que les prêtres n’étaient pas [à Rome]
en tant que délégation envoyé par le gouvernement chinois. »
ZF05093009
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
Disponibilité du Saint-Siège à
mener « un dialogue constructif » avec Pékin
Par Mgr Claudio Maria Celli
ROME, Vendredi 30 septembre 2005 (ZENIT.org)
– Un haut responsable du Vatican réaffirme la disponibilité du
Saint-Siège à mener « un dialogue constructif » avec Pékin,
indique « Eglises d’Asie », l’agence des Missions étrangères de
Paris (EDA,
eglasie.mepasie.org), dans son édition du 1er octobre.
« Le Saint-Siège est disposé, demain, jour et nuit, à entamer un
dialogue constructif avec nos collègues en Chine afin de
parvenir à la normalisation. » Tels ont été les propos tenus le
20 septembre dernier à Rome par Mgr Claudio Maria Celli,
secrétaire de l’Administration du patrimoine du Saint-Siège et
haut responsable du Vatican engagé de longue date dans le
dossier de la normalisation des relations entre le Saint-Siège
et la République populaire de Chine.
« Notre objectif n’est pas seulement (de parvenir à
l’établissement) de relations diplomatiques. Les relations
diplomatiques sont faites pour le bien de l’Eglise. […] Il est
inutile d’avoir un nonce à Pékin s’il ne peut être engagé dans
la vie de l’Eglise », a précisé l’archevêque, qui a ajouté qu’on
ne pouvait parler d’« entamer » un dialogue constructif avec la
Chine dans la mesure où celui-ci a « commencé il y a plusieurs
années déjà ».
Mgr Claudio Maria Celli s’exprimait au siège de la Société du
Verbe divin (SVD), à Rome, où le supérieur général de cette
société missionnaire, le P. Antonio Pernia, lui remettait le
Prix Freinademetz au nom de son « extraordinaire » contribution
à l’amélioration de la compréhension entre les cultures et les
peuples européen et chinois. Le Prix Freinademetz reprend le nom
du P. Joseph Freinademetz (1852-1908), premier missionnaire SVD
en Chine, canonisé par Jean-Paul II en 2003 ; il est attribué à
des personnalités qui se sont distinguées pour avoir contribué à
une meilleure compréhension entre les peuples et les cultures de
la Chine et de l’Europe.
Agé de 64 ans, Mgr Claudio Maria Celli a joué un rôle-clef dans
un certain nombre de négociations sensibles pour le Vatican. En
1993, sous-secrétaire pour les Relations avec les Etats, il a
été au premier plan de la mise au point de l’Accord fondamental
signé entre le Saint-Siège et Israël. Il a aussi été très
impliqué dans les négociations entre le Saint-Siège et le
Vietnam (1). Depuis 1982, il suit le dossier chinois, recevant
discrètement à Rome de nombreux visiteurs, y compris des
personnalités telles la fille de Deng Xiaoping ou différents
responsables communistes chinois (2).
En réponse au discours prononcé par le P. Antonio Pernia et aux
différents témoignages d’amitié de personnalités, tels celui de
Mgr Jin Luxian, évêque « officiel » de Shanghai, lu sur place
par un prêtre de Shanghai, Mgr Claudio Maria Celli s’est
exprimé, en parlant « du fond du cœur ». Devant une carte de la
Chine, il a rappelé combien le pape Jean-Paul II avait à cœur
l’Eglise de Chine et se tenait constamment informé de la
situation des catholiques de Chine, par la lecture de lettres et
de rapports reçus d’évêques, de prêtres et de religieux en
Chine. Jusqu’à sa mort, a rappelé Mgr Celli, le pape lui disait
: « Je prie chaque jour pour l’Eglise en Chine. » Synthétisant
l’approche de Jean-Paul II vis-à-vis de l’Eglise de Chine, il
s’est exprimé en ces termes : « Nous devons soutenir l’Eglise
souterraine, mais nous devons aussi faciliter autant que nous le
pouvons la pleine communion avec l’autre communauté. » Mgr Celli
a ajouté qu’au plus profond, les pensées de Jean-Paul II «
allaient à la communauté souterraine, mais que, dans le même
temps, son cœur, en tant que pasteur de l’Eglise universelle,
était proche des membres de la communauté officielle ». A
chacune de ses entrevues avec le pape, a rappelé Mgr Celli,
Jean-Paul II demandait : « Quand partons-nous pour Pékin ? »,
traduisant ainsi son souci pour cette Eglise.
A propos de l’Eglise de Chine, Mgr Celli a tenu à souligner à
quel point « nous savons exactement la gloire et le témoignage
donnés par la communauté souterraine. Cela restera comme
l’aspect glorieux de la vie de l’Eglise en Chine », pour
aussitôt ajouter : « Mais, dans la communauté officielle, nous
avons (également) de très nombreux fidèles. » L’avenir permettra
d’étayer cela, a-t-il souligné : « Demain, lorsque nos archives
s’ouvriront, vous réaliserez la grandeur de l’histoire de
l’Eglise en Chine. Nous, de l’Europe, nous nous sentirons un peu
honteux et surpris. Quel témoignage de foi, de vie, l’Eglise en
Chine a donné au Christ et à nous ! »
S’agissant de l’avenir de cette Eglise, Mgr Celli a déclaré
qu’il était entre les mains de Dieu, « mais, ici, nous sommes
ouverts pour avoir ce dialogue avec nos collègues en Chine, pas
seulement pour entretenir des relations diplomatiques, mais pour
le bien de l’Eglise ». Ces vingt dernières années, avait-il
développé un peu avant, « les difficultés » ont été réelles,
mais les choses se sont améliorées. « Tous les problèmes ne sont
pas résolus. De nombreuses difficultés subsistent – de vraies
difficultés. Mais (la situation) d’aujourd’hui n’est
certainement pas celle des années 1982-1985 », a-t-il souligné,
en référence aux premiers contacts esquissés avec la Chine après
le début des réformes engagées par Deng Xiaoping.
Mgr Celli n’a pas mentionné les invitations faites par le pape
Benoît XVI à quatre évêques chinois de participer au prochain
Synode sur l’Eucharistie, pas plus que l’apparente fin de
non-recevoir exprimée par les autorités chinoises au sujet de
ces invitations (3). Quelques jours avant le 20 septembre, Ye
Xiaowen, responsable de l’Administration d’Etat des Affaires
religieuses, était en déplacement à Hongkong. Le 15 septembre,
il a qualifié l’invitation faite aux évêques chinois de « geste
amical ». Il a précisé que « le processus de négociations »
(quant à leur venue à Rome) était toujours en cours, mais il a
aussi ajouté que la santé des évêques en question ne leur
permettrait sans doute pas d’entreprendre le voyage. Enfin, il a
dit qu’il ne reconnaissait pas à Mgr Wei Jingyi de qualité
épiscopale. Mgr Wei, évêque « clandestin » de Qiqihar, est un
des quatre évêques invités par Benoît XVI.
ZF05093010
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
|
|
|
|
 |
|
|
| |
- Documents -
Intention missionnaire :
« Contribuer économiquement
à l’œuvre missionnaire »
Commentaire par Mgr Sarah
ROME, Vendredi 30 septembre
2005 (ZENIT.org)
– « Pour que, à leur
engagement fondamental dans
la prière, les fidèles
unissent l’effort de
contribuer aussi
économiquement à l’œuvre
missionnaire » : Mgr Robert
Sarah, secrétaire de la
congrégation pour
l’Evangélisation des Peuples
commente pour l’agence
vaticane
Fides cette intention de
prière missionnaire du pape
Benoît XVI pour le mois
d’octobre.
Incorporés au Christ, par le
baptême, les fidèles
chrétiens deviennent fils de
Dieu et membres du Corps du
Christ qu’est l’Eglise. Ils
sont ainsi directement
concernés par le mandat
missionnaire que l’Eglise a
reçu de son Seigneur: «
allez donc, enseignez toutes
les nations, baptisez-les au
nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit » (Mt 28, 19).
Ayant reçu la force du
Saint-Esprit, et agissant
sous son impulsion, ils sont
appelés à être les témoins
du Christ au milieu de leurs
familles, de leurs
quartiers, leurs paroisses,
leurs pays, jusqu’aux
extrémités de la terre (Act
1, 8). Le baptême les
configure au Christ et leur
donne de participer à sa !
mission évangélisatrice qui
est la mission même de
l’Eglise. Cette mission
consiste fondamentalement à
professer devant les hommes
la foi que par l’Eglise ils
ont reçue de Dieu et à
participer personnellement à
l’activité apostolique et
missionnaire du Peuple de
Dieu (cf. C.E.C. 1270).
La participation à
l’activité missionnaire de
l’Eglise se fait avant tout
par les moyens spirituels,
notamment la prière, les
sacrifices, l’effort
quotidien pour « mener une
vie digne de l’évangile du
Christ » (cf. Ph 1, 27) et
l’orientation de notre vie
vers la sainteté. A ces
moyens spirituels, il
convient cependant de
joindre soutien matériel
réel et concret, car,
immergée dans les réalités
terrestres, l’Eglise a aussi
besoin de moyens matériels
pour accomplir adéquatement
sa mission. C’est pourquoi
il est capital de souligner
ici l’importance des Œuvres
Pontificales Missionnaires
qui, à travers la collecte
des subsides au profit de la
Mission, permettent à
l’Eglise de faire face aux
nécessités matérielles et
financières inhérentes à sa
mission évangélisatrice,
surtout dans les pays des
jeunes Eglises d’Afrique,
d’Asie, d’Océanie et
d’Amérique latine, souvent
marqués par la pauvreté
matérielle et la fragilité
politique.
La contribution économique à
l’œuvre missionnaire fait
donc partie intégrante du
devoir de témoignage qui
incombe à chaque chrétien en
vertu de son engagement
baptismal. A l’exemple des
premiers chrétiens qui, mus
par la foi au Ressuscité et
conscients d’être membres
d’un même Corps, vendaient
leurs terres et leurs biens
et en partageaient le prix
entre tous d’après le besoin
de chacun (cf. Act 2, 42),
les chrétiens d’aujourd’hui
sont invités à avoir le même
élan du cœur et la même
générosité pour donner à
l’Eglise, même de leur
pauvreté et indigence, ce
dont elle a besoin pour
répondre à sa vocation
missionnaire.
En ce mois du Rosaire et à
la fin de cette Année
eucharistique,
puissions-nous avoir la même
foi, le même amour et la
même disponibilité que la
Vierge Marie pour accueillir
le Verbe de Vie et le
partager avec tous nos
frères et sœurs qui
cherchent le salut qui vient
de Dieu.
+ Robert Sarah
ZF05093011
Je souhaite envoyer cette
information à un ami
TOP
----------------------------------------
Pour offrir un abonnement à
Zenit, en cadeau, cliquez
sur :
http://www.zenit.org/french/cadeau.html
----------------------------------------
|
|
|
|