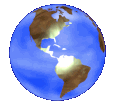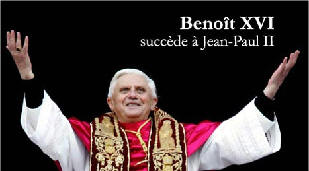|
Rome
Media: «
Réseaux de communication, de communion et de coopération »
Thème de la Journée mondiale 2006 des media
ROME, Jeudi 29 septembre 2005 (ZENIT.org)
– « Les media: réseaux de communication, de communion et de
coopération » : c’est le thème choisi par Benoît XVI pour son
message pour la 40e Journée mondiale des communications sociales
2006. Le texte du message est traditionnellement publié en la fête
du saint patron des journalistes, saint François de Sales, le 24
janvier.
Cette publication laissera ainsi aux conférences épiscopales, aux
services diocésains et aux organisations qui s’occupent de
communication sociale, le temps suffisant pour préparer la
documentation nécessaire pour cette célébration au niveau national
et local.
Un communiqué du Conseil pontifical pour les Communications sociales
rapporte ce commentaire du président de ce dicastère, l’archevêque
des Etats-Unis, Mgr John P. Foley. Ce Conseil pontifical est en
effet chargé de préparer le matériel d’étude, de liturgie sur ce
thème pour les conférences épiscopales du monde.
« Ce premier thème voulu par le Saint-Père Benoît XVI,
explique-t-il, indique combien il apprécie la capacité des mass
media non seulement à faire connaître les informations nécessaires,
mais aussi à promouvoir une coopération fructueuse ».
La Journée mondiale des Communications sociales est la seule
célébration mondiale instituée par le concile Vatican II, dans son
décret sur les media, « Intermirifica », de 1963.
Elle est fixée, dans la plus grande partie des pays, selon la
recommandation des évêques, au dimanche précédant la Pentecôte,
donc, en 2006, le 28 mai.
L’annonce du thème est donné d’habitude ce 29 septembre, en la fête
des saints Archanges Michel, Gabriel et Raphaël, saint Gabriel ayant
été choisi comme le saint patron de ceux qui travaillent à la radio.
ZF05092901
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
Relancer la
vie monastique au IIIe millénaire
Assemblée de la Congrégation pour la Vie consacrée
ROME, Jeudi 29 septembre 2005 (ZENIT.org)
– Le pape Benoît XVI invite les consacrés du monde à relire avec lui
les orientations données par le concile dans le décret « Perfectae
caritatis », et avant tout la « norme ultime », la « norme suprême »
qui est de « suivre le Christ ». Le pape invite en particulier à «
relancer la vie monastique » au IIIe millénaire.
Le pape a en effet adressé un message à Mgr Franc Rodé, préfet de la
Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de
vie apostolique, à l’occasion de l’assemblée plénière de ce
dicastère, et du 40e anniversaire du décret conciliaire. Ce message,
publié aujourd’hui en italien par la salle de presse du Saint-Siège
est en date du 27 septembre, en la mémoire liturgique de saint
Vincent de Paul.
Le pape exprime aux membres de cette congrégation romaine à la fois
sa « gratitude » et sa « joie » : « gratitude parce qu’avec moi vous
partagez l’attention pour les personnes consacrées et leur service ;
la joie parce qu’à travers vous je sais que je m’adresse au monde
des femmes et des hommes consacrés qui suivent le Christ sur le
chemin des conseils évangéliques et du respectif charisme
particulier suggéré par l’Esprit ».
Benoît XVI rappelle en effet que « l’histoire de l’Eglise est
marquée par les interventions de l’Esprit Saint, qui ne l’a pas
seulement enrichie des dons de sagesse, de prophétie, de sainteté,
mais l’a dotée de formes toujours nouvelles de vie évangélique à
travers l’œuvre de fondateurs et de fondatrices qui ont transmis
leur charisme à une famille de fils et de filles spirituelles. Grâce
à cela, aujourd’hui, dans les monastères et dans les centres de
spiritualité, moines, religieux et personnes consacrées offrent aux
fidèles des oasis de contemplation et des écoles de prière,
d’éducation à la foi, et d’accompagnement spirituel. Mais surtout,
ils continuent la grande œuvre d’évangélisation et de témoignage sur
tous les continents, jusqu’aux avant-postes de la foi, avec
générosité et souvent avec le sacrifice de leur vie jusqu’au martyre
».
Et de préciser : « Beaucoup d’entre eux se consacrent entièrement à
la catéchèse, à l’éducation, à l’enseignement, à la promotion de la
culture, au ministère de la communication. Ils sont aux côtés des
jeunes et de leurs familles, des pauvres, des personnes âgées, des
malades, des personnes seules. Il n’y a pas de milieu humain et
ecclésial où ils ne soient présents, souvent de façon silencieuse,
mais toujours de façon concrète et créative, comme une continuation
de la présence de Jésus qui passait en faisant du bien à tous (cf.
Ac 10, 38) ».
« L’Eglise, insiste le pape, est reconnaissante pour le témoignage
de fidélité et de sainteté donnée par tant de membres des Instituts
de vie consacrée, pour la prière de louange et d’intercession
incessante qui s’élève de leurs communautés, pour leur vie dépensée
au service du peuple de Dieu ».
Surtout, le pape mentionne le 40e anniversaire du décret conciliaire
sur le renouveau de la vie religieuse, « Perfectae caritatis », et
en propose une relecture en trois points.
« Je souhaite, dit-il, que les indications fondamentales offertes
alors par les Pères conciliaires pour la marche de la vie consacrée
continuent à être aujourd’hui aussi une source d’inspiration pour
ceux qui engagent leur existence au service du Royaume de Dieu. Je
me réfère avant tout à celle que le décret Perfectae caritatis
qualifie de « la norme ultime de la vie religieuse », la « norme
suprême de la vie religieuse », c’est-à-dire la « suite du Christ ».
Il ne peut y avoir de reprise authentique de la vie religieuse sinon
en cherchant à mener une existence pleinement évangélique, sans rien
placer avant l’unique Amour, mais en trouvant dans le Christ et dans
sa Parole l’essence la plus profonde de tout charisme du fondateur
ou de la fondatrice ».
Benoît XVI continue sa lecture du concile en disant : « Une autre
indication de fond que le concile a donnée est celle du don de soi à
ses frères, généreux et créatif, sans jamais céder à la tentation du
repliement sur soi, sans jamais s’attarder sur le « déjà fait »,
sans jamais tomber dans le pessimisme ou la lassitude. Le feu de
l’amour que le Saint-Esprit infuse dans les cœurs pousse à
s’interroger constamment sur les besoins de l’humanité, et sur la
façon d’y répondre, en sachant bien que seul qui reconnaît et vit la
primauté de Dieu peut réellement répondre aux véritables besoins de
l’homme, image de Dieu ».
Parmi les consignes des pères du Concile, le pape relevait aussi «
l’engagement que la personne consacrée doit mettre à cultiver une
vie de communion sincère (cf. n. 15), non seulement à l’intérieur
des fraternités singulières, mais avec toute l’Eglise, parce que les
charismes doivent être gardés, approfondis, et développés
constamment, « en harmonie avec le Corps du Christ en perpétuelle
croissance » (Mutuae relationes, n. 11) ».
L’amour de l’Eglise tout entière
Le pape ne pouvait pas ne pas mentionner les « difficultés dans la
vie consacrée d’aujourd’hui comme dans les autres secteurs de la vie
de l’Eglise », mais il choisissait plutôt que de les « énumérer »,
de « confirmer à tous les consacrés et les consacrées la proximité,
la sollicitude, l’amour de l’Eglise tout entière ».
« Au début du IIIe millénaire, constatait Benoît XVI, la vie
consacrée a devant elle des défis formidables, qu’elle ne peut
affronter qu’en communion avec tout le Peuple de Dieu, et avec ses
pasteurs et avec le peuple des fidèles. C’est dans ce contexte que
s’inscrit l’attention de la congrégation pour les Instituts de vie
consacrée et les sociétés de vie apostolique, au cours de cette
plénière qui affronte trois thématiques bien précises ».
A côté de la vie monastique, le pape mentionnait tout d’abord
l’exercice de l’autorité et faisait observer : « Il s’agit d’un
service nécessaire et précieux, pour assurer une vie authentiquement
fraternelle, à la recherche de la volonté de Dieu. En réalité c’est
le Seigneur ressuscité lui-même, nouvellement présent au milieu de
frères et sœurs réunis en son nom (cf. Perfectae caritatis, 15), qui
indique le chemin à parcourir ».
« Ce n’est que si le supérieur lui-même vit dans l’obéissance au
Christ et en sincère observance de la règle, que les membres de la
communauté peuvent clairement voir que leur obéissance au supérieur
non seulement n’est pas contraire à la liberté des enfants de Dieu,
mais fait mûrir dans la conformité au Christ obéissant au Père »,
souligne le pape.
Pour ce qui est ensuite des « critères de discernement et
d’approbation de nouvelles formes de vie consacrée », le pape cite
la constitution conciliaire Lumen Gentium (n. 12) en recommandant
aux membres de la congrégation de ne « pas oublier que votre travail
précieux et délicat doit se faire dans un contexte de gratitude à
Dieu qui, aujourd’hui aussi, continue d’enrichir son Eglise de
charismes toujours nouveaux, avec la créativité et la générosité de
son Esprit ».
« Le troisième thème que vous affrontez concerne la vie monastique,
souligne le pape, que l’on sait bon connaisseur de la vie monastique
ne particulier bénédictine. En partant de situations contingentes,
qui demandent cependant des interventions sages et incisifs, votre
regard entend embrasser le vaste horizon de cette réalité qui a eu
et conserve une telle signification dans l’histoire de l’Eglise.
Vous cherchez les voies opportunes pour relancer dans ce nouveau
millénaire l’expérience monastique dont l’Eglise a aussi besoin
aujourd’hui, parce qu’elle reconnaît en elle le témoignage éloquent
de la primauté de Dieu, constamment loué, adoré et servi, aimé de
tout l’esprit, de toute l’âme et de tout le cœur (cf. Mt 22,37) ».
ZF05092902
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
Serbie : Le
président Tadic invite Benoît XVI
ROME, Jeudi 29 septembre 2005 (ZENIT.org)
– Benoît XVI espère qu’une visite en Serbie puisse se réaliser à
l’avenir, a indiqué ce matin le porte-parole du Saint-Siège, M.
Joaquin Navarro Valls.
Le pape Benoît XVI a reçu ce matin en audience au Vatican le
président de la République de Serbie, M. Boris Tadic, et sa suite.
Le directeur de la salle de presse a déclaré à l’issue de cette
audience : « Le président Tadic a invité le pape à se rendre en
visite dans la République de Serbie. En le remerciant de son
invitation, Benoît XVI a exprimé le vœu que cette visite puisse se
réaliser à l’avenir ».
Il précisait : « Au cours de cette rencontre cordiale, qui a duré 25
minutes, le président Tadic a évoqué pour le pape la situation
actuelle de la République de Serbie ».
« L’entretien a été centré en particulier sur la nécessité de
l’éducation des jeunes aux valeurs surtout dans le cadre de l’école
», ajoutait M. Navarro Valls.
ZF05092903
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
Mexique :
Priorité aux pauvres, aux femmes, aux jeunes
4e message de Benoît XVI
ROME, Jeudi 29 septembre 2005 (ZENIT.org)
– Benoît XVI exprime aux évêques du Mexique sa sollicitude pour les
pauvres, les femmes et les jeunes.
Il a en effet reçu ce 29 septembre le 4e groupe des évêques
mexicains en visite ad limina. Ces visites ont commencé au début du
mois et s’achèveront avec l’ouverture du synode.
Le pape recommandait en effet aux pasteurs de l'Eglise au Mexique de
se montrer attentifs aux « groupes les plus faibles et aux pauvres
».
« L'Evangile, disait-il, donne la bonne réponse qui est de
promouvoir la solidarité et la paix par la justice. Pour cela,
l'Eglise doit agir efficacement en faveur de l'éradication de toute
marginalisation, en poussant les chrétiens à pratiquer la justice et
l'amour du prochain ».
Il ne suffit pas, soulignait Benoît XVI, « de faire face aux besoins
les plus urgents, mais il faut s'attaquer à la racine des problèmes
en proposant des solutions pour que les structures sociales,
politiques et économiques favorisent la solidarité ».
C’est en effet ainsi, continuait le pape, que l’Eglise se mettra «
au service de la culture, du social et de la famille, en devenant le
ciment d'un véritable développement personnel comme communautaire ».
Pour ce qui est du « génie féminin » des Mexicaines, Benoît XVI
soulignait que « l’un des enjeux actuels consiste à changer les
mentalités afin que les femmes soient traitées partout selon leur
dignité et que l'on défende leur mission fondamentale de mères et
d'éducatrices des enfants »..
Enfin, pour ce qui est de la pastorale des jeunes, le pape relevait
chez eux une « une fausse conception de l'engagement ou de la
décision qui risque de les priver de leur liberté ».
Il invitait donc les évêques à leur enseigner « que l'homme est
libre lorsqu'il s'engage sans condition en faveur de la vérité et du
bien ».
« C'est le seul moyen, affirmait Benoît XVI, de trouver le sens de
la vie et de sa valeur, de la construire positivement en plaçant le
Christ au cœur de l’existence ».
ZF05092904
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
Benoît XVI se réserve les canonisations et délègue les
béatifications
Précisions du card. Saraiva Martins
ROME, Jeudi 29 septembre 2005 (ZENIT.org)
– C’est maintenant officiel, Benoît XVI se réserve de présider les
canonisations et choisira des envoyés pour les béatifications : une
pratique déjà commencée en mai dernier.
Benoît XVI a décidé de ne pas présider lui-même les célébrations des
béatifications, pour marquer la différence entre béatification et
canonisation.
Il reprend ainsi un usage antérieur au 17 octobre 1971 : le pape
Paul VI avait voulu présider la béatification du P. Maximilien Kolbe,
martyr du nazisme, et ceci comme un signe de la solidarité avec
l’Eglise polonaise opprimée.
Une communication de la Congrégation pour les Causes des saints, en
date de ce 29 septembre, et signée par le préfet de ce dicastère, le
cardinal José Saraiva Martins, et par le secrétaire, Mgr Edward
Nowak, indique en effet les quatre dispositions prises par le pape
pour des raisons à la fois « théologiques » et « pastorales ».
La congrégation rappelle que la canonisation « attribue au
Bienheureux un culte dans toute l’Eglise » : les canonisations
seront présidées par le souverain pontife.
La béatification « qui est toujours un acte pontifical, sera
célébrée par un représentant du Saint-Père », normalement, le préfet
de la Congrégation pour les Causes des saints.
La deuxième mesure est que « le rite de béatification se déroulera
dans le diocèse qui a promu la cause du nouveau bienheureux ou un
autre lieu reconnu idoine ».
La troisième mesure prévoit qu’à la demande des évêques et des
acteurs d’une cause, et sur l’avis de la secrétairerie d’Etat, une
béatification puisse se dérouler à Rome, ce sera le cas
prochainement du cardinal Von Galen.
Enfin, la communication rappelle que le rite de béatification aura
normalement sa place au cœur d’une célébration eucharistique « à
moins que des raisons liturgiques particulières ne suggèrent qu’il
ne se tienne au cours de la célébration de la Parole ou de la
liturgie des Heures ».
En outre, un article sur ce thème a été publié par le cardinal
Saraiva Martins dans l’édition italienne de L’Osservatore Romano de
ce 29 septembre.
Le cardinal souligne en effet que ces dispositions veulent à la fois
marquer la « différence substantielle entre canonisation et
béatification », mais aussi « impliquer plus visiblement les Eglises
particulières dans les rites de béatification des serviteurs de Dieu
».
La reprise du geste de Paul VI « a pratiquement atténué aux yeux du
peuple la différence substantielle » entre canonisation et
béatification, souligne le cardinal Martins : au cours de son
pontificat, Jean-Paul II n’a pas présidé moins de 1.338
béatifications.
Or, la congrégation pour les causes des saints a souligné la
nécessité de manifester à la fois que la béatification est un acte
pontifical, qui autorise le culte local d’un serviteur de Dieu : sa
décision doit être pour cela rendue publique par une Lettre
apostolique.
C’est ainsi que, le 14 mai dernier, le cardinal Saraiva Martins a
présidé la béatification de la bienheureuse des Etats Unis, Marianne
Cope (1838-1918), et de l’espagnole Ascensión del Corazón de Jesús
(1868-1940), donnant lecture de la lettre apostolique de Benoît XVI.
Le 18 juin dernier, la béatification de trois prêtres polonais a été
présidée, à Varsovie cette fois, par le cardinal Józef Glemp, primat
de Pologne.
Le cardinal Saraiva Martins rappelle que pendant les premiers
siècles de l’Eglise, le culte des martyrs et des « confesseurs »
était laissé à l’appréciation des Eglises locales.
C’est au XIVe siècle, que le Saint-Siège a commencé à autoriser des
cultes limités à certains lieu et les serviteurs de Dieu, dont la
cause de canonisation n’avait pas abouti : c’était une première
forme de béatification.
La concession de cultes limités par le pape s’est poursuivie aussi
après l’institution de la Congrégation des rites, en 1588, par le
pape Sixte Quint.
C’est en 1983 que le pape Jean-Paul II a institué la Congrégation
pour les Causes des saints, par la constitution apostolique «
Divinus Perfectionis Magister ».
Le cardinal Saraiva Martins précise que la canonisation représente «
la suprême glorification d’un serviteur de Dieu par l’Eglise », et
revêt un caractère définitif et pour toute l’Eglise. La
béatification en revanche est la concession d’un culte public à un
serviteur de Dieu de façon limitée, en raison de ses vertus «
héroïques » ou son martyre.
Dans l’histoire récente de l’Eglise en effet, la béatification a
toujours précédé la canonisation, alors que par le passé, il y a de
rares exemples de canonisation sans béatification, comme par exemple
pour l’archevêque de Milan Charles Borromée, canonisé en 1610 sans
avoir été béatifié.
Pour ce qui est de la célébration dans les Eglises locales, la date
et le lieu seront décidés – comme jusqu’ici - en accord avec
l’évêque local, les acteurs de la cause, et la secrétairerie d’Etat.
Le rite de la béatification, précise le cardinal Martins, commencera
par « la présentation à l’assemblée des traits essentiels de la
biographie du futur bienheureux », par le ou les évêques diocésains.
Le pape nommera par conséquent son représentant, normalement le
préfet de la Congrégation romaine, chargé de donner lecture de la
Lettre apostolique par laquelle le pape « accorde au serviteur de
Dieu le titre et les honneurs de bienheureux ».
Le rite de béatification a sa place dans la célébration
eucharistique, après l’acte pénitentiel et avant le chant du Gloria,
mais pour des raisons locales », elle pourra donc désormais avoir
lieu lors d’une célébration de la parole ou de la liturgie des
heures.
La célébration liturgique en l’honneur du nouveau bienheureux sera
présidée par le représentant du pape ou l’évêque diocésain ou un des
évêques diocésains, sur décision de la secrétairerie d’Etat, et la
liturgie sera coordonnée avec un accord entre le bureau des
célébrations liturgiques pontificales, et les Eglises particulières.
Enfin, les évêques pourront demander qu’une béatification ait lieu à
Rome, avec les mêmes critères de célébration que précédemment,
souligne le cardinal Saraiva Martins.
ZF05092905
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
« Il est
heureux que les radios d’inspiration chrétienne agissent ensemble »,
affirme le card. Poupard
Colloque à Prague
ROME, Jeudi 29 septembre 2005 (ZENIT.org)
– « Il est heureux que la multitude des radios d’inspiration
chrétienne agissent ensemble, chacune selon ses propres moyens, tout
en se sentant soutenue par cet immense réseau capable de toucher les
consciences et les cœurs et, ainsi, contribuer à la paix et la
concorde entre les peuples », affirme le cardinal Poupard.
Le cardinal Paul Poupard, président du Conseil pontifical de la
Culture, a en effet tenu son intervention sur le thème : « La
culture : fondement de la citoyenneté européenne », ce 29 septembre,
à Prague, lors du XIIe colloque de la conférence européenne des
radios chrétiennes (CERC).
Le cardinal Poupard a cité, au terme de son intervention, ce matin
cette phrase de Jean Patocka, « philosophe tchèque, porte-parole de
la Charte 77, mort au sortir d’un interrogatoire policier » : «
L’Europe est un concept qui repose sur des fondements spirituels.
Aussi a-t-elle une mission à accomplir ».
Le cardinal Poupard disait vouloir exprimer ses « convictions sur
l’Europe, et plus précisément sur l’importance de la culture comme
élément fondateur d’une identité commune d’une Europe unie et
heureuse de l’être ».
Il affirmait d’emblée : « Nous le constatons, l’Europe peine
aujourd’hui à trouver sa véritable physionomie : elle est traversée
par un ensemble de crises qui témoignent de l’affaiblissement de sa
culture millénaire et l’empêchent de construire solidement une
maison commune, la « Maison Europe ». La conscience des valeurs
partagées dans la pluralité des cultures de l’ensemble des peuples
du continent, éprouve quelque mal à s’affirmer, parfois par manque
de volonté et d’engagement des citoyens, mais surtout parce que le
modèle actuellement proposé, essentiellement à travers un ensemble
de lois économiques contraignantes, n’est pas propre à soulever les
enthousiasmes ».
Le ministre de la culture de Jean-Paul II et Benoît XVI voyait par
conséquent la nécessité « d’ouvrir l’Europe à de nouveaux horizons,
d’en faire naître, avec un enthousiasme communicatif porteur d’une
ambition commune, une culture partagée dont tous se reconnaîtront à
la fois comme les fils et les créateurs ».
Il citait les propos de Jean-Paul II lors de sa visite au Parlement
européen à Strasbourg, en octobre 1988 : le pape voyait comme d’un
signe des temps, « le fait que cette partie de l’Europe, qui a
jusqu’ici tant investi dans le domaine de sa coopération économique,
soit de plus en plus intensément à la recherche de son âme, et d’un
souffle capable d’assumer sa cohésion spirituelle. »
Evoquant son précédent séjour à Prague, en 1993, le cardinal Poupard
s’exclamait : « Cette merveilleuse ville de Prague ruisselle de
beauté. Et pourtant, son nom même, associé dans nos mémoires à la
belle saison du printemps – « le printemps de Prague » –, évoque
aussi le tragique hiver de la rude confrontation dont nous avons été
témoins au siècle dernier, entre la culture et sa négation dans
l’idéologie marxiste-léniniste athée. Cette tragédie a ébranlé les
vastes territoires du centre et de l’est du continent européen
pendant la plus grande partie du XXème siècle, privant des peuples
entiers de leurs droits les plus fondamentaux, en premier lieu celui
de vivre leur religion dans la pleine liberté de leur conscience.
Dieu merci, Monsieur le Ministre, ces temps sont passés, et Prague
délivre à notre Europe trop souvent amnésique, le message d’un
humanisme né d’une culture chrétienne riche de trésors incomparables
d’architecture, de peinture et de sculpture, de musique et de
littérature, signes admirables de la fécondité emplie d’humanité du
message de l’Évangile ».
Le cardinal affirmait : « C’est notre conviction : l’humanisme issu
des béatitudes possède en lui-même une force interne qui le rend,
mieux que toute autre force éducative, capable de réunir les hommes,
les peuples et les nations dans un ensemble géographique et humain
qui réponde pleinement aux exigences du XXIe siècle. Celles-ci ne
sont autres que celles de la justice et de la paix, de la prospérité
et de la liberté, d’un monde fait pour l’homme, conscient de sa
dignité et de sa responsabilité devant Dieu et devant l’histoire ».
« Comment ne pas me référer à l’un de vos plus grands compositeurs,
Antonín Dvorák, dont la Symphonie du nouveau monde est pour nous
comme une allégorie – je n’ose pas dire une prophétie – de ce que
nous souhaitons pour notre « maison commune » ? », disait le
cardinal Poupard en évoquant ce « compositeur génial ».
Il citait Rainer Maria Rilke, « le poète autrichien né à Prague »,
l’écrivain Franz Kafka et le musicien Gustav Mahler, le
neuro-psychiâtre Sigmund Freud, et Edmund Husserl, « fondateur de la
phénoménologie, qui a tant séduit un jeune philosophe Karol Wojtyla,
devenu pape sous le nom de Jean-Paul II ! ».
« Les horizons ouverts par la « révolution de velours » ont redonné
la pleine liberté à votre peuple, et vous avez repris le destin de
votre nation entre vos mains en dissipant l’épais brouillard d’une
folle oppression, rappelait le cardinal Poupard. Mais une décennie
plus tard, nous nous interrogeons sur l’avenir à l’aube du troisième
millénaire (…). Pardonnez au Français que je suis cette allusion à
la devise de mon pays d’origine – « Liberté, égalité, fraternité »
–, je n’ignore pas pour autant celle de la République Tchèque, d’une
éloquence suggestive : « Pravda vítězí » – « la vérité gagne »,
surtout pour nous chrétiens qui professons dans le Christ le mystère
de l’amour vainqueur du mal et de la mort ».
« Chers amis de la Conférence Européenne des Radios Chrétiennes
venus à Prague à l’invitation de Radio Proglas, vous entendez réunir
les émetteurs des pays d’Europe qui partagent, à la lumière de
l’humanisme chrétien, un même regard sur le monde pour promouvoir la
démocratie, tout en favorisant l’émergence d’une conscience
européenne et la compréhension entre les peuples. C’est un vaste
programme, et il est heureux que la multitude des radios
d’inspiration chrétienne agissent ensemble, chacune selon ses
propres moyens, tout en se sentant soutenue par cet immense réseau
capable de toucher les consciences et les cœurs et, ainsi,
contribuer à la paix et la concorde entre les peuples ».
Aux radios chrétiennes d’Europe , le cardinal disait : « Comme
Président du Conseil Pontifical de la Culture, je suis heureux de
cette occasion qui m’est donnée pour vous encourager à renforcer
votre collaboration, dans la conviction de l’importance de votre
mission, même si votre audience peut vous paraître, pour certaines
d’entre-vous, sans commune mesure avec celle des grands media «
laïcs ». Face au géant Goliath, David n’a eu besoin pour libérer son
peuple, que d’une petite pierre et de sa fronde faite de ses propres
mains. Aujourd’hui, au cœur du tintamarre médiatique, vous êtes les
David de la liberté de conscience en assumant pleinement votre
mission d’informateurs et d’éducateurs, sans céder aux sirènes de
l’efficacité immédiate et de la rentabilité à tous prix ».
Et de préciser : « Dans le document Pour une pastorale de la
culture, publié à la Pentecôte 1999, le Conseil Pontifical de la
Culture souligne le rôle des moyens de communication sociale et des
technologies de l’information, et les changements culturels dus à la
mutation du langage suscitée en particulier par la télévision et les
modèles qu’elle propose (n. 9). Nous le constatons, notamment dans
le domaine de la publicité, les media se jouent des frontières et
brouillent les repères du Vrai et du Bien, et, par là, du Beau, en
hypertrophiant le désir et parfois l’instinct de l’auditeur au
détriment de sa vocation de personne libre et responsable. Le
bombardement médiatique à chaud ne favorise pas par ailleurs le
recul nécessaire à la réflexion, et transforme la perception du réel
: la réalité cède le pas à ce qui en est montré, et la répétition
soutenue d’informations choisies devient un facteur déterminant pour
créer une opinion considérée comme publique. Trop souvent, nous le
constatons, le matraquage médiatique truffé de slogans réducteurs
nuit à l’écoute d’un message spirituel et à la compréhension du
mystère de l’Église. « Silence sur l’essentiel », disait mon ami le
philosophe Jean Guitton ».
« Cette influence prépondérante des media appelle les chrétiens à
une créativité nouvelle pour rejoindre les centaines de millions de
personnes qui consacrent quotidiennement un temps important à la
radio et à la télévision. Moyens d’information et de promotion
culturelle, j’aime à le répéter, les radios chrétiennes sont aussi
des moyens de formation et d’évangélisation, pour nombre de ceux qui
n’ont guère d’occasions d’entrer en contact avec l’Église et
l’Évangile, dans nos cultures sécularisées.
Pour tenter de répondre maintenant plus directement à la proposition
que vous m’avez faite de réfléchir avec vous à La culture, fondement
de la citoyenneté européenne, je voudrais rapidement évoquer trois
points : 1) la citoyenneté est fille de la culture, 2) elle est
aussi responsable de sa culture, 3) elle le fait dans une
authentique volonté d’éduquer l’homme, tout l’homme et tous les
hommes ».
Le cardinal concluait : « J’ai tenu à plusieurs reprises à souligner
le rôle indispensable et tout à fait considérable, bien digne de
susciter votre enthousiasme, des radios chrétiennes, non seulement
dans vos programmes de diffusion, mais aussi dans votre dialogue
avec les autres moyens de communication sociale. J’aime à le répéter
: si avec les autres, vous donnez bien évidemment de l’information,
votre vocation propre est, à travers l’information, de donner une
formation ».
Il achevait sur cette évocation de l’un des « pères de l’Europe »,
Robert Schuman, auquel il a consacré l’une de ses conférences de
carême, à Notre-Dame de Paris, le 9 mars 2003 : « Inspiré par sa foi
chrétienne et nourri de l'expérience d'une longévité parlementaire
exceptionnelle, Robert Schuman sut incarner au cœur des contingences
politiques son idéal évangélique au service des hommes… A un
demi-siècle de distance, permettez-moi de restituer [cette]
remarquable prise de position à nos mémoires amnésiques : « Je
parle, disait le Président Schuman, en croyant à des croyants… Nos
démocraties contemporaines développent en nous le sens de la
responsabilité personnelle. C'est la conséquence heureuse et la
contrepartie de tout régime basé sur la liberté. Mais le courage
civique, individuel ou collectif au sein d'une Assemblée, n'est pas
toujours à la mesure de cette responsabilité… Il importe de nous
rendre compte que l'Europe ne saurait se limiter à la longue à une
structure purement économique. Il faut qu'elle devienne aussi une
sauvegarde pour tout ce qui fait la grandeur de notre civilisation
chrétienne : dignité de la personne humaine, liberté et
responsabilité de l'initiative individuelle et collective,
épanouissement de toutes les énergies morales de nos peuples.
Une telle mission culturelle sera le complément indispensable et
l'achèvement d'une Europe qui jusqu'ici a été basée sur la
coopération économique. Elle lui confèrera une âme, un anoblissement
spirituel et une véritable conscience commune. Il ne faut pas que
nous ayons de la future Europe une conception étriquée, se confinant
dans des préoccupations matérielles, si nous voulons qu'elle résiste
à l'assaut des coalitions racistes et aux fanatismes de tous genres.
L'Europe, après le discrédit qu'on a déversé sur elle, dans de
grandes parties du monde, devra être à même de reprendre à nouveau
son rôle d'éducatrice désintéressée, notamment des peuples qui
viennent de naître à la liberté.
L'aide aux pays sous-développés sera ainsi la grande tâche à
laquelle devront s'associer tous ceux qui ont le privilège d'être en
avance sur d'autres. L'humanité de demain sera ce que nous aurons su
en faire. Si nous nous bornions à les équiper économiquement et
militairement, sans leur fournir en même temps cette armature
morale, sans leur donner aussi l'exemple d'un comportement basé sur
des principes spirituels, nous aurions fait une œuvre, non seulement
vaine, mais dangereuse. Nous les aurions détachés de leurs anciennes
croyances traditionnelles, sans leur procurer un idéal nouveau,
complément et contrepoids du progrès technique… A leur égard, nous
avons une véritable charge d'âme. Nous ne remplirions nullement
notre devoir, en bornant notre action à la construction de routes et
d'usines, d'écoles et de dispensaires, si nous leur apportions
l'autonomie ou même l'indépendance, sans leur avoir enseigné l'usage
qu'il faut en faire, sans les avoir mis en garde contre les abus qui
peuvent en être faits. Il faut que l'émancipation s'accompagne d'une
éducation morale autant que technique, sans quoi, on risque de voir
se produire de lamentables rechutes dans l'anarchie et dans la
barbarie… Et c'est encore une tâche spécifiquement européenne… » ».
ZF05092906
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
Six évêques
et deux auditeurs français au synode sur l'Eucharistie
« L’Eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de
l’Église »
ROME, Jeudi 29 septembre 2005 (ZENIT.org)
– Six évêques et deux auditeurs français participeront au synode des
évêques sur l'Eucharistie, du 2 au 23 octobre prochain, annonce la
conférence des évêques de France (www.cef.fr),
dans un communiqué que nous reprenons ci-dessous.
Parmi les 250 évêques qui participeront aux synodes, six évêques
français participeront à cette 11e assemblée générale du synode sur
le thème : « L’Eucharistie, source et sommet de la vie et de la
mission de l’Église ». Cette rencontre réunira 250 évêques du monde
entier.
Ce sont :
Mgr Philippe Gueneley (évêque de Langres et membre de la Commission
épiscopale de la liturgie et de la pastorale sacramentelle),
Mgr Robert Le Gall (évêque de Mende et président de la Commission
pour la liturgie et la pastorale sacramentelle),
Mgr Jacques Perrier (évêque de Tarbes et Lourdes)
et Mgr Jean-Pierre Ricard (archevêque de Bordeaux et président de la
Conférence des évêques de France)
Ils ont été élus par l'assemblée plénière des évêques de France en
novembre 2004 pour les représenter au synode.
Mgr Jean-Louis Bruguès (évêque d'Angers et président de la
Commission doctrinale) a été invité par le pape Benoît XVI à
participer au synode.
Mgr Roland Minnerath (archevêque de Dijon et membre de la Commission
théologique internationale) avait été nommé par Jean-Paul II
secrétaire spécial du synode le 12 mars 2005, nomination qui a été
confirmée par son successeur Benoît XVI le 12 mai suivant.
Deux auditeurs français, nommé par Benoît XVI le 24 septembre
dernier, assisteront également au synode :
le Frère Marc Hayet, responsable général de la fraternité des Petits
frères de Jésus,
et Mme Marie-Hélène Mathieu, coordinatrice internationale du
mouvement "Foi et lumière".
En tout, 32 experts, ainsi que 26 auditeurs, ont été nommés pour
prendre part à cette assemblée.
Des "délégués fraternels" ont également été invités. Leur nombre a
été doublé depuis la dernière assemblée générale du synode : ils
seront 12 représentants de l'orthodoxie, des anciennes Églises
orientales et des Églises de la réforme.
La 11e assemblée générale du synode a été convoquée par le pape
Jean-Paul II pour clôturer l'année de l'Eucharistie ouverte le 17
octobre 2004 avec le Congrès eucharistique de Guadalajara. Benoît
XVI a confirmé la tenue du synode dès le lendemain de son élection.
Le synode des évêques est une institution permanente créée en 1965 –
dans les dernières semaines du concile Vatican II – par le pape Paul
VI. Le terme « synode » vient du grec « sunodos », littéralement «
marcher ensemble », qui a pris le sens de « réunion » ou « congrès
». Il s'agit d'une assemblée d'évêques convoquée par le pape selon
les besoins de l'Église.
Cette prochaine assemblée synodale est la 21e depuis la création du
synode en 1965 (11 assemblées générales ordinaires, 2 assemblées
générales extraordinaires et 8 assemblées spéciales ont eu lieu). La
dernière assemblée générale ordinaire s'était tenue en 2001, sur le
thème « L’évêque : serviteur de l’Évangile de Jésus-Christ pour
l’Espérance du monde ».
Le pape nomme pour chaque session un ou plusieurs présidents. Un
secrétariat permanent, dirigé par un secrétaire général, assure la
préparation et le suivi des sessions.
Un secrétaire spécial est nommé pour chaque session, dont le rôle
est d'être à la disposition des présidents délégués, de l’assemblée
et du secrétaire général, pour préparer les documents et les
rapports, donner des explications et des informations à ceux qui le
souhaitent. C'est la fonction qu'assumera Mgr Roland Minnerath,
archevêque de Dijon.
Pour préparer leur travail, les évêques s'appuient sur le document
Instrumentum laboris publié par le Vatican le 7 juillet 2005 (cf.
www.vatican.va).
Le dimanche 4 septembre 2005, dans son allocution précédant la
prière de l'Angélus, Benoît XVI a encouragé la participation de tous
les catholiques à la préparation du synode sur l'Eucharistie, en
particulier par la prière et la réflexion.
ZF05092907
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
La maladie
mentale : Journée mondiale du Malade 2006 en Australie
ROME, Jeudi 29 septembre 2005 (ZENIT.org)
– Les célébrations de la Journée mondiale du Malade 2006 auront lieu
du 9 au 11 février prochain à en Australie, à Adélaïde, annonce le
Conseil pontifical pour la Pastorale de la Santé. Son thème devrait
être la maladie mentale.
La décision du pape Benoît XVI a été confirmée à Zenit par Mgr José
Luis Redrado Marchite, secrétaire du Conseil pontifical pour la
Pastorale de la santé.
Le président de ce dicastère, le cardinal Javier Lozano Barragan se
trouve en effet actuellement en Australie, pour visiter, aux côtés
de l’évêque local, Mgr Philip Wilson, les lieux où les célébrations
auront lieu.
Le pape Benoît XVI accorde une importance particulière au thème de
la maladie mentale. Le 28 novembre 1996, le cardinal Joseph
Ratzinger a en effet participé à la conférence mondiale organisée
par le Conseil pontifical pour la Pastorale de la Santé.
Il avait évoqué le cas de l’un de ses cousins, plus jeune que lui de
quelques années, assassiné en 1941 par le régime nazi parce qu’il
était trisomique.
Pour cette célébration 2006, le pape doit préparer un message dédié
à ce thème et nommer un envoyer spécial qui le représentera en
Australie en février prochain.
Selon Mgr Redrado, cette Journée mondiale sera préparée par deux
importants congrès, l’un de caractère théologique et pastoral, et un
autre de caractère scientifique. Les célébrations culminent chaque
année le 11 février, en la fête de Notre Dame de Lourdes.
Rappelons enfin que l’Australie sera aussi la terre hospitalière
pour la 21e Journée mondiale de la Jeunesse de 2008, qui se tiendra
à Sidney, comme Benoît XVI l’a annoncé à Cologne, le 21 août
dernier.
ZF05092908
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
|