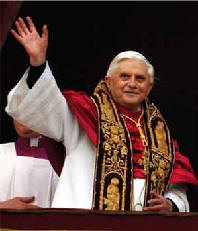| |
| |
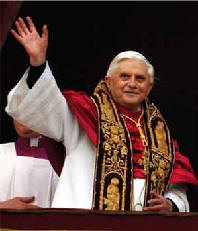
 Tout
sur Joseph Alois Ratzinger-
Benoît XVI Tout
sur Joseph Alois Ratzinger-
Benoît XVI
 Benoît
XVI invite l'Assemblée Synodale à la joie Benoît
XVI invite l'Assemblée Synodale à la joie
 Mercredi
5 octobre 2005 Mercredi
5 octobre 2005
Revue de Presse autre que Zénit
 Benoît
XVI invite l'assemblée synodale à la joie Benoît
XVI invite l'assemblée synodale à la joie
|
|
| |
Rome
Psaume 134 (2) : « La présence efficace
de Dieu apporte le salut »
Prier le rosaire pour la béatification de Jean-Paul II
Benoît XVI invite les jeunes à mettre l’Eucharistie au
centre de leur vie
Le Saint-Siège souhaite la ratification de l’accord
avec la République tchèque
Spécial synode
Eucharistie et écologie : Un problème «
éthique et moral »
Eucharistie, charité et justice, pour transformer le
monde
L’importance actuelle du lien
entre Eucharistie et Pénitence
Entretien
Comment construire l’avenir dans une
Europe « multi-religieuse » ?
- Documents -
Psaume 134 (2) : La liturgie, lieu
privilégié de l'écoute de la Parole de Dieu
Communication de la Congrégation pour les Causes des
saints relative aux béatifications
Le card. Martins explique la « différence substantielle
» entre béatification et canonisation
- Documents web -
Interventions des pères du synode mardi
matin
|
|
 |
|
|
| |
Rome
Psaume 134 (2) : «
La présence efficace de Dieu apporte le salut »
Catéchèse de Benoît XVI
ROME, Mercredi 5 octobre 2005 (ZENIT.org)
– La présence efficace de Dieu apporte le salut, déclare le pape
Benoît XVI à l’audience générale.
Lors de l’audience de ce mercredi, à 10 h 30, place Saint-Pierre, le
pape Benoît XVI a commenté la seconde partie du psaume 134 que
l’Eglise latine chante aux vêpres le vendredi de la 3e semaine
liturgique.
Le pape a donné un résumé de sa catéchèse italienne sur le Psaume
134 en français, en anglais, en allemand, et en espagnol.
En français, le pape expliquait que « la deuxième partie du Psaume
134 (…) montre deux visions religieuses différentes ».
Il expliquait l’opposition entre le culte du vrai Dieu et
l’idolâtrie: « D’un côté nous est présentée la figure du Dieu vivant
et personnel, qui est au centre de la foi authentique et dont la
présence efficace apporte le salut. De l’autre apparaît l’idolâtrie,
expression d’une religiosité déviée et faussée. L’idole n’est qu’un
produit des désirs humains, incapable de dépasser les limites
créées. Celui qui l’adore devient semblable à elle, impuissant,
fragile, inerte ».
« Le psaume s’achève, commentait encore le pape, par une bénédiction
que la communauté réunie dans le temple fait monter vers Dieu,
Créateur de l’univers et Sauveur de son peuple. La liturgie devient
ainsi le lieu privilégié de l’écoute de la Parole de Dieu qui rend
présents les actes de salut du Seigneur. Elle est aussi le cadre
dans lequel s’élève la prière communautaire qui célèbre l’amour
divin ».
ZF05100501
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
Prier
le rosaire pour la béatification de Jean-Paul II
Salutation aux Polonais
ROME, Mercredi 5 octobre 2005 (ZENIT.org)
– Le pape Benoît XVI a encouragé les pèlerins polonais présents à
l’audience générale de ce mercredi à prier le rosaire à l’intention
de la béatification de Jean-Paul II.
Le pape a en effet adressé ses salutations aux fidèles en portugais,
en particulier pour un groupe de visiteurs du Brésil, en polonais,
en hongrois, en slovaque, et en italien.
« Je salue cordialement les pèlerins polonais, disait Benoît XVI
dans leur langue. Six mois ont passé depuis la disparition de notre
cher prédécesseur, le pape Jean-Paul II. Tout son magistère et le
témoignage de sa vie restent pour nous importants et actuels. Je
confie à votre prière du rosaire la cause de sa béatification. Loué
soit Jésus-Christ ».
En hongrois, le pape a évoqué le 25e anniversaire de la consécration
de la chapelle vaticane "Magna Domina Hungarorum". Il invoquait
l’intercession de la Vierge Marie et accordait aux pèlerins sa
bénédiction apostolique.
En slovaque, le pape a salué les pèlerins, les invitant, « en ce
mois marial, à se mettre à l’école de la Vierge de Nazareth, pour
apprendre d’elle à aimer Dieu et le prochain ».
ZF05100502
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
Benoît XVI invite
les jeunes à mettre l’Eucharistie au centre de leur vie
Invitation aux pèlerins francophones
ROME, Mercredi 5 octobre 2005 (ZENIT.org)
– Benoît XVI invite les fidèles, et spécialement les jeunes, à
mettre l’Eucharistie au centre de leur vie.
Le pape a salué, en italien, les jeunes, les malades et les jeunes
mariés, à l’issue de l’audience générale de ce mercredi 5 octobre.
« Ma pensée, disait-il, s’adresse finalement aux malades, aux jeunes
mariés et aux jeunes, en particulier les représentants des groupes
de jeunes de l’Adoration eucharistique, venus à Rome de différentes
nations, pour un congrès sur l’Eucharistie ».
Le pape proposait le « lumineux exemple de saint François d’Assise »
dont c’était hier la fête liturgique, et souhaitait qu’il aide les
jeunes à « placer l’Eucharistie au centre » de leur vie personnelle
et communautaire, en « apprenant à vivre de la force spirituelle qui
jaillit d’elle ».
« Qu’elle vous aide, chers malades, à affronter la souffrance avec
courage, en trouvant dans le Christ crucifié sérénité et réconfort
», ajoutait le pape.
« Qu’elle vous conduise, chers jeunes mariés, à un amour profond
envers Dieu et entre vous, dans l’expérience quotidienne de la joie
qui jaillit du don réciproque ouvert à la vie », concluait Benoît
XVI.
Le pape avait également exprimé ce vœu à l’adresse des pèlerins
francophones : « J’accueille avec plaisir les pèlerins de langue
française. Je salue particulièrement les enfants de chœur du diocèse
de Bâle, en Suisse. Alors que vient de commencer l’Assemblée du
Synode des Évêques, je vous invite à trouver dans l’Eucharistie la
véritable nourriture de votre vie et la source de votre témoignage
parmi vos frères ».
Le pape saluait en italien les pèlerins du diocèse de
Terni-Narni-Amelia, accompagnés de leur évêque, Mgr Vincenzo Paglia.
« Vous venez, disait-il, de la terre de saint Benoît et de saint
François : eux aussi ont fait ce pèlerinage. Et l’on peut dire que
de l’Ombrie à Rome, leur exemple est arrivé partout. De nombreux
siècles après, leur témoignage d’amour et de paix est encore actuel
: l’Italie, l’Europe, le monde, en ont besoin. Je vous exhorte à
écouter l’Evangile et à en témoigner dans votre vie comme l’ont fait
ces deux grands saints. Je salue aussi, disait le pape, les fidèles
du diocèse de San Marino-Montefeltro, venus ici avec leur pasteur,
Mgr Luigi Negri. Chers amis, je vous invite à exprimer dans vos
communautés chrétiennes un dévouement évangélique fidèle et généreux
».
A propos de sport, Benoît XVI disait : « Ma pensée affectueuse va
aux participants de la « Fête du sportif », promue par la conférence
épiscopale du Latium. Que cette manifestation suscite en vous tous
un grand amour pour ces valeurs qui, comme la saine pratique
sportive, contribuent à construire une société où règnent le respect
réciproque et l’accueil fraternel ».
ZF05100503
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
Le Saint-Siège
souhaite la ratification de l’accord avec la République tchèque
L’apport de ce pays à la culture européenne
ROME, Mercredi 5 octobre 2005 (ZENIT.org)
– Le Saint-Siège se réjouit de l’apport de la République tchèque à
la culture européenne et espère une rapide ratification de l’accord
signé en 2002 avec cette nation, a déclaré aux journalistes, en fin
de matinée, le directeur de la salle de presse du Saint-Siège.
Il précisait qu’aujourd’hui, 5 octobre, le Ministre des Affaires
étrangères de la République tchèque, M. Cyril Svoboda, a rendu
visite à Mgr Giovanni Lajolo, secrétaire pour les Relations avec les
Etats. Il était accompagné de M. Pavel Jajtner, ambassadeur de la
République tchèque près le Saint-Siège, de M. Jaromír Plisek,
directeur général de la première section territoriale du ministère
des Affaires étrangères ; de M. Jirí Elinger, vice-directeur de
cabinet du ministre ; de M. Petr Janyska, directeur du département
de l’Europe occidentale ; de M. Vít Kolar, porte-parole du ministre.
Les entretiens ont eu lieu en présence de Mgr Michael W. Banach et
de Mgr Julio Murat, conseillers de nonciature en service auprès de
la secrétairerie d’Etat, dans la section des relations avec les
Etats.
« Au cours de la rencontre, on a parlé, expliquait M. Navarro Valls,
des relations bilatérales entre le Saint-Siège et la République
Tchèque, en particulier, de l’ « Accord sur le règlement des
relations réciproques », signé à Prague le 25 juillet 2002 mais pas
encore ratifié ».
« Mgr Lajolo, indiquait le porte-parole du Saint-Siège, a exprimé le
vœu que les difficultés qui s’opposent à la ratification du côté
tchèque puissent être surmontées, et que l’objectif de la
ratification puisse être atteint rapidement. Il a déclaré la
disponibilité de la secrétairerie d’Etat pour favoriser ce processus
».
M. Navarro Valls précisait : « Les autres sujets abordés ont été :
certains aspects du projet de Loi de la réforme de la liberté
religieuse et certaines propositions pour une solution de la
question des biens de l’Eglise catholique confisquée aux temps du
régime communiste. Dans ce dessein, on est convenu de l’opportunité
de constituer une commission paritaire avec un mandat précis à terme
».
Il ajoutait : « la conversation s’est étendue à d’autres thèmes de
l’actualité internationale, en particulier le processus de
consolidation et d’élargissement de l’Union européenne ; Mgr
Giovanni Lajolo a souligné l’apport notable, avant tout culturel,
que l’entrée de la République tchèque peut donner à l’Union
européenne, dont elle fait partie depuis le 1er mai 2004. Les autres
thèmes ont été : le Moyen Orient, la collaboration des Organisations
internationales, en référence à de grandes questions éthiques ».
« La rencontre, concluait M. Navarro Valls, a permis de révéler les
rapports cordiaux existant entre le Saint-Siège et la République
tchèque » et le souhait de « développements ultérieurs » est
partagé.
ZF05100504
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
Spécial synode
Eucharistie et
écologie : Un problème « éthique et moral »
Par Mgr Pedro Ricardo Barreto Jimeno
ROME, Mercredi 5 octobre 2005 (ZENIT.org)
– « La crise écologique ne constitue pas seulement un problème
scientifique et technique mais, - également et principalement - un
problème éthique et moral », a expliqué l’évêque péruvien de
Huancayo, Mgr Pedro Ricardo Barreto Jimeno, jésuite, dans son
allocution au synode, le 4 octobre après-midi, en la fête de saint
François d’Assise. Il invitait à une « conversion écologique »
nécessaire à la paix du monde.
Il soulignait le lien entre eucharistie et préservation de
l’environnement des hommes : « Telle est l’opinion de l’Église selon
laquelle “la technologie qui pollue peut également décontaminer; la
production qui accumule peut également distribuer de manière
équitable, à condition que prévale l’éthique du respect pour la vie,
pour la dignité de l’homme et pour les droits des générations
humaines, présentes et à venir”. »
« Le changement climatique, insistait l’évêque péruvien, représente
une sérieuse menace pour la paix dans le monde. Il s’agit d’un
authentique “signe des temps” qui exige de notre part une conversion
écologique. L’Église a une grande responsabilité dans ce domaine
spirituel. En effet, “l’Eucharistie, étant le sommet auquel tend
toute la création, elle est la réponse à la préoccupation du monde
contemporain y compris en matière d’équilibre écologique”. »
Il affirmait encore : « L’Eucharistie est en relation directe avec
la vie et l’espérance de l’humanité et doit être la préoccupation
constante de l’Église et un signe d’authenticité eucharistique. “Ce
sont de nouveaux cieux et une terre nouvelle que nous attendons
selon sa promesse, où la justice habitera (cf. 2P 3, 13) et ramènera
toutes choses sous un seul Chef, le Christ, les êtres célestes comme
les terrestres (cf. Ep 1, 10)”. »
Il témoignait que dans son diocèse aussi « l’air, la terre et le lit
du fleuve Mantaro sont sérieusement compromis par la pollution. »
« L’Eucharistie nous engage, insistait l’archevêque, à faire en
sorte que le pain et le vin soient le fruit “de la terre fertile,
pure et non polluée”.
Il soulignait aussi la nécessité d’une « solidarité » dans ce
domaine, avec les plus pauvres : « La foi dans le Christ ressuscité
fait que l’Église soit “un projet de solidarité” afin de partager
les biens avec les plus pauvres et de vivre dans l’Église la
spiritualité eucharistique ».
ZF05100505
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
Eucharistie,
charité et justice, pour transformer le monde
Intervention de deux évêques sud-américains
ROME, Mercredi 5 octobre 2005 (ZENIT.org)
– Le cardinal Miguel Obando Bravo, salésien, archevêque émérite de
Managua, au Nicaragua, a rappelé, le 4 octobre, que « pour façonner
une société plus humaine, plus digne de la personne, il est
nécessaire de revaloriser l’amour au sein de la vie sociale - au
niveau politique, économique, culturel - en en faisant la norme
constante et suprême de l’action ».
Il insistait sur le fait que « seule la charité permet de changer
complètement l’homme : un tel changement ne signifie pas annuler la
dimension terrestre pour en faire une spiritualité désincarnée ».
« La charité, cependant, faisait observer le cardinal Obando, ne
peut se résoudre à la dimension terrestre des relations humaines et
sociales, dans la mesure où toute son efficacité dérive justement de
sa référence à Dieu. On ne peut pas parler d’Eucharistie sans
fraternité, sans au moins une attitude d’ouverture, une volonté
d’union et de dévouement mutuel ».
De son côté, un autre évêque sud-américain, Mgr José Trinidad
Gonzalez Rodriguez, évêque auxiliaire de Guadalajara, au Mexique,
affirmait que « la justice unie à la charité à laquelle
l’Eucharistie nous exhorte, nous pousse à un amour actif, concret et
efficace à l’égard de tout être humain, un amour qui ne doit pas
manquer dans notre style ecclésial de vie chrétienne et dans nos
programmes pastoraux ». Et de citer le chapitre 25 de l’Evangile
selon saint Matthieu (Mt 25,35-36).
« Cette page, commentait l’évêque mexicain, n’est pas une simple
invitation à la charité; c’est une page de christologie qui projette
un rayon de lumière sur le mystère du Christ. C’est sur cette page,
tout autant que sur la question de son orthodoxie, que l’Église
mesure sa fidélité d’Épouse du Christ”, a dit Sa Sainteté Jean-Paul
II (Nuovo Millenio Ineunte 49) ».
Il concluait : « Jésus, Pain de Vie, nous encourage à travailler
pour que personne, et pour qu’aucune nation ne manque de ce pain qui
fait encore défaut à beaucoup d’hommes:
- Le pain de la paix et de la justice, là où il y a la guerre, là où
les droits de l’homme, de la famille et des peuples ne sont pas
respectés .
- Le pain de la Parole de Dieu, là où le Christ, Pain de Vie, n’a
pas encore été annoncé et où les hommes sont privés de l’aliment et
de la boisson qui apaisent la faim et la soif de l’esprit ».
ZF05100506
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
L’importance actuelle du lien entre Eucharistie et Pénitence
Des propositions concrètes
ROME, Mercredi 5 octobre 2005 (ZENIT.org)
– « L’importance actuelle du lien entre Eucharistie et Pénitence » a
été soulignée le 4 octobre par le grand pénitencier du Vatican, le
cardinal des Etats-Unis, James Francis Stafford : il demandait un
chanoine pénitencier par diocèse. L’archevêque de Puerto Montt, au
Chili, Mgr Cristian Caro Cordero, demandait au synode de lancer une
année du sacrement de la pénitence et que les prêtres consacrent
plus de temps à la direction spirituelle des jeunes et au sacrement
de la réconciliation.
« L’Église se reconnaît comme le peuple des sauvés, des réconciliés
avec le Père dans le sang du Fils », faisait observer le cardinal
Stafford, qui ajoutait : « Dans le même temps, l’Église se reconnaît
comme le nouveau peuple de Dieu, pèlerin qui expérimente les
tentations et les embûches du chemin, ainsi que l’infidélité de ses
membres. Il en découle une exigence constante de conversion et un
besoin permanent de réconciliation ».
Il en déduisait que « la vie chrétienne est authentique lorsqu’elle
est vécue dans une attitude de permanente conversion personnelle et
communautaire, qui a son expression la plus élevée dans le signe de
la réconciliation sacramentelle ».
Il soulignait la dimension « publique » de la réconciliation. «
Renouveler l’alliance d’amitié avec Dieu n’est pas seulement une
décision intime du chrétien pénitent, faisait observer le cardinal
Stafford, mais cela requiert un signe reconnu dans et par la
communauté ecclésiale, dans la personne du ministre, parce que le
péché a brisé le lien d’amitié avec le Seigneur et avec son Église.
La participation au banquet eucharistique avec les frères comporte,
comme condition inéluctable, un signe public de réconciliation ».
Le cardinal Stafford achevait sur cette recommandation : « Il est
souhaitable que, dans chaque diocèse, soit présent un chanoine
pénitencier ou, au moins, un prêtre qui exerce la même mission, tel
que cela est prévu par le canon 508 du Codex Juris Canonici. Ce sont
eux qui peuvent aider les confesseurs dans leur délicat ministère et
les instruire sur les éventuels recours à la Pénitencerie
Apostolique. Il s’agit d’un service précieux pour la sérénité de la
conscience de nombreux fidèles, comme en témoigne le travail
quotidien de la Pénitencerie Apostolique elle-même »
Pour sa part, Mgr Cristian Caro Cordero était intervenu dans la
session de lundi 3 octobre au matin, en proposant une année du
sacrement de la réconciliation.
Le cardinal Giovanni Battista Re, préfet de la Congrégation romaine
pour les Evêques a pris la parole pour appuyer cette proposition.
Mgr Caro Cordero a également souligné comme « providentielle » la
prochaine canonisation du bienheureux prêtre et jésuite chilien
Alberto Hurtado, le 23 octobre jour de la conclusion du synode, car
il a été « un homme eucharistique et social ».
Devant la « perte du sens du péché, Mgr Caro Cordero suggérait en
outre que les prêtres s’engagent davantage dans la direction
spirituelle des jeunes et qu’ils dédient plus de temps au sacrement
de la réconciliation.
ZF05100507
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
|
|
|
 |
|
|
| |
Entretien
Comment
construire l’avenir dans une Europe « multi-religieuse » ?
Entretien avec le vicaire apostolique de la
Turquie et le responsable de l’immigration au CCEE
ROME, Mardi 4 octobre 2005 (ZENIT.org)
– A l’occasion de l’assemblée plénière annuelle du Conseil des
Conférences épiscopales d’Europe (CCEE) qui a eu lieu au «
Salesianum », à Rome, du 29 septembre au 2 octobre sur le thème
: « Le Concile Vatican II et l’Europe. Quelles indications pour
l’avenir ? », Zenit a rencontré Mgr Louis Pelatre, vicaire
apostolique d’Istanbul, responsable des catholiques latins pour
Istanbul et Ankara et le père Hans Vöking, responsable de la
pastorale des migrants dans le CCEE.
Zenit : Vous êtes venus à Rome avec des
questions pressantes, surtout peut-être vous, Mgr Pelatre, qui
avez à cœur le cas de la Turquie. Qu’est-ce que vous voulez
porter à l’attention de cette Assemblée plénière ?
Mgr Pelatre : Je ne
pense pas que l’Assemblée plénière puisse se préoccuper de tout
ce qui concerne l’Eglise de Turquie en particulier. De toute
façon, les chrétiens en Turquie sont une très petite minorité et
nous vivons aussi dans la convivence avec les autres confessions
chrétiennes qui sont les orthodoxes, donc les Grecs, qui sont
très peu d’ailleurs, les arméniens et les syriaques et puis
aussi les protestants. Ensemble nous formons une minorité. Notre
problème c’est justement le témoignage que l’Eglise, que les
chrétiens doivent donner devant un peuple qui est musulman, mais
aussi une société, la société turque qui est aussi laïque parce
qu’il y a en Turquie deux tendances, une tendance plus
traditionnelle qui est liée à l’empire ottoman, à l’islam, et
une tendance très moderne qui se veut républicaine, laïque. Nous
vivons dans ce monde très complexe et nous devons donner notre
témoignage, notre service comme nous l’avons dit tout à l’heure.
L’Eglise catholique ne vit pas seulement pour elle-même. Elle a
aussi une mission pour la population qui l’entoure.
Zenit : Y a-t-il des progrès dans le dialogue
avec les musulmans ? Où en est la liberté religieuse ? Peut-on
faire un bilan depuis la fin du Concile Vatican II ?
Mgr Pelatre : Quand
la quasi-totalité de la population appartient à une religion,
c’est plutôt eux qui devraient dire ce qu’est la liberté
religieuse. Qu’est-ce que nous sommes nous les chrétiens en
Turquie pour dire comment la liberté religieuse s’exerce
vis-à-vis de nous ? Il faut essayer de comprendre comment ça se
passe pour l’ensemble de la population, qui se réclame de
l’islam à 99%. Il se trouve que eux ne sont pas si contents que
cela non plus. La laïcité turque s’exerce de telle façon que
même l’islam, qui est la religion de la quasi-totalité n’a pas
un statut officiel et n’est donc pas reconnue officiellement par
l’Etat. Ça reste du domaine privé et malgré cela, l’Etat qui est
laïc, administre la religion, ce qui veut dire d’ailleurs qu’il
a une main mise, qu’il a un contrôle. Il n’y a pas de ministère
des cultes en Turquie. Il y a ce que l’on appelle la présidence
des affaires religieuses, qui dépend directement du premier
ministre. C’est le gouvernement qui nomme le chef de l’islam en
Turquie. Il y a une espèce de collusion entre l’Etat et la
religion mais la population en général accepte cela. Pour elle
ce n’est pas un grand problème parce que être un bon citoyen,
être un bon musulman, tout cela va ensemble. Je vous dis cela
parce que c’est la situation générale. Comment voulez-vous que
nous chrétiens, ayons une place dans un système pareil. C’est un
peu difficile.
Zenit : Au centre des débats il y a également
le thème de l’immigration. Selon vous, l’immigration est-elle
vraiment en train de créer une unité en Europe ?
P. Hans Vöking :
L’immigration fait partie de la société européenne. Il y a
toujours eu des mouvements migratoires dans la société
européenne, du sud vers le nord, d’est vers l’ouest, vers
l’Amérique et vers l’Australie. Mais depuis 40 ans il faut
distinguer deux phénomènes : d’un côté, la migration du sud vers
le nord, qui est liée au développement économique et qui est une
migration intra-européenne. Elle a posé des problèmes mais à
partir des années 70-80 il y a également eu une immigration
d’hommes et de femmes venus d’autres cultures. La société
européenne est marquée par l’interculturalisme, étant donné
qu’il y a des hommes venus de cultures islamique, bouddhiste,
hindouiste. La société européenne n’est plus composée comme il y
a trente ans. Cela pose des problèmes politiques, sociaux,
juridiques. Et pour l’Eglise cela pose aussi un problème.
Comment travaille-t-elle avec la mobilité humaine ? Il ne faut
pas seulement considérer les hommes et les femmes qui sont en
mouvement à cause du travail, qui s’implantent et qui vont
s’intégrer dans un Etat européen, et qui vont y rester. Il y a
aussi une mobilité du travail qui est limitée à trois, quatre
mois, d’ingénieurs, de techniciens qui voyagent à travers
l’Europe. Cela pose aussi pas mal de problèmes pastoraux pour
l’Eglise. Comment atteindre les catholiques en mouvement ou en
déplacement en Europe. Et comment vivre avec des hommes et des
femmes d’autres religions, d’autres cultures. Ceci est également
une nouveauté. L’Europe est devenue multi-religieuse. Je ne dis
pas multi-culturelle mais multi-religieuse. Cela pose des
questions à l’Eglise catholique mais aussi aux Eglises
protestantes et orthodoxes. Comment construire l’avenir ?
L’autre problème dont on parle très peu dans l’Eglise catholique
lorsqu’on parle de l’immigration, c’est le phénomène
démographique de la société européenne. Les Européens sont en
chute énorme et s’ils veulent garder un certain niveau social et
économique, ils doivent de nouveau faire venir des hommes et des
femmes pour travailler ici en Europe. Cela marquera un
changement radical dans notre société dans les 50 ans à venir.
Zenit : Y a-t-il des points nouveaux dans
l’agenda de la commission dont vous vous occupez ? Je pense par
exemple au terrorisme. Cet aspect est-il mentionné dans la
pastorale de l’Eglise ?
P. Hans Vöking :
Bien sûr. Cela est lié à l’immigration des musulmans en Europe
et au fait aussi que les musulmans regardent la grande
communauté musulmane au niveau du monde. Dès qu’il y a un
mouvement quelque part, en Iran, en Egypte ou en Afghanistan,
cela implique aussi les musulmans qui vivent en Europe. Il y a
des jeunes musulmans, ou de tradition musulmane, ou des familles
musulmanes qui sont déracinés, à la recherche d’une orientation
pour leur vie et pour la communauté. Ils sont souvent très
accessibles par les activistes des islamistes et prêts aussi à
consacrer leur vie pour le « salut » de tous les musulmans, pour
la communauté musulmane. L’Eglise est concernée par le facteur
extrémiste qui vient des musulmans ou de certains groupes
musulmans.
Zenit : Quel est l’aspect de l’Eucharistie que
vous souhaiteriez porter à l’attention du synode des évêques à
partir du point de vue de votre pays, ou du pays duquel vous
vous occupez. La Turquie par exemple.
Mgr Pelatre : L’Eucharistie
est évidemment une réalité spécifiquement chrétienne. Je vous
l’ai dit. Comme je vis dans un pays qui n’est pas chrétien, je
ne vois pas comment je peux faire passer les valeurs de
l’Eucharistie à ceux qui ne sont pas chrétiens. C’est notre
grand problème. Nous sommes des petites communautés. Nous nous
réunissons. Il est vrai que fréquemment les musulmans
s’intéressent à nous et viennent dans nos Eglises. Bien sûr ils
ne peuvent pas saisir et comprendre ce que nous faisons quand
nous célébrons l’Eucharistie. Nous sommes tellement persuadés
que c’est le centre de notre foi. Tout trouve son unité dans
cette célébration. Certains disent : c’est bien aussi qu’on
partage avec les autres. Je réponds : on ne peut pas tout
partager. Ce n’est pas possible. Il arrive même que nous
recevions des autorités. C’est très curieux de dire : Venez
prier avec nous, mais non, ça vous ne pouvez pas. Mais au niveau
des communautés chrétiennes ce n’est pas la même chose. Avec nos
frères orthodoxes par exemple, c’est l’un des points sur
lesquels nous nous sentons profondément unis. Et là au contraire
nous souffrons de ne pas pouvoir partager. Nous ne voyons pas ce
qui empêcherait finalement que nous partagions la même
Eucharistie, mais il y a encore des problèmes. Il y a une
souffrance actuellement encore, entre confessions chrétiennes,
de ne pas partager l’Eucharistie. Pour ce qui est de nous les
catholiques, nous avons essayé comme tout le monde d’entrer
cette année dans ce mouvement. Une fois par mois il y avait une
adoration dans une église, soutenue par les jeunes également,
avec de nouveaux chants. Une manière de vivre le sacrement
eucharistique de façon très vivante, très adaptée à la vie
d’aujourd’hui.
Zenit : L’Eucharistie peut-elle unir les
migrants ?
P. Hans Vöking :
Après le Concile l’Eglise a dit : il faut suivre les migrants,
il faut construire certaines structures pour accueillir les
migrants, célébrer l’Eucharistie dans la langue maternelle des
catholiques. Cela a marché. Mais maintenant les migrants
catholiques d’Italie, d’Espagne, de Croatie qui vivent
actuellement en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse,
etc. en sont déjà à la troisième ou quatrième génération. La
première génération va encore à la mission pour célébrer
l’Eucharistie mais les jeunes sont dans le système scolaire du
pays. Ils préfèrent faire la préparation à la première communion
avec leur classe. Ce n’est plus dans la mission, c’est dans la
paroisse. Les pasteurs comprennent. Mais ce n’est pas facile à
gérer, ni pour le curé, ni pour celui qui est responsable de la
pastorale. Dans la plupart des pays il a quand même des
initiatives que l’on célèbre avec les migrants, des journées
interculturelles avec les migrants et pour les catholiques, des
célébrations communes de l’Eucharistie. En Allemagne par
exemple, il y a la procession de la Fête-Dieu, et toutes les
missions sont invitées, elles sont bien visibles avec leurs
costumes traditionnels.
ZF05100508
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
|
|
|
|
 |
|
|
| |
-
Documents -
Psaume 134
(2) : La liturgie, lieu
privilégié de l'écoute de la
Parole de Dieu
Catéchèse sur
les psaumes et les cantiques
des vêpres
ROME, Mercredi 5 octobre
2005 (ZENIT.org)
– « La liturgie est le lieu
privilégié pour l'écoute de
la Parole divine », affirme
Benoît XVI dans sa catéchèse
liturgique de ce mercredi.
Voici la traduction de la
catéchèse que Benoît XVI a
donnée en italien lors de
l’audience générale de ce
mercredi sur la seconde
partie du psaume 134.
Lecture: Ps 134, 13-15.18-20
13. Pour toujours, Seigneur,
ton nom !
D'âge en âge, Seigneur, ton
mémorial !
14. Car le Seigneur rend
justice à son peuple :
par égard pour ses
serviteurs, il se reprend.
15. Les idoles des nations :
or et argent,
ouvrage de mains humaines.
16. Elles ont une bouche et
ne parlent pas,
des yeux et ne voient pas.
17. Leurs oreilles
n'entendent pas,
et dans leur bouche, pas le
moindre souffle.
18. Qu'ils deviennent comme
elles, tous ceux qui les
font,
ceux qui mettent leur foi en
elles.
19. Maison d'Israël, bénis
le Seigneur,
maison d'Aaron, bénis le
Seigneur,
20. maison de Lévi, bénis le
Seigneur,
et vous qui le craignez,
bénissez le Seigneur !
21. Béni soit le Seigneur
depuis Sion,
lui qui habite Jérusalem !
©
AELF
1. Le Psaume 134, un chant
au caractère pascal, nous
est offert par la Liturgie
des Vêpres en deux passages
distincts. Celui que nous
venons d'entendre comprend
la deuxième partie (cf. vv.
13-21), scellée par
l'alléluia, l'exclamation de
louange au Seigneur qui
avait ouvert le Psaume.
Après avoir commémoré dans
la première partie de
l'hymne l'événement de
l'Exode, cœur de la
célébration pascale
d'Israël, le psalmiste
confronte à présent de façon
incisive deux visions
religieuses différentes.
D'un côté s'élève la figure
du Dieu vivant et personnel
qui se trouve au centre de
la foi authentique (cf. vv.
13-14). Sa présence est
efficace et salvifique; le
Seigneur n'est pas une
réalité immobile et absente,
mais une personne vivante
qui « guide » ses fidèles, «
qui s'émeut » pour eux, les
soutenant par sa puissance
et son amour.
2. De l'autre côté, voilà
qu'apparaît l'idolâtrie (cf.
vv. 15-18), expression d'une
religiosité déviée et
trompeuse. En effet, l'idole
n'est autre qu'un « ouvrage
de mains humaines », un
produit des désirs humains;
elle est donc incapable de
surmonter les limites des
créatures. Oui, elle a bien
une forme humaine, avec une
bouche, des yeux, des
oreilles, une gorge, mais
elle est inerte, sans vie,
comme c'est précisément le
cas pour une statue inanimée
(cf. Ps 113B, 4-8).
Le destin de celui qui adore
ces réalités mortes est de
devenir semblable à
celles-ci, impuissant,
fragile, inerte. Dans cette
description de l'idolâtrie
comme fausse religion est
clairement représentée la
tentation éternelle de
l'homme de chercher le salut
dans « l’ouvrage de mains
humaines », en plaçant son
espérance dans la richesse,
dans le pouvoir, dans le
succès, dans la matière. Il
arrive malheureusement à
celui qui se met dans cette
voie, qui adore la richesse,
l'aspect matériel, ce que
décrivait déjà de façon
éloquente le prophète Isaïe:
« Il s'est attaché à de la
cendre, son cœur abusé l'a
égaré, il ne sauvera pas sa
vie, il ne dira pas: “Ce que
j'ai dans la main, n'est-ce
pas un leurre”? » (Is 44,
20).
3. Après cette méditation
sur la véritable et la
fausse religion, sur la foi
authentique dans le Seigneur
de l'univers et de
l'histoire et sur
l'idolâtrie, l'adoration de
la matière, le Psaume 134 se
conclut par une bénédiction
liturgique (cf. vv. 19-21),
qui met en scène une série
de figures présentes dans le
culte pratiqué dans le
temple de Sion (cf. Ps 113B,
9-13).
De toute la communauté
recueillie dans le temple
s'élève vers le Dieu
créateur de l'univers et
sauveur de son peuple dans
l'histoire une bénédiction
chorale, exprimée à travers
la diversité des voix et
dans l'humilité de la foi.
La liturgie est le lieu
privilégié pour l'écoute de
la Parole divine, qui rend
présents les actes
salvifiques du Seigneur,
mais elle est également le
cadre dans lequel s'élève la
prière communautaire qui
célèbre l'amour divin. Dieu
et l'homme se rencontrent
dans une étreinte de salut,
qui trouve son
accomplissement précisément
dans la célébration
liturgique.
4. En commentant les versets
de ce Psaume concernant les
idoles et la ressemblance
que prennent ceux qui
croient en eux (cf. Ps 134,
15-18), saint Augustin fait
observer: « En effet –
croyez-le, mes frères –
apparaît en eux une certaine
ressemblance avec leurs
idoles: non pas, bien sûr,
dans leur corps, mais dans
leur être intérieur. Ils ont
des oreilles, mais ils
n'entendent pas lorsque Dieu
leur crie: “Que celui qui a
des oreilles pour entendre,
entende”. Ils ont des yeux,
mais ils ne voient pas:
c'est-à-dire qu'ils ont les
yeux du corps, mais pas
l'œil de la foi ». Ils ne
perçoivent pas la présence
de Dieu. Ils ont des yeux et
ne voient pas. Et de la même
façon, « ils ont des
narines, mais ils ne
perçoivent pas les odeurs.
Ils ne sont pas en mesure de
percevoir cette odeur dont
l'Apôtre dit: Nous sommes la
bonne odeur du Christ en
tous lieux (cf. 2 Co 2, 15).
Quel avantage pour eux
d'avoir des narines, si avec
celles-ci ils ne réussissent
pas à respirer le doux
parfum du Christ? ».
C'est vrai, reconnaît saint
Augustin, il reste encore
des personnes liées à
l'idolâtrie. Et cela vaut
également pour notre temps,
avec son matérialisme qui
est une idolâtrie. Augustin
ajoute: même si ces
personnes demeurent, cette
idolâtrie se poursuit; «
chaque jour il y a cependant
des gens qui, convaincus par
les miracles du Christ
Seigneur, embrassent la foi,
et grâce à Dieu, il en est
de même aujourd'hui! Chaque
jour les yeux s'ouvrent à
des aveugles et les oreilles
à des sourds, des narines
qui étaient auparavant
bloquées commencent à
respirer, les langues des
muets se délient, les
membres des paralytiques se
fortifient, les pieds des
boiteux se redressent. De
toutes ces pierres sortent
les fils d'Abraham (cf. Mt
3, 9). Que l'on dise donc à
eux tous: “Maison d'Israël,
bénis le Seigneur”...
Bénissez le Seigneur, vous
peuples en général! Cela
signifie “Maison d'Israël”.
Bénissez-le vous, ô prélats
de l'Eglise! Cela signifie
“Maison d'Aaron”.
Bénissez-le, vous ministres!
Cela signifie “Maison de
Lévi”. Et des autres nations
que dire? “Vous qui craignez
le Seigneur, bénissez le
Seigneur” » (Discours sur le
Psaume 134, 24-25: Nuova
Biblioteca Agostinianan,
XXVIII, Rome 1977, pp.
375.377). Faisons nôtre
cette invitation et
bénissons, louons et adorons
le Seigneur, le Dieu vivant
et véritable.
[Texte original : italien
– Traduction réalisée par
Zenit]
ZF05100509
Je souhaite envoyer cette
information à un ami
TOP
Communication de la
Congrégation pour les Causes
des saints relative aux
béatifications
Texte
intégral
ROME, Mercredi 5 octobre
2005 (ZENIT.org)
– Nous reprenons ci-dessous
le texte intégral de la
communication de la
Congrégation pour les Causes
des Saints signée par le
cardinal José Saraiva
Martins, préfet de la
Congrégation et Mgr Edward
Nowak, secrétaire, indiquant
les nouvelles dispositions
prises par le pape Benoît
XVI pour ce qui concerne les
béatifications et les
canonisations. (cf.
également
Zenit, 29 septembre).
* * *
Communication de la
Congrégation pour les Causes
des Saints
Etant donné
les conclusions de l'étude
des raisons théologiques et
des exigences pastorales sur
les rites de béatification
et de canonisation,
approuvées par le Saint-Père
Benoît XVI, la Congrégation
pour les Causes des Saints
communique les nouvelles
dispositions suivantes :
1. Etant entendu que la
canonisation, qui attribue
au bienheureux le culte pour
toute l'Eglise sera présidée
par le Souverain Pontife, la
béatification, qui est
toujours un acte pontifical,
sera célébrée par un
représentant du Saint-Père,
qui sera en principe le
Préfet de la Congrégation
pour les Causes des Saints.
2. Le rite de béatification
se déroulera dans le diocèse
qui a promu la cause du
nouveau bienheureux, ou dans
un autre lieu jugé
approprié.
3. A la demande des Evêques
et des postulateurs de la
Cause, tenant compte de
l'avis de la Secrétairerie
d'Etat, le rite de
béatification pourra se
dérouler à Rome.
4. Enfin, ce rite se
déroulera au cours de la
Célébration eucharistique, à
moins que des raisons
liturgiques particulières ne
suggèrent qu'il ait lieu au
cours de la célébration de
la Parole ou de la Liturgie
des Heures.
Cité du Vatican, le 29
septembre 2005
José Card. SARAIVA MARTINS
Préfet
S.Exc. Mgr Edward NOWAK
Secrétaire
© L’Osservatore Romano en
langue française (Edition du
4 octobre)
ZF05100510
Je souhaite envoyer cette
information à un ami
TOP
Le card.
Martins explique la «
différence substantielle »
entre béatification et
canonisation
Texte publié
dans L’Osservatore Romano en
italien du 29 septembre
ROME, Mercredi 5 octobre
2005 (ZENIT.org)
– Nous reprenons ci-dessous
le texte du cardinal Saraivo
Martins, préfet de la
Congrégation pour les Causes
des saints publié dans l’Osservatore
Romano en italien du 29
septembre, et dans l’édition
française, le 4 octobre.
* * *
José Card. Saraiva Martins
Préfet de la Congrégation
pour les Causes des Saints
Tout au long de l'histoire,
l'Eglise a toujours célébré
la sainteté comme une
expression des «choses
admirables» accomplies par
le Seigneur dans la vie de
son Peuple. Répondant à la
sensibilité et aux contextes
historiques, l'Eglise a
porté une attention
particulière aux formes
liturgiques et aux
procédures à travers
lesquelles exprimer la
louange au Très-Haut et
raviver la foi et la piété
des fidèles. Ces formes de
procédures et la richesse de
signification de ces rites,
également dans la conscience
ecclésiale la plus récente,
ont été attentivement
étudiées en vue d'une
compréhension et d'une
influence plus grandes de la
nature même de la sainteté,
que l'Eglise célèbre à
travers les rites de
béatification et de
canonisation. Dans ce but,
le Saint-Père Benoît XVI a
introduit d'importantes
nouveautés en ce qui
concerne les béatifications.
I.
Prémisses historiques et
juridiques
1.—Au cours
du premier millénaire de
l'Eglise, le culte des
martyrs puis des confesseurs
était réglementé par les
diverses Eglises
particulières. Les Evêques,
de façon individuelle ou
collégiale, à l'occasion de
Synodes, autorisaient de
nouveaux cultes
particuliers, qui
commençaient par l'elevatio
ou la translatio corporis.
Ces Actes ont ensuite été
appelés canonisations
épiscopales ou canonisations
particulières, car ils
concernaient directement la
seule Eglise locale (1).
Au XIe siècle, commença à
s'affirmer le principe que
seul le Pontife romain, en
qualité de Pasteur universel
de l'Eglise, avait
l'autorité de prescrire un
culte public, tant dans les
Eglises particulières que
dans l'Eglise universelle. A
travers une Lettre au Roi et
aux Evêques de Suède,
Alexandre III revendiqua
pour le Pape l'autorité de
conférer le titre de saint,
accompagné du culte public
relatif. Cette norme devint
une loi universelle sous
Grégoire IX en 1234.
Au XIVe siècle, le
Saint-Siège commença à
autoriser un culte limité à
des lieux déterminés et à
certains Serviteurs de Dieu,
dont la cause de
canonisation n'avait pas
encore commencé ou n'était
pas encore terminée. Cette
concession, visant à la
future canonisation, est à
l'origine de la
béatification. Les
Serviteurs de Dieu, auxquels
était accordé un culte
limité, furent appelés
bienheureux à partir de
Sixte IV (1483), déterminant
ainsi la distinction
juridique définitive entre
le titre de saint et celui
de bienheureux qui était
utilisé indifféremment à
l'époque médiévale.
La concession du culte local
était notifiée et
communiquée aux personnes
concernées à travers une
Lettre apostolique sous
forme de Bref, que l'Evêque
local envoyait en vue de
l'exécution auctoritat
apostolica
Après l'institution de la
Congrégation des Rites
(1588), par Sixte V, les
Papes continuèrent
d'accorder des cultes
limités (Missa et Officium),
dans l'attente de parvenir à
la canonisation.
Progressivement, les
procédures devinrent plus
précises et mieux définies,
jusqu'à arriver à la
réglementation en vigueur,
promulguée en 1983.
2.—La doctrine en ce qui
concerne les instituts de
béatification (2) et de
canonisation (3) est restée
en substance la même au
cours des siècles. Leur
distinction (4), qui trouve
une expression adéquate dans
les formules d'énonciation
ou de constitution
respectives, est précise et
essentielle. La canonisation
est la glorification
suprême, de la part de
l'Eglise, d'un Serviteur de
Dieu élevé aux honneurs des
autels, ayant été prononcée
sous forme de décret, à
caractère définitif et
didactique pour toute
l'Eglise, engageant le
Magistère solennel du
Pontife romain. Et cela est
exprimé sans équivoque dans
la formule: «Ad honorem
Sanctae et Individuae
Trinitatis..., auctoritate
Domini Nostri Jesu Christi,
beatorum Apostolorum Petri
et Pauli ac Nostra... Beatum
N.N. Sanctum esse decernimus
ac definimus, ac Sanctorum
Catalogo adscribimus,
statuentes eum in universa
Ecclesia inter Sanctos pia
devotione recoli debere».
La béatification, au
contraire, consiste dans la
concession d'un culte public
sous forme d'indult, et
limitée à un Serviteur de
Dieu, dont les vertus
héroïques, c'est-à-dire le
martyre, sont reconnues en
bonne et due forme, comme il
ressort de la formule
relative:
«...facultatem
facimus ut Venerabilis
Servus Dei N.N. Beati nomine
in posterum appelletur,
eiusque festum... in locis
ac modis iure statutis
quotannis celebrari possit».
II. Les
rites de béatification au
cours des siècles
Bien que dans une continuité
doctrinale substantielle, en
ce qui concerne la nature de
béatification et de
canonisation, les rites et
les cérémonies, ainsi que
les formules d'énoncé et
d'autres détails de moindre
importance, ont eu une
évolution différente où nous
pouvons distinguer, en ce
qui concerne le seul
Institut de la
béatification, quatre
étapes:
a) Avant 1662: le Pape, en
accordant le culte local
(béatification), laissait
normalement aux personnes
concernées (Postulateurs de
la cause, Evêque du lieu),
la possibilité de choisir le
jour, le lieu et la façon de
célébrer solennellement
l'événement de la
béatification, et
d'inaugurer le nouveau culte
(Missa et Officium). Il
pouvait également arriver,
en particulier dans certains
monastères, qu'à l'occasion
de la béatification, ne soit
célébrée aucune solennité
extérieure, mais que l'on
célèbre la fête du nouveau
bienheureux au jour établi
par le calendrier liturgique
de l'année en cours.
b) De 1662 à 1968: la
première béatification, sous
forme solennelle, fut celle
de saint François de Sales,
voulue par Alexandre VII. Le
rite se déroula dans la
Basilique Saint-Pierre en
deux temps distincts. Dans
un premier temps — le matin
du 8 janvier 1662 — eut
lieu, dans la Basilique, le
rite à proprement parler de
la Béatification; on donna
lecture du Bref apostolique,
portant la date du 28
décembre 1661, par lequel le
Pape conférait le titre de
bienheureux et les honneurs
liturgiques relatifs; puis
suivit la célébration de la
Messe solennelle, présidée
par l'Evêque de Soissons.
Par la suite, en règle
générale, l'Eucharistie sera
présidée par un
chanoine-Evêque du Chapitre
du Vatican. Les
protagonistes de ce rite du
matin furent la Sacrée
Congrégation des Rites et le
Chapitre Vatican. Dans un
deuxième temps — dans
l'après-midi du même jour —,
le Pape descendit dans la
Basilique pour vénérer le
nouveau bienheureux et pour
gagner l'indulgence
plénière, que lui-même avait
accordée aux fidèles qui, ce
jour-là, auraient visité la
Basilique. La pratique
instaurée par Alexandre VII
est demeurée identique
jusqu'en 1968, lorsqu'eut
lieu la dernière
béatification selon ce rite
(5).
c) De 1971 à 2004: avec la
béatification de saint
Maximilien Kolbe (†1941),
célébrée dans la matinée du
17 octobre 1971, Paul VI
introduisit l'importante
innovation de présider
personnellement le rite de
la béatification; c'est
ainsi que fut supprimée la
cérémonie de l'après-midi au
cours de laquelle le
Saint-Père descendait dans
la Basilique pour vénérer le
nouveau bienheureux et
gagner l'indulgence
plénière. Pour la première
fois fut prédisposée une
«formule de béatification»
qui fut lue par le Pape
lui-même. Dès ce moment, la
Congrégation des rites fut
d'avis que «bien que toutes
deux comportent
l'intervention du Pape, il
doit y avoir une différence
nette de solennité entre la
canonisation et la
béatification» (6).
Au cours des béatifications
successives (1972, 1974,
1975), le Pape, présent à la
célébration, recevait la
peroratio, et prononçait la
formule de béatification,
mais ne célébrait pas la
Messe, qui était présidée le
plus souvent par l'Evêque
diocésain du nouveau
bienheureux. La peroratio
était faite par le Préfet ou
par le Secrétaire de la
Congrégation pour les Causes
des Saints, ou encore par
l'Evêque diocésain, qui
présidait la célébration
eucharistique.
Avec la béatification du 19
octobre 1975, le Pape
présida à nouveau également
la Messe, et ce jusqu'en
2004.
d) Depuis 2005: le
Saint-Père BenoîtXVI a
établi que les rites de
béatification du 14 mai 2005
soient présidés par le
Cardinal José Saraiva
Martins, Préfet de la
Congrégation pour les Causes
des Saints, qui «de mandato
Summi Pontificis», donna
lecture de la Lettre
apostolique par laquelle le
Pape accordait le titre de
bienheureuses à deux
vénérables Servantes de
Dieu. Auparavant, les
Evêques des diocèses des
nouvelles bienheureuses
avaient exposé une brève
synthèse de leur vie. Les
rites de béatification du 19
juin 2005 ont été présidés,
à Varsovie, par le Card.
Jòzef Glemp, Archevêque
diocésain et Primat de
Pologne.
III. Critères pour le
rite des futures
béatifications
La récente décision du
Saint-Père Benoît XVI, de ne
pas présider personnellement
les rites de béatification,
répond à l'exigence,
largement ressentie, de: a)
souligner davantage dans les
modalités de célébration la
différence significative
entre béatification et
canonisation; b) faire
participer de manière plus
visible les Eglises
particulières aux rites de
béatification des divers
Serviteurs de Dieu.
Au cours des nombreuses
béatifications célébrées par
Jean-Paul II dans toutes les
parties du monde, est
apparue avec une clarté
évidente l'opportunité
pastorale que les rites de
béatification se déroulent
de préférence dans les
Eglises locales, tout en
laissant la possibilité de
choisir Rome pour des
raisons particulières à
évaluer, au cas par cas, par
la Secrétairerie d'Etat.
Partout où se déroulent les
rites de béatification, que
ce soit à Rome ou ailleurs,
il est nécessaire
qu'apparaisse de façon
évidente que chaque
béatification est un acte du
Pontife romain, qui permet
(«facultatem facimus» selon
l'actuelle formule de
béatification) le culte
local d'un Serviteur de
Dieu, rendant publique sa
décision à travers une
Lettre apostolique.
Les rites de béatification
et de canonisation sont déjà
assez différents en
eux-mêmes; toutefois, le
fait que, depuis 1971, ils
aient été présidés
habituellement par le
Saint-Père a pratiquement
atténué aux yeux des fidèles
la différence substantielle
qui existe entre les deux
instituts.
IV.
Indications pratiques pour
le rite de béatification
Les indications qui suivent
concernent donc les rites
des béatifications,
célébrées soit en dehors de
Rome, soit à Rome, et non
présidées par le Saint-Père,
qui, bien entendu, pourra
toujours les présider, dans
les circonstances et selon
les modes qu'il jugera
opportuns.
a. Rites
de béatification dans les
Eglises particulières:
Il est opportun que
désormais, les rites de
béatification se déroulent
dans le diocèse qui a promu
la cause du nouveau
bienheureux, ou dans un
autre endroit plus adapté de
cette même Province
ecclésiastique ou région.
La date et le lieu de la
béatification, ainsi que les
éventuels regroupements des
Serviteurs de Dieu de divers
diocèses, seront établis par
l'Evêque diocésain (ou les
Evêques diocésains) et par
les postulateurs de la Cause
(ou des Causes), avec la
Secrétairerie d'Etat, comme
cela a été le cas jusqu'à
présent.
Le rite de béatification,
qui se déroulera au cours
d'une célébration
liturgique, commencera par
la présentation à
l'Assemblée des lignes
essentielles de la
biographie du futur
bienheureux. Normalement,
cette présentation sera
faite par l'Evêque diocésain
ou, s'il s'agit de plusieurs
Serviteurs de Dieu, par les
Evêques diocésains
respectifs, comme cela a eu
lieu au cours de la
béatification du 14 mai 2005
dans la Basilique
Saint-Pierre au Vatican.
Le Saint-Père nommera un
représentant qui donnera
lecture officielle de la
Lettre apostolique, par
laquelle le Pontife lui-même
accorde le titre et les
honneurs de bienheureux au
Serviteur de Dieu en
question. Normalement, le
Représentant du Pape sera le
Préfet de la Congrégation
pour les Causes des Saints.
Conformément à la pratique
la plus récente, le rite de
béatification se déroulera
au cours de la Célébration
eucharistique et plus
précisément, après l'acte de
pénitence et avant le chant
du «Gloria». Toutefois, des
motifs locaux particuliers
pourront laisser envisager
le déroulement du rite au
cours d'une Célébration de
la Parole ou de la Liturgie
des Heures. Sous le
Pontificat de Jean-Paul II,
quelques rares
béatifications ont été
célébrées au cours des
premières Vêpres du dimanche
ou d'une solennité.
La célébration liturgique en
l'honneur du nouveau
bienheureux sera présidée de
préférence par le
Représentant du Pape ou par
l'Evêque diocésain (ou
encore par l'un des Evêques
diocésains lorsqu'il s'agit
de bienheureux de divers
diocèses). C'est la
Secrétairerie d'Etat qui
décidera en la matière,
après consultation des
parties concernées.
Le Bureau des Célébrations
liturgiques du Souverain
Pontife coordonnera avec les
Eglises particulières tout
ce qui concerne le rite de
béatification.
b. Rites de béatification
à Rome
Les parties concernées
(Evêques et postulateurs de
la Cause) peuvent demander à
la Secrétairerie d'Etat que
le rite de béatification
d'un Serviteur de Dieu «non
romain» puisse se dérouler à
Rome plutôt que dans les
Eglises particulières
d'appartenance. Les
motivations de cette requête
seront évaluées par la
Secrétairerie d'Etat.
Pour les rites de
béatification qui ont lieu à
Rome, sont valables les
mêmes critères que ceux qui
réglementent les rites qui
se déroulent en dehors de
Rome.
On rappelle l'utilité des
«livrets» qui devraient
continuer à être préparés
par le Bureau des
Célébrations liturgiques du
Souverain Pontife, afin de
permettre une meilleure
participation des fidèles à
la célébration.
Enfin, il semble opportun
que le rite de béatification
soit sensiblement uniforme,
partout où il est célébré.
Il est donc souhaitable que
soit préparé au plus tôt un
«Ordo beatificationis et
canonizationis» par le
Bureau des Célébrations
liturgiques du Souverain
Pontife, en accord avec la
Congrégation pour les Causes
des Saints et la
Congrégation pour le Culte
divin et la Discipline des
Sacrements.
Notes
(1) Benoît XIV, le
«Magister» des Causes des
Saints, assimile les
Canonisations épiscopales
aux béatifications, qui
consistent dans la
concession (permissio) d'un
culte «pro aliquibus
determinatis locis» (De
Servorum Dei beatificatione
et beatorum canonizatione,
Prato 1839, L.I, chap; 31,
4, p. 196).
(2) «Doctores... tradunt
Beatificationem esse actum,
quo Summus Romanus Pontifex
indulgendo permittit aliquem
Dei Servum coli posse in
aliqua Provincia, Dioecesi
Civitate, aut Religiosa
Familia Cultu quodam
determinato, ac Beatorum
proprio, usquequo ad
solemnem eius Canonizationem
deveniatur» (Benedictus XIV,
L. , chap. 39, 5; p.262).
(3) (Ibid., p. 263).
(4)(I. Noval, Commentarium
Codicis Juris Canonici, Lib.
IV De Processibus, pars II,
Augustae Taurinorum-Romae
1932, p. 7).
(5) Cf. F. Veraja, La
Beatificazione. Storia,
problemi, prospettive, Roma;
éd. Congrégation pour les
Causes des Saints, 1983, pp.
7-111.
(6) C'est cequ'écrivait Mgr
Antonelli, Secrétaire du
dicastère: Archives de la
Congr., V AR, 107/966, in G.
Stano, Il rito della
Beatificazione da Alessandro
VII ai nostri giorni, in
Miscellenea per il quarto
Centenario della
Congregazione delle Cause
dei Santi (1588-1988), Città
del Vaticano, 1988, p. 401.
© L’Osservatore Romano en
langue française (Edition du
4 octobre)
ZF05100511
Je souhaite envoyer cette
information à un ami
TOP
-
Documents web -
Interventions
des pères du synode mardi
matin
ROME,
Mercredi 5 octobre 2005 (ZENIT.org)
– Il est possible de
consulter les résumés des
interventions des pères du
synode de mardi matin,
troisième congrégation
générale, dans la section
Documents de la page web
de Zenit.
ZF05100512
Je souhaite envoyer cette
information à un ami
TOP
----------------------------------------
Pour offrir un abonnement à
Zenit, en cadeau, cliquez
sur :
http://www.zenit.org/french/cadeau.html
----------------------------------------
|
|
|
|