| |
| |
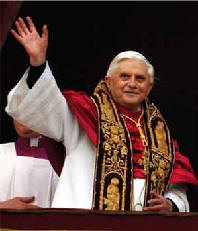  Tout
sur Joseph Alois Ratzinger-
Benoît XVI Tout
sur Joseph Alois Ratzinger-
Benoît XVI
 Lundi
3 octobre 2005 Lundi
3 octobre 2005
Spécial synode
Le synode
aborde la question de la
communion pour les chrétiens
d’autres confessions
L’ordination des hommes
mariés n’est pas la réponse
au manque de prêtres
Les
divorcés remariés et la
communion eucharistique
Homélie de
Benoît XVI lors de la messe
d’ouverture du synode
Signification et nouveautés
dans le déroulement du
synode, par Mgr Nikola
Eterović
Calendrier
des travaux du synode
Qu’est-ce
que le synode des évêques et
à quoi sert-il ?
Prière pour
le synode des évêques
Entretien
Le cardinal
Péter Erdö dévoile le visage
de l’Eglise en Hongrie (I)
International
Centre des
Volontaires de la Souffrance
: Faire de la douleur un
chemin de sainteté
-
Documents web -
Rapport
avant le débat général, par
le cardinal Scola
|
|
 |
|
|
| |
Spécial synode
Le synode
aborde la question de la communion pour les chrétiens d’autres
confessions
Intercommunion et hospitalité eucharistique
ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org)
– Parmi les thèmes abordés ce lundi par le synode figurait la
question de l’ « intercommunion », c’est-à-dire la possibilité pour
des chrétiens non catholiques de recevoir la communion
eucharistique. C’est ce qu’a précisé le rapporteur général du
synode, le cardinal Angelo Scola.
Dans son
«Rapport avant le débat général » («relatio ante disceptationem»),
le patriarche de Venise a reconnu qu’il s’agit d’un « problème
pastoral plutôt délicat », qui permet de mieux comprendre «
l’inséparable lien entre l’Eucharistie et l’Église ».
« La causalité de l’Eucharistie dans l’Église (l’Eucharistie fait
l’Église) est essentielle et prioritaire par rapport à celle de
l’Église sur l’Eucharistie (l’Église fait l’Eucharistie) », a-t-il
expliqué.
Rappelant que de nombreuses études ont été réalisées dans ce
domaine, il a souligné « souligner la substantielle communion de foi
entre l’Église catholique et les Églises orthodoxes en matière
d’Eucharistie et de sacerdoce. Une communion qui, à travers un
approfondissement réciproque plus important de la Célébration
Eucharistique et de la Divine Liturgie, est destinée à s’accroître
».
« Il faut, en outre, saluer positivement le nouveau climat
concernant l’Eucharistie dans les communautés ecclésiales nées de la
Réforme. À des degrés différents et à quelques exceptions près, même
ces communautés soulignent toujours plus l’importance décisive de
l’Eucharistie comme élément clef dans le dialogue et dans la
pratique œcuménique », a reconnu le patriarche.
Pour cette raison, a-t-il ajouté, « on peut comprendre pourquoi,
même après les déclarations du Magistère à ce propos, la question
suivante ne cesse d’être posée: l’«intercommunion» des fidèles
appartenant aux différentes Églises et communautés ecclésiales
peut-elle constituer un instrument adéquat dans le but de favoriser
le chemin vers l’unité des chrétiens ? ».
« La réponse dépend d’une considération attentive de la nature de
l’action eucharistique dans toute sa plénitude de mysterium fidei.
La célébration eucharistique, en effet, est de par sa nature,
profession de foi intégrale de l’Église », a-t-il répondu.
« Seulement dans la mesure où elle réalise la pleine profession de
foi apostolique dans ce mystère, l’Eucharistie fait l’Eglise. Si
c’est l’Eucharistie qui assure la véritable unité de l’Eglise, une
célébration ou une participation à l’Eucharistie, qui n’implique pas
le respect de l’ensemble des facteurs qui concourent à sa plénitude,
finirait, au-delà de toute bonne intention, par diviser
ultérieurement et à l’origine la communion ecclésiale.
L’intercommunion n’apparaît donc pas comme un moyen adéquat pour
atteindre l’unité des chrétiens », a poursuivi le cardinal Scola.
« Cette affirmation concernant l’intercommunion n’exclut pas qu’en
des circonstances tout à fait spéciales et dans le respect de
conditions objectives, l’on puisse admettre à la communion
eucharistique, en tant que ‘panis viatorum’, des personnes
appartenant à des Églises ou à des communautés ecclésiales qui ne
sont pas en pleine communion avec l’Église catholique », a déclaré
le cardinal Scola.
« Dans ce cas, une rigueur nécessaire exige que l’on parle
d’hospitalité eucharistique, a-t-il souligné. Nous sommes en
présence de la sollicitude pastorale (historique et salvifique) de
l’Église qui vient à la rencontre de la circonstance particulière
représentée par le besoin d’un fidèle baptisé ».
« Dans ces cas-ci, l’Église Catholique admet à la communion
eucharistique un fidèle non catholique s’il le demande spontanément,
manifeste une adhésion à la foi catholique concernant le sacrement
eucharistique et se trouve spirituellement bien disposé », a-t-il
poursuivi.
« Les problématiques concernant l’inadéquate catégorie
d’“intercommunion” et la pratique de l’hospitalité eucharistique
exigent une ultérieure réflexion à partir du lien intrinsèque entre
Eucharistie et Église, sur le rapport entre communion eucharistique
et communion ecclésiale. En ce sens, il pourrait être utile que
l’Assemblée Synodale revienne sur cet argument », a précisé le
cardinal italien.
Toutefois, « ne pas pouvoir accéder à la concélébration
eucharistique ni à la communion eucharistique de la part des
chrétiens de différentes Églises et communautés ecclésiales, et le
caractère exceptionnel de l’hospitalité eucharistique, ne peuvent
être seulement une source de douleur; elles doivent plutôt
représenter une incitation permanente à l’approfondissement continu
et commun du ‘mysterium fidei’ qui exige, de la part de tous les
chrétiens, l’unité dans l’intégrale profession de foi », a conclu le
cardinal Scola.
ZF05100301
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
L’ordination des hommes
mariés n’est pas la réponse au manque de prêtres
Déclarations du rapporteur du synode
ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org)
– L’Eglise pourrait-elle, pour faire face à la pénurie de prêtres,
ordonner des fidèles mariés ? Le rapporteur du synode, le cardinal
Angelo Scola a présenté cette question, que certains se posent, au
synode des évêques réuni ce lundi pour sa première session.
Le cardinal Scola a précisé que certains, « guidés par le principe
‘salus animarum suprema lex’ [le salut des âmes est la loi suprême,
ndlr], avancent la requête que soient ordonnés des fidèles mariés,
de foi et de vertu sûres, les viri probati ».
« La demande est souvent accompagnée par la reconnaissance positive
de la bonté de la discipline séculaire du célibat sacerdotal,
explique le cardinal Scola dans son
«
Rapport avant le débat général ».
Ces mêmes personnes affirment toutefois, explique-t-il que « cette
loi ne devrait pas empêcher de doter l’Eglise d’un nombre adéquat de
ministres ordonnés, au cas où la pénurie de candidats au sacerdoce
célibataire atteindrait des proportions extrêmement graves ».
Le patriarche de Venise estime qu’il « n’est pas nécessaire
d’insister ici sur les raisons théologiques profondes qui ont amené
l’Eglise latine à unir l’attribution du sacerdoce ministériel au
charisme du célibat ».
« Mais une question s’impose, affirme-t-il : ce choix et cette
pratique sont-ils viables sur le plan pastoral même dans des cas
extrêmes comme ceux que l’on vient de mentionner ? »
« Etant strictement lié à l’Eucharistie, a expliqué le cardinal
Scola, le sacerdoce ordonné participe de sa nature de don et ne peut
être l’objet d’un droit. S’il est un don, le sacerdoce ordonné doit
être sans cesse demandé. Il est alors très difficile d’établir le
nombre idéal de prêtres au sein de l’Eglise, puisqu’il ne s’agit pas
d’une “entreprise” qui aurait besoin d’un certain nombre de
“cadres”! »
« Sur le plan pratique, l’urgence impérative du ‘salus animarum’
pousse à réaffirmer avec vigueur, surtout ici, la responsabilité que
chaque Eglise particulière a, à l’égard de l’Eglise universelle, et
par conséquent à l’égard de toutes les autres Eglises particulières.
Les propositions qui seront présentées à cette Assemblée synodale en
vue d’identifier les critères pour une distribution plus adéquate du
clergé dans le monde seront d’une grande utilité. A ce sujet, il
semble que le chemin à accomplir soit encore long », a souligné le
rapporteur du synode.
« Il convient peut-être de rappeler aussi que, au cours de
l’histoire, la Providence a appuyé la valeur prophétique et
éducative du célibat, a conclu le cardinal Scola, en demandant entre
autres une disponibilité spéciale pour le ministère sacerdotal dans
les différentes formes de vie consacrée, dans le respect de leur
charisme et de leur histoire. On peut citer ici la pratique de
l’ordination des moines dans les Eglises orientales ou dans la
tradition bénédictine ».
ZF05100302
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
Les divorcés remariés et la
communion eucharistique
Propositions du rapporteur général du synode des évêques
ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org)
– Dans son
«
Rapport avant le débat général », présenté ce lundi, le
rapporteur général du synode, le cardinal Angelo Scola, a évoqué la
question délicate de l’accès à la communion eucharistique pour les
divorcés remariés.
« Personne n’ignore la tendance diffuse chez les divorcés remariés à
la communion eucharistique, malgré l’enseignement de l’Église en la
matière », a déclaré le cardinal Scola.
Le patriarche de Venise reconnaît qu’à la base de cette tendance «
il n’y a pas simplement de la superficialité ».
Il explique que « de nombreux baptisés se sont unis en mariage
sacramentel par une adhésion mécanique à la tradition ».
« Parmi ces derniers, nombreux sont ceux qui divorcent et se
remarient. Mettant en pratique la vie chrétienne, certains
manifestent un grave malaise et souvent une grande douleur face au
fait que l’union contractée à la suite du mariage leur empêche une
pleine participation à la réconciliation sacramentelle et à la
communion eucharistique », poursuit-il.
Rappelant les enseignements de Jean-Paul II dans « Familiaris
consortio », le cardinal explique qu’« il faut que toute la
communauté chrétienne soutienne les divorcés remariés dans la
conscience de ne pas être exclus de la communion ecclésiale. La
participation à la célébration eucharistique permet, en tout cas,
cette communion spirituelle qui, si elle est bien vécue, fait écho
au sacrifice même de Jésus Christ ».
« L’enseignement du Magistère ne tend pas seulement à éviter la
propagation d’une mentalité contraire à l’indissolubilité du mariage
et le scandale du peuple de Dieu. Il nous met, au contraire, en face
de la reconnaissance du lien objectif qui unit le sacrement de
l’Eucharistie à l’ensemble de la vie du chrétien et, en particulier,
au sacrement du mariage », ajoute le cardinal Scola.
« L’unité de l’Église, qui est toujours un don de Son Époux, découle
en effet de façon permanente de l’Eucharistie (cf. 1Cor 10, 17),
souligne-t-il. Ainsi, dans le mariage chrétien, en vertu du don
sacramentel de l’Esprit, le lien conjugal, dans sa nature publique,
fidèle, indissoluble et féconde, est intrinsèquement lié à l’unité
eucharistique entre le Christ époux et l’Église épouse (cf. Ef 5,
31-32). De telle façon, le consensus réciproque que le mari et la
femme s’échangent en le Christ et qui les constituent en communauté
de vie et d’amour conjugal a, pour ainsi dire, une forme
eucharistique.
Le cardinal italien reconnaît que « dans cette Assemblée, il faudra
toutefois approfondir ultérieurement les modalités objectives afin
de vérifier l’hypothèse de nullité du mariage canonique, tout en
prêtant une grande attention aux cas différents et complexes qui se
présentent ».
« La reconnaissance de la nullité du mariage doit impliquer une
instance objective qui ne peut se réduire à la simple conscience des
époux, même si cette dernière est soutenue par l’avis d’un guide
spirituel illuminé », précise le rapporteur général du synode.
« C’est justement pour cela qu’il est indispensable de continuer
dans l’œuvre de réflexion sur la nature et l’action des tribunaux
ecclésiastiques afin qu’ils représentent toujours plus une
expression de la vie pastorale normale de l’Église locale »,
poursuit le cardinal Scola.
« Outre la vigilance continue sur les temps et les coûts, on pourra
prévoir des figures et des procédures juridiques plus simples et qui
puissent répondre plus efficacement au soin pastoral. À ce propos,
on ne manque certes pas de significatives expériences dans de
nombreux diocèses. Dans cette Assemblée, les Pères synodaux auront
l’occasion d’en faire connaître d’autres », souligne le cardinal.
Le patriarche de Venise insiste sur la préparation au mariage qui «
reste de toute façon définitive », « tout comme un accompagnement
quotidien de la vie des familles au sein de la grande demeure
ecclésiale ».
« Enfin, le soin et la valorisation des nombreuses initiatives
vouées à accompagner les divorcés remariées à vivre au sein de la
communauté chrétienne avec sérénité le sacrifice lié objectivement à
leur condition, revêt une importance tout à fait particulière »,
conclut le cardinal Scola.
ZF05100303
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
Homélie de
Benoît XVI lors de la messe d’ouverture du synode
ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org)
– Nous publions ci-dessous le texte intégral de l’homélie que le
pape Benoît XVI a prononcée lors de la messe d’ouverture du synode
qui s’est déroulée dimanche matin 2 octobre en la basilique Saint
Pierre.
* * *
La lecture tirée du prophète Isaïe et l’Évangile de ce jour mettent
sous nos yeux l’une des grandes images de l’Ecriture Sainte: l’image
de la vigne. Le pain représente dans l’Écriture Sainte tout ce dont
l’homme a besoin dans sa vie quotidienne. L’eau donne à la terre la
fertilité: c’est le don fondamental, qui rend possible la vie. Le
vin, en revanche, exprime la délicatesse de la création, il nous
offre la fête dans laquelle nous dépassons les limites du quotidien:
le vin “réjouit le cœur”. Ainsi le vin et avec lui la vigne sont-ils
également devenus des images du don de l’amour, dans lequel nous
pouvons faire dans une certaine mesure l’expérience de la saveur du
Divin. Et ainsi la lecture du prophète, que nous venons d’écouter,
commence-t-elle comme un cantique d’amour: Dieu s’est créé une vigne
- c’est là une image de son histoire d’amour avec l’humanité, de son
amour pour Israël, qu’Il s’est choisi. Le premier enseignement des
lectures d’aujourd’hui est donc celui-ci: à l’homme, créé à son
image Dieu a insufflé sa capacité d’aimer et donc la capacité de
L’aimer Lui aussi, son Créateur. À travers le cantique d’amour du
prophète Isaïe, Dieu veut parler au cœur de son peuple - ainsi qu’à
chacun de nous. “Je t’ai créé à mon image et ressemblance”, dit-il à
chacun de nous. “Moi-même, je suis l’amour, et tu es mon image dans
la mesure où, en toi, brille la splendeur de l’amour, dans la mesure
où tu me réponds avec amour”. Dieu nous attend. Il veut être aimé de
nous: un semblable appel ne devrait-il donc pas toucher notre cœur?
En cette heure précisément où nous célébrons l’Eucharistie, où nous
inaugurons le Synode sur l’Eucharistie, Il vient à notre rencontre,
il vient à ma rencontre. Trouvera-t-il une réponse? Ou arrive-t-il
avec nous ce qu’il se passe avec la vigne, à propos de laquelle Dieu
dit à Isaïe: “Il attendait de beaux raisins: elle donna des raisins
sauvages”? Notre vie chrétienne n’est-elle donc pas plus souvent du
vinaigre que du vin? Commisération sur nous-même, conflit,
indifférence?
Nous sommes ainsi naturellement arrivés au deuxième enseignement
fondamental des lectures d’aujourd’hui. Celles-ci parlent avant tout
de la bonté de la création de Dieu et de la grandeur de l’élection à
travers laquelle Il nous recherche et Il nous aime. Mais elles
parlent également de l’histoire qui a eu lieu ensuite - de l’échec
de l’homme. Dieu avait planté des vignes d’excellente qualité et,
toutefois, du raisin sauvage a mûri. En quoi consiste ce raisin
sauvage? Le bon raisin que Dieu attendait - dit le prophète - aurait
dû consister dans la justice et dans la rectitude. Le raisin
sauvage, ce sont en revanche la violence, le sang répandu et
l’oppression, qui font gémir les peuples sous le joug de
l’injustice. Dans l’Évangile, l’image change: la vigne produit du
bon raisin, mais les vignerons le gardent pour eux. Ils ne sont pas
disposés à le remettre au propriétaire. Ils battent et ils tuent les
messagers qu’il a envoyés et ils tuent son Fils. Leur motivation est
simple: ils veulent devenir eux-mêmes les propriétaires; ils
prennent possession de ce qui ne leur appartient pas. Dans l’Ancien
Testament, on trouve au premier plan l’accusation de violation de la
justice sociale, du mépris de l’homme de la part de l’homme. En
arrière plan, toutefois, apparaît que, à travers le mépris de la
Torah, du droit donné par Dieu, c’est Dieu lui-même qui est méprisé;
l’on veut seulement jouir de son propre pouvoir. Cet aspect est
pleinement mis en évidence dans la parabole de Jésus: les vignerons
ne veulent pas avoir de propriétaire - et ces vignerons constituent
également pour nous un miroir. Nous les hommes, auxquels la création
est pour ainsi dire confiée en gestion, nous l’usurpons. Nous
voulons en être les propriétaires au premier chef et tous seuls.
Nous voulons posséder le monde et notre propre vie de manière
illimitée. Dieu nous est une entrave. Ou bien on Le réduit à une
simple phrase pieuse ou bien Il est nié totalement, mis au ban de la
vie publique, au point de perdre toute signification. La tolérance,
qui admet pour ainsi dire Dieu comme une opinion privée, mais lui
refuse le domaine public, la réalité du monde et de notre vie, n’est
pas tolérance, mais hypocrisie. Mais là où l’homme se fait le seul
propriétaire du monde et propriétaire de lui-même, la justice ne
peut pas exister. Là, ne peut dominer que l’arbitraire du pouvoir et
des intérêts. Bien sûr, l’on peut chasser le Fils hors de la vigne
et le tuer, pour goûter de manière égoïste, tous seuls, les fruits
de la terre. Mais alors, la vigne se transforme bien vite en un
terrain inculte piétiné par les sangliers, comme nous dit le Psaume
responsorial (cf. Ps 79, 14).
Nous parvenons ainsi au troisième élément des lectures de ce jour.
Le Seigneur, dans l’Ancien comme dans le Nouveau Testament, annonce
le jugement à la vigne infidèle. Le jugement qu’Isaïe prévoyait
s’est réalisé au travers des grandes guerres et des exils pratiqués
par les Assyriens et les Babyloniens. Le jugement annoncé par le
Seigneur Jésus se réfère surtout à la destruction de Jérusalem en
l’an 70. Mais la menace de jugement nous concerne nous aussi,
l’Église en Europe, l’Europe et l’Occident en général. Par cet
Évangile, le Seigneur crie jusque dans nos oreilles les paroles
qu’il adresse dans l’Apocalypse à l’Église d’Éphèse: “Si tu ne te
repens, je vais venir à toi pour changer ton candélabre de son rang”
(2,5). À nous aussi, la lumière peut être enlevée et nous faisons
bien si nous laissons résonner cet avertissement en notre âme avec
tout son sérieux, en criant dans le même temps au Seigneur:
“Aide-nous à nous convertir! Donne à chacun de nous la grâce d’un
véritable renouvellement! Ne permets pas que la lumière qui est au
milieu de nous s’éteigne! Renforce notre foi, notre espérance et
notre amour afin que nous puissions porter de bons fruits!”.
Dès lors, se pose à nous cette question: “Mais n’y a-t-il aucune
promesse, aucune parole de réconfort dans la lecture et dans la page
d’évangile de ce jour? La menace serait-elle le dernier mot?” Non!
La promesse existe et c’est elle qui constitue le dernier mot, le
mot essentiel. Nous l’entendons dans le verset de l’Alléluia, tiré
de l’Évangile de Jean: “Je suis la vigne; vous, les sarments. Celui
qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit”
(Jn 15, 5). Par ces paroles du Seigneur, Jean nous illustre la fin
dernière et véritable de l’histoire de la vigne de Dieu. Dieu ne
faillit pas. À la fin, il remporte la victoire, l’amour sort
vainqueur. Une allusion voilée à cette victoire se trouve déjà dans
la parabole de la vigne proposée par l’Évangile d’aujourd’hui et
dans ses paroles conclusives. Même à ce moment-là, la mort du Fils
ne constitue pas la fin de l’histoire, même si elle n’est pas
directement racontée. Mais Jésus exprime cette mort par le biais
d’une nouvelle image tirée du Psaume: “La pierre qu’avaient rejetée
les bâtisseurs c’est elle qui est devenue pierre de faîte...” (Mt
21, 42; Ps 117, 22). De la mort du Fils surgit la vie, un nouvel
édifice se forme, une nouvelle vigne. Lui, qui à Cana, changea l’eau
en vin, a transformé son sang dans le vin du véritable amour et
transforme ainsi le vin en son sang. Dans le cénacle, il a anticipé
sa mort et l’a transformée en don de soi, en un acte d’amour
radical. Son sang est don, il est amour, et pour cette raison, il
est le vrai vin que le Créateur attendait. De cette manière, le
Christ même est devenu la vigne et cette vigne porte toujours du bon
fruit: la présence de son amour pour nous, qui est indestructible.
Ainsi, ces paraboles débouchent à la fin sur le mystère de
l’Eucharistie, dans laquelle le Seigneur nous donne le pain de la
vie et le vin de son amour et nous invite à la fête de l’amour
éternel. Nous célébrons l’Eucharistie bien conscients que son prix
fut la mort du Fils - le sacrifice de sa vie, qui, en elle, reste
présent. Chaque fois que nous mangeons ce pain et buvons à cette
coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne,
nous dit saint Paul (cf. Co 11, 26). Mais nous savons également que,
de cette mort provient la vie, parce que Jésus l’a transformée en un
geste oblatif, en un acte d’amour, en la modifiant ainsi
profondément: l’amour a vaincu la mort. Dans la sainte Eucharistie,
Il nous attire tous à Lui depuis la croix (Jn 12, 32) et nous fait
devenir des sarments de la vigne qu’Il est lui-même. Si nous
demeurons unis à Lui, alors nous porterons du fruit nous aussi,
alors, nous aussi, nous ne produirons plus le vinaigre de
l’autosuffisance, du mécontentement de Dieu et de sa création, mais
le bon vin de la joie de Dieu et de l’amour du prochain. Nous prions
le Seigneur de nous donner sa grâce, afin que, dans les trois
semaines du Synode que nous débutons, nous ne disions pas seulement
de belles choses à propos de l’Eucharistie, mais surtout que nous
vivions de sa force. Nous invoquons ce don par l’intercession de
Marie, chers Pères synodaux, que je salue avec tant d’affection,
ainsi que les Communautés desquelles vous provenez et que vous
représentez ici, afin que, dociles à l’action de l’Esprit Saint,
nous puissions aider le monde à devenir dans le Christ et avec le
Christ la vigne féconde de Dieu. Amen.
[Traduction de l’italien distribuée par le secrétariat général du
synode des évêques]
ZF05100304
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
|
|
|
 |
|
|
| |
Signification et
nouveautés dans le déroulement du synode, par Mgr Nikola Eterović
Texte intégral de l’intervention du secrétaire général du
synode, samedi 1er octobre
ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org)
– Nous publions ci-dessous le texte de l’intervention de samedi
dernier, 1er octobre, du secrétaire général du synode des
évêques, Mgr Nikola Eterovic, sur la signification et le
développement de l’assemblée synodale.
* * *
Demain 2 Octobre, débutera la XI Assemblée Générale Ordinaire du
Synode des Évêques sur le thème: L’Eucharistie: source et sommet
de la vie et de la mission de l’Église. Le Synode des Évêques
commence par la Messe, présidée par Sa Sainteté Benoît XVI et
concélébrée par près de 350 pères synodaux et autres
participants à la réunion synodale. Il est significatif que le
Synode des Évêques, qui a pour thème l’Eucharistie, commence par
la célébration de la Messe. Par ce geste, les pères synodaux,
élus au sein de l’épiscopat de l’Église Catholique et donc, le
Peuple de Dieu présent dans le monde entier, rendent louange à
Dieu le Père qui est aux cieux et invoquent la grâce de l’Esprit
Saint, don du Seigneur Jésus Christ ressuscité et présent au
milieu des siens, en particulier dans le sacrement de
l’Eucharistie. C’est dans une telle perspective de foi,
d’espérance et de charité eucharistique que se dérouleront les
travaux synodaux.
La célébration de la XI Assemblée Générale Ordinaire du Synode
des Évêques a lieu lors du 40ème anniversaire de son
institution, le 15 Septembre 1965, de la part du Serviteur de
Dieu, le Pape Paul VI, avec motu proprio Apostolica sollicitudo.
Il n’est donc pas surprenant qu’au cours de la prochaine
assemblée, une session soit consacrée à la commémoration de cet
important événement ecclésial. Le Synode des Évêques, un des
fruits prometteurs du Concile Vatican II, a démontré, au cours
des quatre dernières décennies, qu’il constituait un instrument
très valable en vue de l’exercice de la collégialité épiscopale
et de l’approfondissement de la communion ecclésiale. Dans la
Lettre Apostolique Apostolica sollicitudo que nous avons déjà
mentionnée, ont été indiquées clairement tant la nature que la
finalité du Synode des Évêques. Ces caractéristiques propres ont
ensuite été recueillies et exprimées en termes juridiques dans
les canons 342 à 348 du Code de Droit canonique. Peut-être
n’est-il pas inutile de rappeler qu’outre à renforcer les liens
d’union entre les Évêques et entre ceux-ci et le Saint-Père,
Évêque de Rome, le Synode a pour but d’assister et de conseiller
le Souverain Pontife dans la sauvegarde et le renforcement de la
foi et des moeurs, ainsi que dans l’observance et la
consolidation de la discipline ecclésiastique. En outre, il
relève de la mission du Synode d’étudier les problèmes relatifs
à l’activité de l’Église dans le monde et de suivre avec une
attention particulière l’activité missionnaire de l’Église.
Depuis son institution, voici 40 ans, le Synode des Évêques a
apporté une contribution notable à la promotion du caractère
synodal de l’Église Catholique, lié à des questions d’importance
fondamentale pour la vie de la communauté des fidèles, questions
qui correspondent, en grande partie, aux thèmes des différentes
réunions synodales. Dans cette œuvre, un rôle particulier a été
revêtu par les Conseils ordinaires, extraordinaires ou spéciaux
de la Secrétairerie du Synode des Évêques au travers de
nombreuses réunions de préparation et d’application, en étroite
union avec le Saint-Père, Chef du Corps épiscopal et Président
du Synode des Évêques. L’expression privilégiée de cet aspect
synodal, caractérisé par sa dimension collégiale, a été atteint
au cours de 20 Assemblées synodales, dont 10 Ordinaires, deux
Extraordinaires et huit Spéciales. Avec cette prochaine XI
Assemblée Générale Ordinaire, le nombre des Assemblées synodales
s’élèvera à 21. Sachant que son existence remonte à 40 ans, il
en résulte qu’un Synode des Évêques a eu lieu tous les 19 mois
au sein de l’Église Catholique.
Quelques données relatives à la
prochaine réunion synodale
Au prochain Synode des Évêques, participeront 256 pères synodaux
provenant de 118 pays. Il s’agit du plus grand nombre de
participants à une réunion synodale. Par exemple, le Synode de
2001 avait compté 247 pères synodaux.
Au nombre de ces 256 pères synodaux, 177 ont été élus, 39
participent ex officio, 40 sont nommés par le Saint-Père. Parmi
eux, se trouvent entre autres 55 Cardinaux, 8 Patriarches, 82
Archevêques, 123 Évêques, 36 Présidents de Conférences
épiscopales et 12 Religieux.
Les pères synodaux proviennent de tous les continents. En
particulier, 50 proviennent d’Afrique, 59 d’Amérique, 44 d’Asie,
95 d’Europe et 8 d’Océanie.
Sont par ailleurs présents 32 Experts et 27 Auditeurs provenant
des cinq continents. Une contribution importante au déroulement
des travaux est par ailleurs fournie par les Assistants et,
naturellement, par les traducteurs dans les 6 langues du Synode:
latin, italien, français, espagnol, anglais et allemand.
Douze Églises et communautés ecclésiales ont également été
invitées à envoyer leurs représentants au Synode des Évêques, et
dix d’entre elles ont, pour l’heure, indiqué le nom de leurs
représentants. Les Délégués fraternels participent aux travaux
et peuvent intervenir mais ne peuvent pas voter. Cette
prérogative appartient en effet aux 256 pères synodaux.
Pour la préparation de l’assemblée synodale, les membres de la
Secrétairerie générale, équipe réduite quant au nombre mais
dynamique, et à qui vont mes plus sincères remerciements, ont
effectué un excellent travail, souvent même de façon silencieuse
et en toute abnégation.
Nouveautés en termes de méthodologie
synodale
Sur la base du calendrier des travaux, il est facile de
constater que sont prévues 23 Congrégations générales et 7
sessions pour les Carrefours.
Le Saint-Père Benoît XVI a bien volontiers approuvé certaines
nouveautés quant à la méthodologie synodale, nouveautés qui ont
pour but de rendre la réunion synodale plus souple, de permettre
une plus grande participation, et par conséquent une
collégialité encore plus grande.
Étant donné que le Synode aura une durée de trois et non pas de
quatre semaines, et que le nombre des participants est très
élevé, il a été nécessaire de réduire la durée des interventions
des pères synodaux de huit à six minutes et de diminuer le
nombre de sessions des Carrefours.
Les pères synodaux sont priés de suivre un certain ordre en
matière de prises de parole, en suivant les quatre parties de l’Instrumentum
laboris. Cette suggestion, par ailleurs déjà présente dans
l’Ordo Synodi, devrait faciliter la concentration de la
réflexion qui connaîtra un moment privilégié au cours des
discussions libres dans la salle du Synode, au terme des
Congrégations générales quotidiennes, à savoir de 18 à 19
heures.
Afin de favoriser une plus importante participation, les pères
synodaux éliront huit membres de la Commission pour le Message
qui sera approuvé par l’Assemblée et publié au terme des
travaux. Quatre autres membres de cette même Commission seront
nommés par le Saint-Père.
Pour des raisons pratiques, le vote électronique sera introduit
ad experimentum pour des décisions de moindre importance.
La salle du Synode a été modernisée, en particulier en ce qui
concerne l’éclairage, l’air conditionné et les services vidéo.
Il s’agit d’un certain nombre d’innovations méthodologiques, qui
s’inscrivent bien dans l’histoire de l’institution synodale. En
effet, en quarante ans, la méthode des travaux synodaux a connu
différentes modifications visant, en fin de compte, à favoriser
l’approfondissement de la collégialité épiscopale, en offrant
des conseils valides au Saint-Père dans l’exercice du primat
pétrinien pour le bien de l’Église Universelle.
Il est probable qu’aucune Assemblée synodale n’a été célébrée,
comme celle-ci, dans une telle atmosphère de prière si fervente
et de participation religieuse de millions de fidèles qui, en
cette Année de l’Eucharistie, invoquent du Seigneur la grâce de
trouver Celui qu’ils ont déjà rencontrés dans la célébration de
la Messe, mémorial de la Passion, mort et résurrection du
Seigneur Jésus, re-présentation de son sacrifice, participation
personnelle et communautaire au banquet des noces de l’Agneau
immolé. Cette atmosphère de religieuse attente et de
participation offre l’espérance fondée que la prière chorale de
l’Église sera écoutée par Dieu, Un et Trine, et que, du Synode
des Évêques, pourra découler un élan renouvelé dans l’annonce de
l’Évangile, bonne nouvelle pour l’homme contemporain, nouvelle
évangélisation centrée sur le mystère eucharistique, dont les
conséquences ne manqueront pas de favoriser une renaissance de
la vie de foi, d’espérance et de charité, que les fidèles
ouverts à l’inspiration de l’Esprit Saint, ne manqueront pas de
traduire, dans le cadre d’une créativité caritative adaptée, en
de nombreuses œuvres de promotion humaine.
[Traduction de l’italien distribuée par le secrétariat
général du synode des évêques]
ZF05100305
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
Calendrier des travaux
du synode
ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org)
– Nous publions ci-dessous le calendrier des travaux du synode,
distribué par le secrétariat général du synode des évêques.
Dimanche 2 octobre
9.30
Inauguration solennelle avec concélébration de la Sainte Messe
en la Basilique Patriarcale de Saint-Pierre
Lundi 3 octobre
9.00 - 12.30
1ère Congrégation générale
Salutation du Président Délégué
Rapport du Secrétaire Général
Rapport avant le débat général
16.30 - 19.00
2ème Congrégation générale
Début de la discussion génerale
18.00 - 19.00
Interventions libres
Mardi 4 octobre
9.00 - 12.30
3ème Congrégation générale
Élection de la Commission du message - I
Continuation de la discussion générale
16.30 - 19.00
4ème Congrégation générale
Continuation de la discussion générale
18.00 - 19.00
Interventions libres
Mercredi 5 octobre
9.00 - 12.30
Carrefours (Ie Session)
Élection des Modérateurs et des Rapporteurs
Discussion sur le thème du Synode
16.00
Réunion des Modérateurs et des Rapporteurs
16.30 - 19.00
5ème Congrégation générale
Continuation de la discussion générale
18.00 - 19.00
Interventions libres
Jeudi 6 octobre
9.00 - 12.30
6ème Congrégation générale
Élection de la Commission du message - II
Continuation de la discussion générale
16.30 - 19.00
7ème Congrégation générale
Continuation de la discussion générale
18.00 - 19.00
Interventions libres
Vendredi 7 octobre
9.00 - 12.30
8ème Congrégation générale
Continuation de la discussion générale
16.30 - 19.00
9ème Congrégation générale
Continuation de la discussion générale
18.00 - 19.00
Interventions libres
Samedi 8 octobre
9.00 - 12.30
10ème Congrégation générale
Continuation de la discussion générale
16.30 - 19.00
Commémoration du XLº Anniversaire de l’Institution du Synode des
Évêques
Dimanche 9 octobre
Repos
Lundi 10 octobre
9.00 -12.30
11ème Congrégation générale
Continuation de la discussion générale
16.30 - 19.00
12ème Congrégation générale
Continuation de la discussion générale
18.00 - 19.00
Interventions libres
Mardi 11 octobre
9.00 - 12.30
13ème Congrégation générale
Continuation de la discussion générale
Audition des Auditeurs (I)
16.30 - 19.00
14ème Congrégation générale
Continuation de la discussion générale
Audition des Délégués fraternels
18.00 - 19.00
Interventions libres
Mercredi 12 octobre
9.00 - 12.30
15ème Congrégation générale
Continuation de la discussion générale
Audition des Auditeurs (II)
l6.30 -19.00
16ème Congrégation générale
Rapport après le débat général
Jeudi 13 octobre
9.00 - 12.30
Carrefours (IIe Session)
Préparation des Propositions
16.30 - 19.00
Carrefours (IIIe Session)
Préparation des Propositions
Vendredi 14 octobre
9.00 - 12.30
Carrefours (IVe Session)
Préparation des Propositions
16.30 - 19.00
17ème Congrégation générale
Présentation en Salle des Rapports des Carrefours
19.00
Remise des Propositions à la Secrétairerie Générale
Samedi 15 octobre
9.00 - 12.30
18ème Congrégation générale
Élection du Conseil (I)
Présentation du schéma du Message
Discussion du Message
16.30
Audience du Souverain Pontife avec les enfants de la Première
Communion
16.30-19.00
Pas de Congrégation
Réunification des Propositions par le Rapporteur Général, le
Secrétaire Spécial et les Rapporteurs des Carrefours
Dimanche 16 octobre
Repos
Réunification des Propositions par le Rapporteur Général, le
Secrétaire Spécial et les Rapporteurs des Carrefours
Lundi 17 octobre
9.00 - 12.00
Pas de Congrégation
Réunification des Propositions par le Rapporteur Général, le
Secrétaire Spécial et les Rapporteurs des Carrefours
16.30 - 19.00
Pas de Congrégation
Réunification des Propositions par le Rapporteur Général, le
Secrétaire Spécial et les Rapporteurs des Carrefours
Mardi 18 octobre
9.00 - 12.30
19ème Congrégation générale
Présentation de la Liste unifiée des Propositions
16.30 - 19.00
Carrefours (Ve Session)
Préparation des Amendements aux Propositions
Mercredi 19 octobre
9.00 - 12.30
Carrefours (VIe Session)
Préparation des Amendements aux Propositions
16.30 - 19.00
Carrefours (VIIe Session)
Préparation des Amendements aux Propositions
19.00
Remise des Amendements collectifs à la Secrétairerie Générale
Jeudi 20 octobre
9.00 - 12.30
Pas de Congrégation
Étude des Amendements collectifs aux Propositions par le
Rapporteur Général, le Secrétaire spécial et les Rapporteurs des
Carrefours
16.30 - 19.00
Pas de Congrégation
18.00
Concert Symphonique
Étude des Amendements collectifs aux Propositions par le
Rapporteur Général, le Secrétaire spécial et les Rapporteurs des
Carrefours
Vendredi 21 octobre
9.00 - 12.30
20ème Congrégation générale
Élection du Conseil (II)
Présentation et approbation du Message
Étude des Amendements collectifs aux Propositions par le
Rapporteur Général, le Secrétaire spécial et les Rapporteurs des
Carrefours
17.30 - 19.00
21ème Congrégation générale
Présentation des Propositions amendées
Samedi 22 octobre
9.00 - 12.30
22ème Congrégation générale
Vote des Propositions: Placet - Non Placet
13.00
Repas fraternel avec le Saint-Père
17.30 - 19.00
23ème Congrégation générale
Résultat du vote des Propositions
Conclusion - Salutations
Dimanche 23 octobre
10.00
Concélébration solennelle de la Sainte Messe en conclusion du
Synode en la Basilique Patriarcale de Saint-Pierre
Cité du Vatican, le 14 Septembre 2005
Nikola Eterović
Archevêque titulaire de Sisak
Secrétaire Général
[Traduction de l’original en latin distribuée par le
secrétariat général du synode des évêques]
ZF05100306
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
Qu’est-ce que le synode des évêques et à quoi sert-il ?
ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org)
– « Le Synode des Évêques est une institution permanente établie
par le Pape Paul VI, le 15 septembre 1965, en réponse au désir
exprimé par les Pères du Concile Vatican II de maintenir vivant
l'esprit engendré par l'expérience conciliaire », explique un
document distribué par le secrétariat général du synode des
évêques.
« Le mot «synode» vient de deux mots grecs: syn qui signifie
«ensemble», et hodos qui signifie «chemin» ou «marcher ensemble»
».
« Le Synode se définit, généralement, comme une assemblée
d’évêques représentant l’épiscopat catholique, et ayant le
devoir d’aider le Pape à gouverner l’Église universelle en
remettant leurs avis. Le Pape Jean-Paul II a désigné le Synode
comme “une expression particulièrement féconde et un instrument
de la collégialité des évêques” (Discours au Conseil de la
Secrétairerie du Synode des Évêques, le 30 avril 1983: L’Osservatore
Romano, 1º mai 1983) ».
Le cardinal Silvio Oddi, alors archevêque et Pro-Nonce
apostolique en République Arabe Unie (Égypte), proposait, le 5
novembre 1959, d’établir « un corps consultatif ». Il déclarait:
« On se plaint, en beaucoup d’endroits dans le monde, de ce que
l’Église n’ait pas, en plus des Congrégations Romaines, un
organisme consultatif permanent. Aussi, une sorte de ‘Concile en
miniature’ devrait-il être établi, comprenant des représentants
de toute l’Église qui se réunirait périodiquement, ne fut-ce
qu’une fois par an, pour discuter des problèmes majeurs, et pour
suggérer de nouvelles pistes possibles dans les tâches
s’imposant à l’Église ».
Le 22 décembre 1959, le cardinal Bernardus Alfrink, archevêque
d’Utrecht, écrivait: « En termes clairs, le Concile proclame que
le gouvernement de l’Église universelle est, de droit, exercé
par le collège des évêques avec le Pape à sa tête. Il s’ensuit
qu’en un sens chaque évêque pris individuellement est
responsable du soin de l’Église universelle, et que, par
ailleurs aussi, tous les évêques participent au gouvernement de
l’Église universelle. Cela peut se faire non seulement par la
convocation d’un Concile oecuménique, mais aussi par la création
d’institutions nouvelles. Peut-être un conseil permanent
d’évêques particulièrement qualifiés, choisis dans toute
l’Église, pourrait-il remplir une fonction législative en union
avec le Souverain Pontife et les cardinaux de la Curie Romaine.
Les Congrégations Romaines ne garderaient alors qu’un pouvoir
consultatif et exécutif ».
« Finalement, à la fin du discours inaugural de la dernière
Session du Concile Vatican II (14 septembre 1965), Paul VI
lui-même rendit publique son intention d’établir le Synode des
Évêques, en ces termes: « Cela Nous est une joie d’annoncer que
va être institué, selon le souhait de ce Concile, un ‘Synode des
Évêques’, constitué d’évêques nommés en majorité par les
Conférences épiscopales, avec notre approbation. Ce Synode sera
convoqué par le Souverain Pontife, selon les besoins de
l’Église, afin d’apporter ses avis et son concours, quand le
bien général de l’Église paraîtra l’exiger ».
Le lendemain matin, le 15 septembre 1965, à l'ouverture de la
128ème Assemblée Générale, Mgr Pericle Felici, Secrétaire
Général du Concile, annonçait la promulgation du Motu proprio
Apostolica sollicitudo qui instituait officiellement le Synode
des Évêques.
« La caractéristique principale du Synode des Évêques est d’être
au service de la communion et de la collégialité des évêques du
monde avec le Saint-Père. Il n’est pas un simple organisme avec
une compétence limitée comme c’est le cas pour les Congrégations
et les Conseils de la Curie Romaine. Au contraire, il a une
compétence entière pour traiter de n’importe quel sujet en
accord avec la procédure fixée par le Saint-Père dans la lettre
de convocation ».
« Le Synode des Évêques, avec la Secrétairerie Générale qui en
est sa structure permanente, ne fait pas partie de la Curie
Romaine et ne dépend pas d’elle ; il est subordonné directement
et uniquement au Saint-Père, avec lequel il est associé dans le
gouvernement universel de l’Église ».
« Le Synode des Évêques se réunit et entre en fonction
uniquement quand le Saint-Père estime nécessaire ou opportun de
consulter l’épiscopat qui, lors d’une Assemblée synodale exprime
« son opinion sur des sujets très importants et sérieux » (Paul
VI, Discours aux Cardinaux, 24 juin 1967) ».
ZF05100307
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
Prière
pour le synode des évêques
ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org)
– Nous reprenons ci-dessous la prière pour le synode des évêques
publiée par le secrétariat général du synode.
* * *
Seigneur Jésus Christ, que le Père nous a demandé d’écouter
comme son Fils bien-aimé: illumine ton Église, afin que celle-ci
n’ait rien de plus saint que d’entendre ta voix et venir à ta
suite. Toi, qui es le Souverain Pasteur et Guide de nos esprits,
tourne les yeux vers les Pasteurs de l’Église, qui se réunissent
ces jours-ci avec le bienheureux Successeur de Pierre pour
célébrer le Synode, et daigne les sanctifier dans la vérité et
les confirmer dans la foi et dans l’amour.
Seigneur Jésus Christ, envoie ton Esprit d’amour et de vérité
sur les Évêques qui célèbrent le Synode et sur ceux qui les
assistent dans l’accomplissement de leurs fonctions.
Concède-leur de percevoir avec foi dans leur âme le souffle que
l’Esprit insuffle aujourd’hui dans les Églises et de recevoir de
lui l’enseignement de la vérité; fais en sorte que les fidèles,
purifiés et soutenus par leur engagement, adhèrent à l’Évangile
du salut qui est ton oeuvre, en devenant oblation vivante au
Dieu du ciel.
Que Marie, la Très Sainte Mère de Dieu et Mère de l’Église,
assiste aujourd’hui les Évêques comme autrefois les Apôtres au
Cénacle et intercède à travers son soutien maternel, afin qu’ils
honorent la communion fraternelle, qu’ils aient la prospérité et
la paix de jours sereins et, qu’en scrutant avec amour les
signes des temps, ils célèbrent la majesté de Dieu, Seigneur
miséricordieux de l’histoire, à la louange et gloire de la Très
Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit. Amen.
ZF05100308
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Entretien
Le cardinal Péter Erdö
dévoile le visage de
l’Eglise en Hongrie (I)
Entretien avec le nouveau
président de la Conférence
épiscopale hongroise
ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org)
– A l’issue du mandat de
président de Mgr Istvan
Seregély, l’Assemblée
ordinaire de la Conférence
épiscopale hongroise s’est
réunie du 6 au 8 septembre,
et a élu son nouveau
président, le cardinal Péter
Erdö, archevêque d’Esztergom-Budapest,
primat de Hongrie.
A quelques jours de son
élection le cardinal Erdö a
répondu pour Zenit aux
questions de Viktoria
Somogyi. Dans cet entretien
le cardinal décrit la
situation actuelle de
l’Eglise dans son pays et
les différents défis
auxquels elle est
confrontée. Nous publions
ici la première partie de
cet entretien.
Q : Après les années
difficiles du totalitarisme
et le sacrifice silencieux
de nombreux religieux et
laïcs, l’Eglise catholique
en Hongrie bénéficie d’une
plus grande liberté
d’expression et
d’évangélisation. Quelles
sont les difficultés
actuelles et les espoirs
pour l’avenir ?
Card. Erdö : Pour
pouvoir affronter les
difficultés actuelles il
faut d’abord réfléchir un
peu sur les années
difficiles du totalitarisme.
A la fin de l’époque
socialiste les problèmes les
plus graves ne venaient
certainement pas d’une
persécution ouverte et
directe. Bien sûr il
existait une certaine
répression mais il y avait
déjà à cette époque une «
déformation » de la société
et des mentalités : je pense
surtout à ce que l’on a
appelé le « communisme
goulasch », célèbre durant
les dernières années du
régime de Janos Kadar. Il a
eu pour effet une
conversion, même excessive,
des personnes à
l’individualisme, avec une
concentration de l’attention
sur le bien-être personnel,
quelques fois de manière
futile, et l’habitude de
raisonner à brève échéance
sans penser à un « avenir
plus grand », puisqu’il n’y
avait plus de grands idéaux.
Cet égoïsme de petite
bourgeoisie a beaucoup
freiné l’enthousiasme et
l’idéalisme de la société.
Ce type de « transformation
» ou de « déformation » est
présent aujourd’hui encore
dans la société. On ne se
libère pas facilement d’un
tel poids, comme des
problèmes, par exemple,
causés par les limitations
juridiques. Dans notre
société le nombre
d’avortements est encore
très élevé et la natalité
est la plus basse de toute
l’Europe. Nous perdons
chaque année 40.000
habitants, ce qui est une
perte importante, pour un
pays de dix millions de
personnes. Il manque donc
une vision d’ensemble de
l’avenir ; tous les types
d’« idéaux » sont absents et
c’est aussi la raison pour
laquelle la sensibilité à la
religion est assez faible.
C’est de ce contexte qu’a
émergé notre « liberté
institutionnelle », mais
l’Etat, pour ce qui est de
ses compétences, ne peut, en
premier lieu, changer que
les conditions
institutionnelles. Il faudra
peut-être attendre plusieurs
décennies avant que ces
changements sociaux
n’entraînent un changement
psychologique et moral : un
changement de comportement
dans la société. A la grande
liberté, au grand
changement, certes présents
et importants, vient
s’opposer le poids encore
conséquent de la mentalité
générale auquel s’ajoutent
les problèmes typiques de
l’Occident, caractérisés par
un sécularisme profond. Le
développement institutionnel
a certes été spectaculaire
au cours des quinze
dernières années surtout en
ce qui concerne les écoles,
les maisons de retraites,
les institutions sociales et
de bienfaisances.
Q : Comment l’Eglise
fait-elle pour maintenir
vivante sa tradition
philosophique et morale dans
les institutions culturelles
– écoles primaires et
secondaires, universités,
centres de formation – et
dans les secteurs de la
société plus sensibles à
l’accueil et à l’écoute de
l’enseignement religieux ?
Card. Erdö : La
religion à l’école ne fait
pas partie du cursus en
Hongrie. Les leçons sont
données à l’école mais avec
une séparation très nette
des autres matières. Cet
enseignement touche entre 25
et 30 % des jeunes ; alors
qu’en vérité, la présence à
la messe du dimanche atteint
10 à 12% des catholiques. Il
est clair que l’enseignement
de la religion à l’école se
trouve dans une « situation
missionnaire ».
Malheureusement les
résultats ne sont pas
encourageants : parmi les
jeunes qui reçoivent cette
éducation, très peu trouvent
ensuite le chemin de
l’Eglise, de la communauté
paroissiale, de la messe du
dimanche et des sacrements.
Nous devons donc voir
comment améliorer cet
enseignement, également au
niveau humain, sans
toutefois en oublier le
contenu. Cette « dépression
générale » ne caractérise
pas seulement notre société
mais l’Occident tout entier
où l’absence de notions
claires est évidente et où
l’on ressent une «
déliquescence culturelle »
telle que même les croyants
ne connaissent pas leur foi
en profondeur.
Les jeunes adultes et les
adolescents – je fais
naturellement référence à
ceux qui viennent à l’Eglise
–, ont aussi souvent des «
choses étranges » dans la
tête. Il est donc important
que l’enseignement de la
religion possède des
contenus clairs et puisse
présenter toute la richesse
de notre foi, pas seulement
des points particuliers.
L’on ne doit pas se
contenter de transmettre les
différents sentiments
positifs d’humanité, de
fraternité ou de religiosité
de manière générale, mais il
faut transmettre le contenu
de la foi.
Q : Il y a en Hongrie une
présence importante
d’instituts religieux et
séculiers ainsi que de
congrégations engagées dans
différents domaines
pastoraux. De quels espaces
bénéficient actuellement les
nouveaux mouvements
ecclésiaux et comment
peut-on les approcher ?
Card. Erdö : Il
existe – et il existait,
naturellement – des
mouvements de spiritualité
provenant surtout de
l’Occident, du monde latin,
notamment de France,
d’Italie et d’Espagne,
relativement actifs. Ceux-ci
n’ont toutefois pas le même
succès que dans d’autres
pays, comme les pays slaves
autour de nous, peut-être
parce que notre société est
plus fatiguée, ou, parce que
les gens hésitent plus à
s’engager dans les
mouvements. De nombreux
jeunes ont peur de faire un
choix de vie – le mariage au
bon moment, un travail, une
vocation sacerdotale ou
religieuse – et ils ont
également peur de
l’engagement dans le cadre
d’un mouvement. Les
mouvements ont donc de
nombreux sympathisants mais
assez peu de personnes
s’engagent vraiment.
Q : Au lendemain des
joyeuses images des JMJ de
Cologne, auxquelles ont pris
part des milliers de jeunes
du monde entier, quelle est
la relation entre l’Eglise
et les jeunes en Hongrie ?
De quelle manière s’effectue
leur approche de la pratique
religieuse et de
l’engagement ecclésial ?
Card. Erdö : J’ai
déjà répondu en partie dans
la question précédente, mais
je pourrais ajouter qu’il
existe bien sûr, dans chacun
de nos diocèses, des
sections spécialisées dans
le travail avec les jeunes.
Il ne s’agit pas d’un
travail avant tout culturel
mais pastoral : la
catéchèse, la pastorale du
mariage ou de la préparation
au mariage ont un rôle très
important. Il existe en
outre des groupes de jeunes
ainsi que des rencontres
diocésaines, régionales et
nationales. Je suis heureux
de citer, par exemple, la
rencontre de Nagymaros qui
se distingue depuis des
décennies dans le cadre
hongrois. Il y a aussi les
pèlerinages pour les jeunes
qui commencent à devenir un
peu à la « mode ».
Les écoles catholiques et,
bien sûr, l’université
catholique, offrent le cadre
institutionnel adapté pour
la rencontre et le dialogue
avec les jeunes. Toutefois,
là aussi, il est nécessaire
de réfléchir plus en
profondeur que ce que nous
avons fait jusqu’à présent,
pour accroître l’efficacité
de ces rencontres. Combien,
parmi nos étudiants, nos
élèves trouvent le chemin de
la vie religieuse ? Il y a
bien sûr des chapelles où
l’on célèbre la messe et où
se déroulent des fonctions
liturgiques et pastorales,
dans les universités et les
différentes écoles. Mais il
n’est pas facile d’en
mesurer l’efficacité.
Il faut être optimiste !
Nous devons rencontrer les
familles des jeunes pour
offrir un nouveau chemin à
toute la famille. Il n’est
pas facile de trouver les
instruments adaptés mais
l’on note un grand
engagement. Au niveau de la
conférence épiscopale, il y
a un évêque responsable du
travail avec les jeunes et
des équipes bien formées à
l’organisation de ce type de
travail, qui se sont
fortement engagées pour les
JMJ de Cologne. Ceux qui
sont rentrés de Cologne sont
remplis d’enthousiasme
malgré les difficultés et le
manque de confort auxquels
ils ont été confrontés. Tous
ont été impressionnés par
les catéchèses auxquelles
ils ont assisté, par la
rencontre avec le Saint-Père,
la liturgie et également par
la cordialité personnelle
des Allemands. L’ouverture
des croyants d’Allemagne à
été une surprise pour nos
jeunes.
[Fin de la première
partie]
ZF05100309
Je souhaite envoyer cette
information à un ami
TOP
International
Centre des Volontaires de
la Souffrance : Faire de la
douleur un chemin de
sainteté
Association consacrée à
l’accompagnement des
personnes souffrantes
ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org)
– « La souffrance et la
douleur ont un sens
salvifique, au point que les
personnes qui souffrent
peuvent devenir des témoins
actifs de l’évangélisation
». C’est la conviction de la
Confédération internationale
du Centre des Volontaires de
la souffrance (CVS) qui a
organisé sa première
Assemblée, à Rome, du 15 au
20 septembre. La
Confédération du CVS est un
organisme de droit
pontifical qui œuvre dans
près de vingt pays.
La devise des CVS est : «
Une association de personnes
qui marchent auprès de
chaque homme qui souffre et
qui font de la douleur
humaine un chemin de
sainteté », et leur objectif
est de faire en sorte que le
malade développe son propre
chemin vers la foi adulte.
C’est précisément dans cette
optique que l’on a rappelé,
au cours de l’Assemblée, que
le malade ne doit pas être
vu comme un problème pour
les agents pastoraux, mais
comme un sujet actif dans la
catéchèse, pouvant même
stimuler la foi des autres.
A l’issue des travaux de
l’Assemblée, don Armando
Afiero, qui a été élu
président de la
Confédération internationale
du CVS, a proposé des
directives d’intervention
tant au plan pastoral que de
l’organisation.
Prenant appui sur les
enseignements du serviteur
de Dieu, Mgr Luigi Novarese,
fondateur du CVS, don
Armando a expliqué : « Nous
voudrions que notre slogan «
placer l’Evangile dans la
douleur », soit accueilli
dans l’Eglise ».
« Dans
Salvifici doloris il est
dit que la voie de l’Eglise
est l’homme qui souffre
parce qu’à travers
l’expérience de la douleur
l’homme risque de s’éloigner
de Dieu, a-t-il ajouté,
vivant la douleur elle-même
comme un problème, ne
réussissant donc pas à voir
la vie – en particulier sa
vie – comme un mystère,
certes, mais également comme
un don de Dieu ».
Le nouveau président de la
Confédération internationale
du Centre des Volontaires de
la souffrance a précisé que
« le témoignage de la
compréhension de la valeur
de la vie et l’engagement
réel à aider les autres à
trouver leur place dans le
dessein de Dieu et dans la
société, partagés et vécus
avec qui semble ne pouvoir
faire autre que recevoir des
aides des autres, ont été et
sont encore, des points
saillants de notre
apostolat, irremplaçable et
auquel on ne peut renoncer
».
« Nous nous rendons compte,
a commenté Aufiero, que tout
cela pourrait devenir un
objectif impossible à
atteindre si nous ne nous
posions pas la question de
savoir quelle doit être la
méthode d’approche et
ensuite d’accompagnement de
la personne qui souffre ? ».
Une question à laquelle a
répondu don Luciano Ruga, en
qualité de responsable des
Ouvriers silencieux de la
croix (une association qui
coordonne la Confédération
internationale), affirmant
que « la Confédération
internationale du CVS a
décidé d’intervenir
précisément dans ce secteur
(elle le fera en contactant
toutes les conférences
épiscopales) proposant sa
propre dynamique
apostolique, qui ne prévoit
pas seulement
l’individualisation des
malades qui ont besoin de
mûrir spirituellement, mais
enseigne à les accompagner,
enseigne à les écouter, à
faire découvrir la chaleur
de la parole de Dieu et la
joie de la fraction du pain
communautaire.
ZF05100310
Je souhaite envoyer cette
information à un ami
TOP
-
Documents web -
Rapport avant le débat
général, par le cardinal
Scola
Texte intégral dans la page
web de Zenit
ROME, Lundi 3 octobre 2005 (ZENIT.org)
– Le
« Rapport avant le débat
général », présenté ce
lundi matin à l’Assemblée du
synode, par le cardinal
Angelo Scola, patriarche de
Venise et rapporteur général
de cette Assemblée synodale,
est disponible dans la page
web de Zenit, dans la
section « Documents ».
ZF05100311
Je souhaite envoyer cette
information à un ami
TOP
----------------------------------------
Pour offrir un abonnement à
Zenit, en cadeau, cliquez
sur :
http://www.zenit.org/french/cadeau.html
----------------------------------------
|
|
|
|