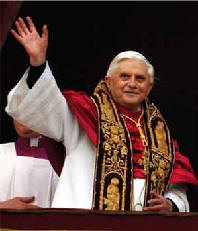| |
| |
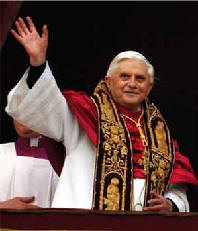
 Tout
sur Joseph Alois Ratzinger-
Benoît XVI Tout
sur Joseph Alois Ratzinger-
Benoît XVI
 Mardi
4 octobre 2005 Mardi
4 octobre 2005
Revue de Presse autre que Zénit
 Rosaire
Benoît XVI appelle à mettre en pratique Rosaire
Benoît XVI appelle à mettre en pratique
Rome
Béatification de l’évêque
allemand opposé au nazisme
Spécial synode
Benoît XVI
invite l’assemblée synodale
à la « joie » chrétienne
L’adoration, sommet de
l’expression de la foi en la
présence du Christ dans
l’Eucharistie
Par
l'Eucharistie, « chaque
chrétien devient un homme
pascal »
L’Eucharistie,
la paix et le rôle de «
l'Eglise des Arabes »
« L’Eglise
syrienne vit tous les
dimanches de l’année le
Mystère Pascal »
« Les
effets spirituels et les
implications sociales de
l'Eucharistie »
Entretien
Le cardinal
Péter Erdö dévoile le visage
de l’Eglise en Hongrie (II)
International
Des jeunes
en mission à Rome
-
Documents -
« Si nous
“rendons grâce”, c'est parce
que nous recevons la grâce
», par Mgr Le Gall
L’Eglise
catholique dans la société
française, par Mgr Ricard
-
Documents web -
Interventions des pères du
synode lundi après-midi
|
|
 |
|
|
| |
Rome
Béatification de l’évêque
allemand opposé au nazisme
Le pape donnera sa bénédiction
ROME, Mardi 4 octobre 2005 (ZENIT.org)
– Le pape Benoît XVI participera par une brève salutation finale à
la béatification de l’archevêque allemand Clemens August von Galen,
le « lion de Münster », opposant notoire à Hitler.
Le pape accordera sa bénédiction apostolique aux pèlerins, dont de
nombreux Allemands surtout du diocèse de Münster.
La célébration sera présidée par le cardinal José Saraiva Martins,
préfet de la congrégation pour les Causes des saints, dimanche
prochain, 9 octobre, à 9 h30, à l’autel de la confession de la
basilique vaticane.
Rappelons que l’archevêque allemand, d’une grande famille
aristocratique, était né en 1876.
Devenu archevêque de Münster, il exprima avec courage son opposition
au régime de Hitler, non sans risque pour sa sécurité personnelle.
Il tint par exemple trois sermons fameux, en l’église Saint-Lambert,
le 13 juillet et le 3 août 1941, et dans l’église de
Notre-Dame-sur-l’eau (« Überwasser », le 20 juillet 1941).
L’évêque se prononce clairement contre les violations perpétrées par
le nazisme, se posant en défenseur de la vie humaine, de
l’inviolabilité de la liberté de ses citoyens.
Il a en particulier sévèrement condamné l’assassinat des malades
mentaux considérés par le Führer comme des vies improductives et «
ne valant pas de vivre ».
ZF05100401
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
Spécial synode
Benoît XVI
invite l’assemblée synodale à la « joie » chrétienne
Encouragements du pape
ROME, Mardi 4 octobre 2005 (ZENIT.org)
– Benoît XVI invite les membres du synode à « se réjouir » et entrer
dans la joie chrétienne : le pape a en effet commenté la lecture de
saint Paul aux Corinthiens, lue à l’office liturgique de Tierce,
récité avant la première session des travaux du synode, lundi matin,
3 octobre. Le pape expliquait ce que l’apôtre entend par «
collégialité », « correction fraternelle » et « consolation divine
».
« Ce texte de l’Heure Tierce d’aujourd’hui implique cinq impératifs
et une promesse, indiquait le pape. Essayons de comprendre un peu
mieux ce que l’Apôtre entend nous dire à travers ces paroles. Le
premier impératif est extrêmement fréquent dans les Lettres de saint
Paul, l’on pourrait même dire qu’il s’agit d’un “cantus firmus” de
sa pensée: “gaudete” » « réjouissez-vous ».
Il objectait : « Dans une vie si tourmentée comme l’a été la sienne,
une vie emplie de persécutions, de faim, de souffrance en tous
genres, un mot-clé demeure, toutefois, toujours présent: “gaudete”.
Ici, une question s’élève: est-il possible de ressentir la joie en
quelque sorte sur commande? », avant de répondre : « L’apôtre peut
dire “gaudete” parce que le Seigneur est proche de chacun de nous.
Ainsi, cet impératif est en réalité une invitation à percevoir la
présence du Seigneur près de nous. C’est une sensibilisation à la
présence du Seigneur parmi nous ».
« Réfléchissons, invitait le pape, pour savoir si nous sommes
réellement disponibles à ouvrir les portes de notre cœur; ou
peut-être ce cœur est-il plein de tant d’autres choses qu’il n’y pas
de place pour le Seigneur et que, pour le moment, nous n’avons pas
de temps pour le Seigneur. Ainsi, insensibles, sourds à sa présence,
emplis d’autres choses, nous n’entendons pas l’essentiel: Il frappe
à la porte, Il nous est proche et ainsi la vraie joie est proche,
une joie qui est plus forte que toutes les tristesses du monde, de
notre vie. Prions, donc, dans le cadre de ce premier impératif:
Seigneur rends-nous sensibles à Ta présence, aide-nous à entendre, à
ne pas être sourds à Ton appel, aide-nous à avoir un cœur libre,
ouvert à Toi ».
Pour ce qui est du second impératif : « Soyez parfaits », le pape
faisait observer : « Cette parole nous invite à être ce que nous
sommes: des images de Dieu, des êtres créés en relation au Seigneur,
“miroir” dans lequel se reflète la lumière du Seigneur. Ne pas vivre
le christianisme à la lettre, ne pas entendre la Sainte Écriture à
la lettre est souvent difficile, discutable d’un point de vue
historique, mais il faut aller au-delà de la lettre, de la réalité
présente, vers le Seigneur qui nous parle et ainsi à l’union avec
Dieu ».
Le pape évoquait aussi la dimension de réparation et de
réconciliation en disant : « C’est également une invitation au
Sacrement de la Réconciliation, à travers lequel Dieu lui-même
répare cet instrument et nous donne à nouveau la plénitude, la
perfection, la fonctionnalité, afin qu’en cette âme-ci puisse à
nouveau résonner la louange de Dieu ».
Benoît XVI soulignait tout particulièrement la dimension
communautaire et fraternelle de cette conversion : « Corriger son
frère est une œuvre de miséricorde. Aucun de nous ne se voit bien
lui-même, ne voit bien ses lacunes. Ainsi, il s’agit donc d’un acte
d’amour, afin de se compléter l’un l’autre, pour nous aider à mieux
nous voir, à nous corriger. Je pense que l’une des fonctions de la
collégialité est précisément de nous aider, également au sens de
l’impératif précédent, à connaître les lacunes que nous-mêmes nous
ne voulons pas voir (…) de nous aider afin que nous nous ouvrions et
que nous puissions voir ces choses ».
Le pape soulignait l’exigence « d’humilité » et « d’amour » que
suppose cette correction fraternelle, supportable « seulement si
cela vient d’un cœur humble qui ne se place pas au-dessus de
l’autre, qui ne se considère pas meilleur que l’autre, mais comme un
humble instrument afin de s’aider réciproquement ».
Après l’appel à la correction fraternelle, saint Paul évoque la «
consolation », soulignait le pape : « Non seulement corriger, mais
également consoler, partager les souffrances de l’autre, l’aider
dans les difficultés. Et cela aussi me semble un grand acte de
véritable affection collégiale. Dans les si nombreuses situations
difficiles qui naissent aujourd’hui dans notre pastorale, certains
se trouvent réellement un peu désespérés, ne voyant pas comment
aller de l’avant. C’est dans un moment semblable que l’on a besoin
de consolation, l’on a besoin que quelqu’un soit à nos côtés dans la
solitude intérieure et accomplisse l’œuvre de l’Esprit Saint, du
Consolateur: l’œuvre de donner courage, de nous porter ensemble, de
nous épauler ensemble, aidés par l’Esprit Saint lui-même qui est le
grand Paraclet, le Consolateur, notre Avocat qui nous aide. C’est
donc une invitation à nous faire nous-mêmes “ad invicem” l’œuvre de
l’Esprit Saint Paraclet ».
A propos de la « foi commune », à « vivre », à « communiquer », le
pape soulignait le « dernier impératif », qui nous donne entre nous
« une paix profonde », qui est de « penser ensemble avec le Christ
».
« Et nous pouvons le faire, recommandait le pape, en lisant la
Sainte Écriture, dans laquelle les pensées du Christ se font Parole,
nous parlent. En ce sens, nous devrons exercer la “Lectio Divina”,
sentir dans les Écritures la pensée du Christ, apprendre à penser
avec le Christ, à penser la pensée du Christ, pour avoir les
sentiments du Christ, être capables de transmettre aux autres la
pensée du Christ, les sentiments du Christ. »
Et de conclure : « Nous sommes alors en union avec Dieu qui est
notre paix, avec le Christ qui nous a dit: “Je vous donnerai ma
paix”. Nous sommes dans la paix intérieure, car être dans la pensée
du Christ unifie notre être. Les difficultés, les contrastes de
notre âme s’unissent, nous sommes unis à l’original, à ce dont nous
sommes l’image, par la pensée du Christ. Ainsi naît la paix
intérieure, et ce n’est qu’en nous fondant sur une paix intérieure
profonde que nous pourrons être aussi des personnes de paix dans le
monde, et pour les autres ».
Le pape insistait sur la dimension de « consolation » en disant : «
Telle est notre grande consolation. Dieu nous précède. Il a déjà
tout fait. Il nous a donné la paix, le pardon et l’amour. Il est
avec nous. Et ce n’est que parce qu’il est avec nous, parce que dans
le Baptême nous avons reçu sa grâce, dans la Confirmation l’Esprit
Saint, dans le Sacrement de l’Ordre sa mission, que nous pouvons
maintenant agir à notre tour, coopérer avec sa présence qui nous
précède. Tout notre agir dont nous parlent les cinq impératifs
consiste à coopérer, à collaborer avec le Dieu de paix qui est avec
nous ».
ZF05100402
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
L’adoration, sommet de l’expression de la foi en la présence du
Christ dans l’Eucharistie
Intervention de Mgr Fecteau (Canada)
ROME, Mardi 4 octobre 2005 (ZENIT.org)
– « L’acte d’adoration, l’attitude intérieure d’adoration, constitue
le lieu où culmine l’expression de la foi en la présence du Seigneur
dans le Très Saint Sacrement », souligne Mgr Clément Fecteau, évêque
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, au Canada, qui a pris la parole au
synode des évêques lors de la congrégation du 3 octobre après-midi.
« C’est à juste titre que le document soumis à l’étude de la
présente assemblée du synode recommande d’affirmer avec insistance
que le Christ Jésus est réellement présent dans le Sacrement de
l’Eucharistie », soulignait l’évêque canadien dans son intervention.
Il citait le n. 38 de l’Instrumentum Laboris qui « invite la
présente assemblée synodale à affirmer de nouveau que “la présence
permanente et substantielle du Seigneur dans le sacrement n’est pas
simplement une typologie ou une métaphore” ».
Il soulignait la nécessité d’un langage accessible aux fidèles pour
comprendre en profondeur le mystère de la présence eucharistique: «
On a raison de demander à ce sujet “d’expliquer la théologie de la
consécration” pour faciliter le dialogue œcuménique et pour
faciliter la compréhension des catholiques eux-mêmes. Il y aurait
lieu aussi de demander à des spécialistes de développer un langage
plus approprié pour la catéchèse de ce grand mystère ».
« Il arrive souvent qu’on considère l’Eucharistie comme quelque
chose de statique alors qu’il s’agit d’une réalité dynamique. L’Eucharistie
n’est-elle pas la personne du Christ, non seulement présente, mais
en action sacrificielle constante et permanente bien que sous forme
de mémorial », insistait Mgr Fecteau.
Et d’insister sur l’importance du langage : « Il serait souhaitable
que des spécialistes suggèrent un langage renouvelé sur cet aspect
de manière à ce que pasteurs, catéchètes et fidèles en arrivent à
une compréhension plus profonde et plus vraie de la présence du
Seigneur dans l’Eucharistie.
L’acte d’adoration, l’attitude intérieure d’adoration, constitue le
lieu où culmine l’expression de la foi en la présence du Seigneur
dans le Très Saint Sacrement. Il faudrait éviter cependant
d’interpréter cette affirmation comme si les célébrations
d’adoration en dehors de la messe étaient, davantage que cette
dernière, l’expression d’une telle foi ».
L’évêque canadien concluait sur l’importance de l’adoration
eucharistique : « Il est à souhaiter que cette assemblée synodale
approfondisse davantage cette question de l’Adoration Eucharistique,
car il y a un grand effort à faire pour renouveler cette pratique en
explicitant le sens et en fournissant des textes de prières
appropriés afin de soutenir celles des personnes qui n’ont pas
encore l’habitude de la prière spontanée ».
Pour sa part, un autre évêque canadien, Mgr Paul-André Durocher,
évêque d’Alexandria-Cornwall, mettait l’accent sur la croix du
Christ en disant : « La croix du Christ, formée d’un tronc et d'une
poutre, rappelle les deux dimensions de la mort salvifique du Christ
: verticale, la glorification du Père; horizontale, le salut de
l'humanité. La croix convoque la communauté chrétienne à s'unir au
Christ selon ces deux dimensions - la louange du Père et la prière
pour le monde - faisant de l'Eucharistie une action liturgique à la
fois doxologique et missionnaire ».
« Or dans notre monde contemporain, on est porté d'abord à chercher
l'épanouissement personnel et les gratifications immédiates. Dans un
tel contexte culturel, on risque de réduire l'Eucharistie à
l'étroitesse de nos propres besoins et désirs. Il faut donc
développer ces dimensions doxologique et missionnaire en cultivant
l'art de célébrer, en étant attentif aux possibilités de louange et
d'ouverture sur le monde déjà présentes au cœur de la liturgie,
quitte à développer de nouveaux formulaires de prière, de nouvelles
préfaces, un nouveau rite d'envoi. Tout cela afin de réaliser dans
la célébration ce que la croix de procession symbolise déjà »,
concluait Mgr Durocher.
ZF05100403
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
Par l'Eucharistie, « chaque
chrétien devient un homme pascal »
Par S.B. Grégoire III Laham
ROME, Mardi 4 octobre 2005 (ZENIT.org)
– Par l'Eucharistie, « chaque chrétien devient un homme pascal » a
souligné le patriarche d’Antioche des Grecs-Melkites, chef du synode
de l’Eglise gréco-melkite catholique, S.B. Grégoire III Laham, de
Damas en Syrie, lors de la congrégation synodale de lundi
après-midi.
« Je voudrais parcourir l'Instrunentum Laboris, en démontrant
l'importance de la relation entre Eucharistie et Économie du Salut,
thème si cher à l'Orient Chrétien, annonçait le patriarche Laham.
Les Sacrements - appelés dans la tradition orientale les Mystères -
sont différents aspects du grand Sacrement du Mystère de Dieu, qui a
voulu prendre forme d'homme et élever les hommes à son icône divine.
Ainsi l'Eucharistie est le Sacrement des Sacrements, et le mystère
des mystères ».
« Par elle chaque chrétien devient un homme pascal, expliquait le
patriarche. L'Église, en célébrant l'Eucharistie, devient elle-même
une présence pascale du Christ dans le monde ».
« À ce propos, je voudrais insister sur le sens - pas seulement
théologique - des trois sacrements de l'initiation chrétienne:
Baptême, Chrismation (Confirmation) et Eucharistie. Ce n'est pas
seulement un rapport théologique, comme cela est présenté dans le
chapitre sur le rapport entre l'Eucharistie et les autres Sacrements
(pages 14-6), mais il y a aussi une relation biblique qui a son
point de départ dans le concept de l'économie du salut: le Père a
créé, le Fils a sauvé et a donné le Sacrement de l'Eucharistie. (Luc
22, 19: "Faites ceci en mémoire de moi") et l'Esprit Saint vivifie
».
A propos des numéros 28 à 30 de l’Instrumentum laboris sur le
dessein de salut de Dieu dans l’histoire, le patriarche expliquait :
« La mystagogie eucharistique est celle de l'année liturgique
condensée, et qui apparaît en trois aspects: 1) la Liturgie de la
Parole, qui est la Théophanie et correspond aux fêtes de la
Nativité, du Baptême et du Kérygme; 2) la Liturgie de l'Anaphore,
qui correspond à la Passion, à la Mort sur la Croix et à la
Résurrection; 3) la Liturgie de la Communion, qui correspond à la
Pentecôte, à la Divinisation (Theosis). La prière de l'Anaphore de
Saint Jean Chrysostome nous rappelle que le Christ "a accompli toute
l'économie de la Providence du Père sur nous". »
Mais le patriarche Laham soulignait aussi la dimension sociale de
l’Eucharistie (n. 79), en disant : « Les différents aspects de
l'économie du salut, sont les dimensions fondamentales que nous
vivons dans l'Eucharistie, qui deviennent les éléments de la vie du
chrétien dans le monde.
Saint Jean Chrysostome, dans sa cinquantième Homélie sur Saint
Matthieu, dit ceci: "Le mystère de l'Eucharistie est le mystère du
frère, et le jugement sera sur la manière dont nous lions le mystère
du Christ présent dans la Sainte Eucharistie et son sacrement
présent dans les frères" (sur Matthieu 25,31-46). Au IVème siècle,
Narsaï le Syrien nous dit aussi: "La sainteté sans ton frère l'homme
n'est pas une sainteté, car tu ne peux pas entrer dans le Royaume
tout seul".
ZF05100404
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
L’Eucharistie,
la paix et le rôle de « l'Eglise des Arabes »
L’importance de la « présence chrétienne dans ce monde arabe »
ROME, Mardi 4 octobre 2005 (ZENIT.org)
– A propos du rapport entre Eucharistie et Mission évangélisatrice (nn.
82 et 88), S. B. Grégoire III soulignait le rôle de « l'Eglise des
Arabes », et la « préservation de la présence chrétienne dans ce
monde arabe ».
Cette Eglise a été connue en Occident, soulignait-il, par le livre
du Père Jean Corbon. « En effet, expliquait le patriarche, dans la
situation actuelle, après le 11 septembre 2001, avec la guerre
contre l'Irak, avec le conflit israélo-palestinien, avec
l'accroissement du fondamentalisme islamique et l'extension du
phénomène du terrorisme, il est très important de rappeler aux
chrétiens arabes leur rôle d'Eglise « des Arabes », dans le contexte
de l'Islam, dont ils sont historiquement solidaires ("Eglise de
l'Islam") ».
Il souhaitait une mention spéciale de cette Eglise en disant : « Une
telle mention contribuerait à rendre courage aux chrétiens dans le
monde arabe et dans les pays islamiques, et serait très
favorablement reçue dans ce monde et dans ces pays. Ce serait, de
plus, un corollaire de la formule liturgique "Ite, missa est". »
Au sujet de « L'Eucharistie et la paix » (page 115), S.B. Laham
ajoutait : « Il serait bon de mentionner Jérusalem et la Palestine,
patrie spirituelle de tous les chrétiens: dire un mot pour la paix
de la Ville Sainte et de la Terre Sainte, clé de la paix au
Proche-Orient et dans le monde entier, et qui, pour nous, chrétiens
du monde arabe, est de la plus haute importance pour la préservation
de la présence chrétienne dans ce monde arabe ».
ZF05100405
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
« L’Eglise
syrienne vit tous les dimanches de l’année le Mystère Pascal »
Par S.B. Ignace Pierre VIII Abdel-Ahad
ROME, Mardi 4 octobre 2005 (ZENIT.org)
– « L’Eucharistie est vécue toujours comme un Mystère pascal dans
l’Eglise Syrienne d’Antioche », a souligné dans son intervention au
synode, lundi matin, S.B. Ignace Pierre VIII Abdel-Ahad, patriarche
d'Antioche des Syriens, chef du Synode de l'Église Syro-Catholique,
au Liban. Il insistait : « L’Eglise syrienne vit tous les dimanches
de l’année le Mystère Pascal ».
Le patriarche soulignait tout spécialement le lien entre Pâque
chrétienne et Pâque juive en disant : « Certaines des premières
communautés syriennes d’Antioche sont issues de Jérusalem d’Antioche
et de la Mésopotamie des communautés judéo-chrétiennes. C'est
pourquoi en passant au christianisme les chrétiens d’Antioche ne se
sont pas détachés de leurs traditions anciennes surtout des fêtes
juives, comme la fête de Pâques ou Pesah en hébreu ou Pesho en
araméen. Ils ont trouvé dans le Seigneur le vrai Agneau pascal et
tout de suite ils ont établi dans leurs méditations des
parallélismes entre l’agneau pascal d’Egypte et l’Agneau pascal de
Jérusalem, qui fut Jésus Christ sur la croix, immolé déjà au Cénacle
par anticipation.
Il citait ce développement du parallélisme chez saint Ephrem le
Syrien : « En Egypte fut versé le sang de l’agneau pour la
délivrance du peuple et à Sion fut versé le sang de l’Agneau de la
vérité. En regardant ces deux agneaux nous constatons leurs
ressemblances et leurs divergences. L’agneau de l’Egypte fut comme
un mystère dans l’ombre tandis que l'Agneau de la vérité est son
accomplissement.
L’Agneau pascal, Jésus Christ, a sauvé par son sang le peuple de ses
erreurs comme l’agneau d’Egypte, où se furent des milliers à être
offerts, mais un seul a sauvé de l’Egypte.. Beaucoup d’agneaux
furent offerts mais un seul a dissipé l’erreur. En Egypte le
symbole, mais dans l’Eglise la réalité.
Le pain que le Seigneur mangea avec ses disciples à Pâque, au Pesah,
et qu’il a rompu, a remplacé le pain azyme qui donna la mort à ceux
qui l’ont mangé.
L’Eglise nous donne le Pain de Vie pour remplacer le pain azyme
donné en Egypte. Marie nous a donné le Pain de Vie pour remplacer le
pain de fatigues qu'Eve a donné. »
« Dans cette spiritualité, l’Eglise syrienne vit tous les dimanches
de l’année le Mystère Pascal, sauf les dimanches de l’Avent et du
Carême. C’est vers l’Eucharistie que les fidèles se tournent pour
obtenir la purification de leurs péchés et le remède de Vie »,
insistait le patriarche.
« Pâque, Pesho, a la double signification: passage et joie,
continuait-il. L’Eucharistie, Pain de Vie, joie Pascale, fait la
joie des croyants. Le Dieu tout puissant se baisse et il est porté
par les pauvres humains. Comme le dit l’anaphore de Saint Jacques:
“C’est le Raisin de Vie que ceux qui l’ont crucifié ont foulé sans
le goûter et que les croyants ont reçu sans s’en détacher. C’est le
Pain Céleste qui n’affame pas qui le mange et c’est la Boisson
spirituelle qui n’assoiffe pas qui la boit.” »
Il soulignait la dimension de purification et de pardon des péchés
en concluant : « Avant de recevoir le Pain Céleste, la communauté
des fidèles prie le Seigneur de lui donner des lèvres pures pour
prendre son Corps et lui donner de jouir de son Sang. En donnant le
Corps et le Sang du Christ, le prêtre dit au communiant “que la
braise purificatrice du Corps et du Sang de notre Seigneur Jésus
Christ te soit pour la rémission et le pardon de tes péchés.” »
ZF05100406
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
« Les
effets spirituels et les implications sociales de l'Eucharistie »
Par Mgr Monsengwo Pasinya (RDC)
ROME, Mardi 4 octobre 2005 (ZENIT.org)
– « L'Eucharistie quotidienne doit devenir pour les disciples du
Christ en général une incitation pressante à bâtir un monde plus
fraternel ». Les effets spirituels et les implications sociales de
l'Eucharistie » ont fait l’objet de la communication de Mgr Laurent
Monsengwo Pasinya, archevêque de Kisangani, président de la
République démocratique du Congo, lors de la 3e congrégation des
membres du synode, lundi après-midi.
« Je parle au nom de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO),
annonçait l’archevêque. Mon intervention porte sur les effets
spirituels et les implications sociales de l'Eucharistie (Instrumentum
Laboris, nn. 11 et 79) », en s’appuyant sur le quotidien de l’Eglise
en Afrique et spécialement en RDC.
Pour ce qui est de la dimension sociale de l’Eucharistie,
l’archevêque disait : « L'Eucharistie récapitule la richesse et la
pauvreté du monde, pauvreté que souligne fortement la pauvreté des
matières eucharistiques. L'Eucharistie « récapitule sous un seul
Chef, le Christ, l'humanité entière dans sa productivité et dans sa
pauvreté, c'est-à-dire le monde des riches et celui des pauvres.
Ainsi donc, la récapitulation de l'économie du salut implique celle
de l'humanité-famille dans sa vie quotidienne et sociale. C'est le
salut intégral et la vraie libération en Christ, centre et sommet de
l'Histoire (…) ».
Il soulignait les prolongements dans les domaines de l’économie, de
la finance, de la politique : « Voilà pourquoi l'Eucharistie
quotidienne doit devenir pour les disciples du Christ en général une
incitation pressante à bâtir un monde plus fraternel et uni, plus
juste et solidaire. En particulier, tirant les conséquences de
l'Eucharistie quotidienne, l'Eglise doit inviter les professionnels
de l'économie et des finances ainsi que les décideurs géopolitiques
chrétiens, à travailler sans relâche à l'instauration d'un nouvel
ordre économique mondial, dans lequel la solidarité et le partage
doivent dépasser l'humanitaire, souvent lié à des intérêts
politiques, pour devenir une dimension inhérente au système lui-même
».
A propos de la dette des pays pauvres, il soulignait : «
L'annulation fort appréciée de la dette extérieure des pays les plus
pauvres, initiative des plus heureuses, appelle à son tour un examen
plus approfondi de nouveaux mécanismes susceptibles d'éviter
désormais à ces mêmes pays des endettements de même nature ».
« Dans un pays comme le nôtre, la République démocratique du Congo,
où depuis neuf ans, le peuple paupérisé vit les affres d'une guerre
injuste et inutile, l'Eucharistie, toujours célébrée aussi bien dans
une atmosphère de fête et de joie que dans un souci d'inculturation,
constitue pour les fidèles: un foyer ardent de charité (…) ; un
lieu, où s'édifie continuellement l'Eglise-famille de Dieu,
sacrement d'unité et de fraternité, de pardon, de réconciliation et
de paix (…) ; une source intarissable de consolation, de réconfort
et d'endurance dans les épreuves (…) ; une école d'humilité
collective (…) ».
« Pour ce qui est de l'Eucharistie, la théologie enseigne que les
effets spirituels de l'Eucharistie dans la vie des fidèles sont
l'incorporation au Christ et la « con-corporation » entre les
membres de son corps, autrement dit la « koinonia » », soulignait
l’archevêque africain, avec un accent qui rappelle plus spécialement
la tradition de l’Eglise d’Orient.
ZF05100407
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
Entretien
Le cardinal
Péter Erdö dévoile le visage de l’Eglise en Hongrie (II)
Entretien avec le nouveau président de la Conférence épiscopale
hongroise
ROME, Mardi 4 octobre 2005 (ZENIT.org)
– A l’issue du mandat de président de Mgr Istvan Seregély,
l’Assemblée ordinaire de la Conférence épiscopale hongroise s’est
réunie du 6 au 8 septembre, et a élu son nouveau président, le
cardinal Péter Erdö, archevêque d’Esztergom-Budapest, primat de
Hongrie.
A quelques jours de son élection le cardinal Erdö a répondu pour
Zenit aux questions de Viktoria Somogyi. Dans cet entretien, dont
nous publions ci-dessous la deuxième partie, le cardinal décrit la
situation actuelle de l’Eglise dans son pays et les différents défis
auxquels elle est confrontée. Pour la première partie, cf.
Zenit, 3 octobre.
Q : Dans un contexte européen de sécularisation où les choix «
responsables et durables » semblent toujours plus difficiles, le
chemin de la vocation est hérissé d’obstacles mais n’en est pas
moins fécond et riche grâce à la présence de nouveaux charismes et
communautés. Quelle est la situation en Hongrie ?
Card. Erdö : La Hongrie est certes également un pays où
manquent les vocations. Ce manque n’est peut-être pas aussi
dramatique que dans certains pays occidentaux mais il est assez
important, notamment parce que ces cinquante dernières années les
vocations religieuses n’étaient pas acceptées. Il n’était pas permis
de vivre la vie religieuse.
Pour cette raison, des générations entières de prêtres et de
religieux sont absentes ; même si le taux des séminaristes est plus
élevé que dans les pays de langue allemande, le taux de prêtres par
rapport aux fidèles est plus bas. Par exemple dans notre
archidiocèse, nous avons un prêtre pour 6000 fidèles, ce qui est
bien plus bas que la moyenne européenne. Les séminaires aussi ont
atteint ces dernières années une certaine stabilité pour ce qui est
du nombre d’étudiants. On a cherché dernièrement à réformer un peu
le système de l’éducation pour renforcer la vocation de ces jeunes
titubants qui entrent au séminaire sans avoir pris une décision
définitive. Je dois dire en fait qu’il s’agit surtout du problème du
fondement anthropologique de ce choix.
Q : Le relativisme conditionne tous les aspects de la vie
personnelle, sociale et culturelle. Les conséquences négatives
apparaissent clairement, en particulier dans la désagrégation de la
« famille » qui, selon le Catéchisme de l’Eglise catholique est une
« Eglise domestique », première cellule de la société. Selon votre
expérience pastorale et juridique, comment l’Eglise peut-elle
enrayer cette tendance ?
Card. Erdö : Notre humble expérience, qui vient du « profond
communisme » des années 50 et 60, montre que, même si les grandes
solutions institutionnelles peuvent à certains moments sembler
spectaculaires et décisives, la vraie force réside dans les
communautés plutôt modestes comme la communauté paroissiale, la
communauté de plusieurs familles nombreuses qui s’entraident. Cette
aide existentielle est certes également économique, mais surtout
personnelle et directe, comme dans le cas de l’assistance
personnelle aux jeunes mères qui ont de petits enfants et ne
réussissent même pas à sortir de l’appartement dans lequel elles
vivent. Cette « aide directe » est vraiment précieuse. L’Eglise
aussi, malgré les difficultés et l’organisation compliquée due aux
nombreux besoins de la société, a parfaitement compris que ce genre
de « rapports directs » est plus fort parce qu’il va au-delà des
circonstances publiques d’un Etat et d’une société, qui changent
souvent. Ces modèles se transmettent psychologiquement aussi aux
générations futures.
Je peux raconter mon expérience personnelle. Mes parents avaient une
grande famille. Au début des années 50 nous étions six frères à la
maison et autour de nous il y avait des familles amies : une dizaine
de familles comme la nôtre, dans lesquelles tous étaient catholiques
et qui s’aidaient les unes les autres. Très souvent les enfants de
ces familles ont eu à leur tour de grandes familles avec de nombreux
enfants et j’ai eu la joie de saluer les petits enfants de certaines
de ces familles dans notre séminaire.
Q : La Hongrie est caractérisée par une présence
pluriconfessionnelle historique qui peut lui valoir d’être
considérée comme un kaléidoscope de la nouvelle Europe. Quels sont
les résultats de cette expérience séculaire dans la coexistence et
le dialogue œcuménique et interreligieux ?
Card. Erdö : Avant tout, la Hongrie est un petit pays, très
ouvert à toutes les influences venant de l’étranger. Le pays est
très exposé au jeu des pouvoirs du monde et du continent ; ne nous
faisons donc pas d’illusions : nous n’allons pas faire de pas
décisifs, pour tout le monde, dans ce domaine non plus. Notre
expérience est donc une expérience limitée à nos circonstances mais
qui peuvent exprimer aussi des valeurs généralement importantes. La
tolérance, et surtout l’empathie avec les autres confessions a une
grande valeur. « La réconciliation historique » doit être au cœur de
toute chose car le passé nous a laissé des blessures profondes. On
doit parler de cela sans rancoeur et sans préjugés, en essayant de
raconter à nouveau notre histoire commune de manière « réconciliée
», en faisant une autocritique mais en restant dans la vérité et la
fidélité à la vérité historique afin de pouvoir trouver une base
pour un discours commun dans une collaboration féconde dans la
société actuelle. Mais la Hongrie est un lieu qui se prête
assurément beaucoup au dialogue, aussi bien avec les orthodoxes
qu’avec les protestants, même si ceux-ci sont moins nombreux, et
aussi avec les juifs.
Q : Selon le principe de subsidiarité, mentionné fréquemment dans
le magistère social de l’Eglise, les institutions centrales et les
corps intermédiaires doivent collaborer activement en ayant pour but
le bien commun. Quels sont, à cet égard, les rapports actuels entre
l’Etat et l’Eglise en Hongrie ?
Card. Erdö : Premièrement, tous les modèles ont une valeur
lorsque dans la société il existe un minimum de politesse. Lorsqu’un
Etat est un Etat de droit, il faut naturellement observer les lois.
Ce modèle est un modèle qui a montré ses mérites dans le monde
occidental et nous combattons pour ce droit de type occidental, pour
le fonctionnement de cette nouvelle démocratie. En réalité, dans
tous les pays de notre région, il existe de graves problèmes car
nous avons dû adopter en très peu de temps des formes
institutionnelles, indépendamment de notre réalité sociale. Les
formes juridiques et institutionnelles ne sont donc pas des produits
organiques de notre réalité sociale mais des « cadeaux » de
l’Occident que nous avons acceptés avec joie car nous apprécions les
valeurs générales qui sont derrière ces formes démocratiques. Un
temps de souffrance plutôt long est bien sûr nécessaire afin que ces
formes puissent refléter une réalité vraiment respectueuse de la
personne, de la justice, etc.
Par conséquent, subsidiarité oui, mais pas seulement une
subsidiarité de pures formes institutionnelles mais une «
subsidiarité organique » dans la réalité de la société, ce qui est
un travail beaucoup plus long, comme dans le cas du changement dans
les rapports de propriété. Le communisme avait exproprié tous les
biens de la société et par conséquent, une nouvelle classe est née
après le communisme. Mais comment ? Ceci n’est pas clair du tout
pour la majorité de la société, au point que certains en sont
arrivés à mettre en question ou en doute la légitimité de toutes les
grandes propriétés privées nées ces dernières années. Cela est donc
aussi un poids moral. Nous devons nous efforcer de comprendre
comment la société peut trouver son équilibre, aussi bien moral
qu’institutionnel. Les institutions démocratiques occidentales
peuvent peut-être nous aider dans cette évolution. Mais il est plus
important encore que nous ayons la générosité chrétienne et la
confiance dans la providence et dans la miséricorde divine.
ZF05100408
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
|
|
|
 |
|
|
| |
International
Des
jeunes en mission à Rome
ROME, Mardi 4 octobre 2005 (ZENIT.org)
– A partir de ce soir jusqu’au dimanche 9 octobre, 334 jeunes,
dont une trentaine de séminaristes et une trentaine de
religieuses, portant un t-shirt jaune arborant l’inscription «
Jésus au centre », partiront en mission dans les rues de Rome
pour expliquer ce qu’est l’Eucharistie et le cœur de la religion
chrétienne : l’amour de Dieu pour l’humanité.
C’est ce qu’a affirmé Mgr Mauro Parmeggiani, secrétaire général
du Vicariat de Rome et directeur du service diocésain pour la
pastorale de la jeunesse, lundi 3 octobre au cours de conférence
de presse de présentation de l’initiative « Adoremus 2005 » (cf.
www.veniteadoremus.org).
Parmi les activités prévues : la rencontre des jeunes avec la
population, des concerts, des conférences et des débats, et la
IIe rencontre internationale des groupes de jeunes d’adoration
eucharistique.
Les jeunes missionnaires se rendront entre autres dans les
écoles. Vingt-quatre d’entre elles ont déjà adhéré à
l’initiative pour un total de 300 classes et de 6000 élèves.
L’initiative de « Adoremus » prévoit également l’installation
d’une grande tente, place Navone, au centre de la ville, où les
jeunes pourront découvrir la foi catholique. Des rencontres sont
prévues sur les vocations (sacerdotale, religieuse, vocation au
mariage), mais aussi pour les fiancés, les personnes mariées,
les missionnaires, etc.
Des experts du GRIS (Groupe de recherche et d’information
socioreligieuse - www.gris.org)
se tiendront à la disposition des jeunes pour parler de sectes,
des phénomènes comme la magie, l’ésotérisme, le satanisme, etc.
Mgr Parmeggiani a précisé que 36 groupes participeront à la IIe
rencontre internationale des groupes de jeunes d’adoration
eucharistique, avec 170 délégués venant de 23 pays différents.
Le groupe de langue anglaise sera le plus nombreux, avec les
Etats-Unis en tête. Des délégués du Liban et d’Australie seront
également présents. Douze pays d’Europe seront représentés : la
Belgique, la France, l’Allemagne, la Roumanie, la Slovénie, la
Suisse, la Pologne, l’Autriche, l’Irlande, l’Ecosse, l’Espagne,
la Grande Bretagne.
Rappelant le thème de la rencontre « Eucharistie et identité de
l’homme », le secrétaire général du Vicariat de Rome a expliqué
que « dans la célébration de l’Eucharistie se réalise le grand
amour de Dieu pour l’homme », et puisque « le chrétien doit être
perçu comme celui qui place l’Eucharistie au centre de sa vie,
il a aussi le devoir de témoigner du Seigneur dans l’histoire ».
« En faisant cela, il ne procède à aucune ingérence. Le chrétien
ne fait pas de politique mais témoigne de Jésus Christ dans la
réalité humaine », a expliqué Mgr Parmeggiani.
A une question de Zenit sur la raison pour laquelle les jeunes
s’intéressent à l’adoration eucharistique, Mgr Parmeggiani a
répondu que les jeunes savent que seul Jésus peut apporter une
réponse à leurs interrogations.
Il a raconté que lors du référendum qui a eu lieu en Italie sur
la fécondation assistée, de nombreux jeunes se sont adressés au
Vicariat en offrant leur disponibilité pour participer aux
activités de l’Eglise.
« Ceci montre combien les jeunes veulent participer et agir,
mais seulement lorsqu’on leur propose des objectifs élevés. Nous
savons que seul Jésus peut donner une réponse aux quêtes de
liberté, de bonheur, de vérité, de sens et de justice. Les
jeunes veulent une voix claire qui les aide à découvrir la
vérité », a-t-il expliqué.
« Dans notre société il y a une absence de figures paternelles
qui indiquent des objectifs élevés, et ceci explique
l’importance accordée à des figures comme celle du pape
Jean-Paul II, de Benoît XVI, des évêques, qui disent parfois des
choses qui dérangent », a-t-il ajouté.
Mgr Parmeggiano a souligné par ailleurs que les jeunes « sont en
train de comprendre qu’être chrétiens signifie être
missionnaires ».
Le prélat italien a conclu en précisant que les églises romaines
qui consacrent chaque jour un temps à l’adoration eucharistique
sont toujours plus nombreuses, et que cette pratique se
développe partout : à Londres, à Paris, à Washington, en Italie
à Turin, Florence, Bari et en Sicile.
ZF05100409
Je souhaite envoyer cette information à un ami
TOP
|
|
|
|
 |
|
|
| |
-
Documents -
« Si nous “rendons
grâce”, c'est parce que nous
recevons la grâce », par Mgr
Le Gall
Lecture de Sacrosanctum
Concilium
ROME, Mardi 4 octobre 2005 (ZENIT.org)
– « Si nous “rendons grâce”,
c'est parce que nous
recevons la grâce », a
expliqué Mgr Robert Le Gall,
O.S.B., évêque français de
Mende, lors de la première
congrégation, lundi matin,
en la salle du synode. Mgr
le Gall appuyait son
intervention sur une lecture
de la constitution
conciliaire sur la sainte
liturgie, « Sacrosanctum
concilium ».
Voici l’intervention publiée
par le bulletin de la salle
de presse du Saint-Siège :
« L'Instrumentum laboris
souligne à plusieurs
reprises comment
l'Eucharistie est un don et
un mystère (n. 12, 25, 34,
35, 48, 86) auquel il nous
faut accéder et conduire
avec humilité (n. 51) et
dans un esprit d'adoration
(n. 65). Dans le même sens,
on insiste comme le pape
Jean-Paul II dans Tertio
millenio ineunte sur la
“primauté de la grâce” (n.
31).
eDans ce même esprit, il
faudrait mieux montrer
comment dans l'Eucharistie
Dieu est l'Acteur premier
qui suscite notre agir et le
magnifie. Le numéro 25 va
dans ce sens, mais reste
confus. Il conviendrait de
serrer de plus près
l'enseignement de
Sacrosanctum Concilium dans
le n. 7 qui exprime avec
clarté la théologie de la
liturgie.
« La richesse propre du n. 7
de Sacrosanctum Concilium
est de reprendre la
définition de la liturgie
que proposait le pape Pie
XII dans Mediator Dei en la
complétant: le culte oriente
l'homme vers Dieu grâce à l'Homme-Dieu
qui nous conduit au Père;
c'est la ligne ascendante.
Mais la ligne descendante
(cf. Dies Domini, n. 43),
par laquelle Dieu vient à
nous dans l'Incarnation
rédemptrice, est toujours
première: le Concile
l'appelle la
“sanctification”, tandis que
la ligne ascendante est
justement appelée le culte
intégral exercé par le Corps
mystique tout entier.
« Pour la qualité de nos
célébrations, il importe
beaucoup que soit perçue
clairement cette
articulation dans l'Opus Dei
- le mot revient souvent
dans les premiers numéros de
Sacrosanctum Concilium -
entre l'opus Dei facientis
et l'opus Ecclesiæ, entre ce
que Dieu fait pour nous,
avec nous, et ce que nous
faisons pour lui, avec lui.
C'est bien le sens de la
doxologie de la Prière
Eucharistique, sorte de
sommet de la messe. Il
s'agit d'une clé de toute la
vie spirituelle, où la
primauté de la grâce suscite
le meilleur de notre
liberté. Si nous “rendons
grâce”, c'est parce que nous
recevons la grâce ».
ZF05100410
Je souhaite envoyer cette
information à un ami
TOP
L’Eglise catholique dans
la société française, par
Mgr Ricard
Conférence au Centre Saint
Louis des Français à Rome
ROME, Mardi 4 octobre 2005 (ZENIT.org)
– Nous publions ci-dessous
le texte de la conférence
que Mgr Jean-Pierre Ricard,
archevêque de Bordeaux et
président de la Conférence
des évêques de France a
prononcée ce mardi au Centre
Saint Louis des Français à
Rome.
* * *
Mesdames, Messieurs,
Je me propose de vous parler
ce soir de l’Eglise
catholique dans la société
française, non pas pour en
faire une simple description
mais pour me risquer à faire
un diagnostic sur sa propre
vitalité. Je ne me situerai
ni en sociologue, ni en
historien, ni en politologue
mais en praticien,
c’est-à-dire en pasteur qui
doit analyser la situation,
se donner des lignes
d’action et prendre des
décisions.
L’Eglise catholique a
toujours entretenu des
rapports complexes avec la
société dans laquelle elle
vit. Il y eu des moments où
l’évolution de la société
s’est montrée favorable à
l’appartenance ecclésiale
(cf. L’Eglise de Pologne et
le désir de liberté et de
libération de la société
polonaise) et d’autres
moments où cette évolution a
agi en sens contraire. C’est
le cas de la France
aujourd’hui. L’évolution de
notre société depuis une
quarantaine d’années
représente par beaucoup de
ses aspects un véritable
défi pour l’Eglise.
I -
L’EGLISE AU DEFI
Observons tout d’abord
quelques traits marquants de
l’évolution de la société
française.
Traits marquants de
l’évolution de notre société
française.
Il y aurait beaucoup à dire.
Je ne relève que quelques
traits marquants de cette
évolution :
La crise de 1968 a été
profonde. Au-delà des
événements politiques
eux-mêmes qui ont été
relativement brefs, nous
avons assisté à un
bouleversement culturel
profond. Toute une
génération a été marquée par
la remise en question des
institutions et des
appartenances sociétaires
ainsi que par une
valorisation de l’individu.
Nous assistons aujourd’hui à
une revendication très forte
d’une reconnaissance légale
du droit que pense avoir
chaque individu : droit
d’avoir un enfant comme je
veux et quand je veux ;
droit à la reconnaissance
des unions homosexuelles et
à l’adoption par deux
personnes du même sexe ;
droit à l’enfant. Beaucoup
ne voient pas quelle
considération objective
pourrait remettre en
question cette revendication
subjective de ce qui
apparaît comme un droit.
Cette valorisation de
l’individu a été relayée par
le développement de la
société de consommation
: c’est l’individu qui
ressent des besoins (et si
ce n’est pas le cas, la
publicité lui en crée), qui
choisit, qui achète. L’image
du caddy dans une grande
surface est bien le signe
emblématique qui caractérise
le comportement de beaucoup
dans notre société. Même si
la publicité et la
présentation des produits
nous conditionnent
fortement, nous avons
l’impression d’être libres
et de choisir nous-mêmes.
C’est l’individu qui fait
son marché dans tous les
domaines, y compris dans le
domaine spirituel et
religieux. Un nouveau
produit chasse l’autre :
pourquoi vouloir fixer son
choix sur ce produit une
fois pour toutes ? N’est-ce
pas se priver de tous ceux
qui pourront venir, bien
plus attirants et
performants que celui sur
lequel pourrait se porter
votre choix aujourd’hui ?
Signalons cependant que
cette valorisation de
l’individu s’accompagne
aussi paradoxalement dans
notre société par
l’imposition (en particulier
par les médias) de modes de
pensée et vivre. On se veut
tolérant mais on peut être
féroce envers ceux qui ne se
plient pas à la pensée
unique. Bien des jeunes qui
veulent témoigner de
l’originalité de leur foi en
savent quelque chose.
Les influences de la crise
culturelle de 1968 et de la
société de consommation ont
amplifié un mouvement
beaucoup plus ancien de
sécularisation de notre
société française. Ce
mouvement tend à distendre
les liens de réalités
sociales diverses avec une
appartenance religieuse ou
une influence ecclésiale
(sécularisation des
hôpitaux, des cliniques, des
syndicats, des œuvres de
jeunesse, des maisons de
retraite…) Sa tendance est
de renvoyer les Eglises et
les religions dans le pur
domaine du privé, dans celui
des opinions ou des
convictions personnelles.
Certaines tendances laïques
militantes plaideront pour
une non intervention des
religions ou une non prise
en compte des religions dans
l’espace public. En 1905, la
loi de séparation des
Eglises et de l’Etat avait
consacré la laïcité de
l’Etat. Aujourd’hui,
certains militeraient pour
une laïcité de la société
elle-même. La peur de
l’Islam après les attentats
terroristes et la
dénonciation des
fondamentalismes religieux,
d’où qu’ils viennent, ont
renforcé ces temps derniers
cette tendance.
Répercussions de cette
évolution sur la vie
ecclésiale
Inutile de dire que cette
évolution de notre société
française (mais dont on peut
aussi retrouver certains de
ces traits marquants dans
d’autres pays industrialisés
et en particulier de
l’Europe de l’Ouest) n’a pas
été sans répercussions sur
la vie de l’Eglise
catholique en France. On
peut relever les
conséquences suivantes :
L’affaiblissement d’une
transmission familiale du
patrimoine chrétien. La
crise de transmission des
valeurs qui a touché tous
les milieux et toutes les
familles de pensée (les
milieux « laïques » par
exemple) a été durement
ressentie dans les familles
catholiques. On ne peut plus
dire : les grands-parents
étaient catholiques, les
parents le sont, les enfants
le seront (comme j’ai pu
encore le constater dans
certaines familles
maronites) A partir d’une
même éducation, le choix des
enfants peut être différent,
par rapport à la foi, à
l’appartenance ecclésiale ou
à la demande de sacrements :
mariage religieux ou pas,
mariage civil ou pas,
baptême pour les enfants ou
pas. Tout ceci est ressenti
très fortement par les
différentes générations
familiales. Ceci contribue à
une baisse du nombre des
baptêmes (69%), de 432 701
en 1993 à 385 460 en 2002,
des mariages (132 128 en
1993 à 110 409 en 2002 sur
288 000 mariages civils),
des militants, des
pratiquants.
La baisse de la pratique
dominicale. Elle est
variable suivant
l’implantation des
paroisses. Mais on constate
une baisse des pratiquants.
Les statisticiens
considèrent d’ailleurs
aujourd’hui comme pratiquant
régulier celui qui va au
moins une fois par mois à la
messe. La crise de la
transmission familiale, le
rythme du week-end (où on
est en famille et où on dort
le dimanche matin),
l’approche subjective de la
participation eucharistique
(j’y vais quand j’en ai
envie) et le regroupement
paroissial pour la
célébration dominicale ont
eu pour effet de réduire le
nombre des pratiquants.
La baisse du nombre de
prêtres et des vocations
sacerdotales et religieuses.
Le nombre de prêtres est
passé en France de 30 909 en
1992 à 25 542 en 2002. Et
cette baisse ne rend pas
compte du vieillissement de
ce corps sacerdotal. Si le
nombre d’ordinations est
resté stable pendant ces dix
dernières années (120 en
moyenne par an), le nombre
des séminaristes est passé
1172 en 1994 à 773 en 2003.
On a dit que le pourcentage
des vocations sacerdotales
et religieuses comparé au
nombre des jeunes rencontrés
était resté identique au
cours des années…mais c’est
le nombre de jeunes touchés
par une activité apostolique
qui a fortement baissé. La
difficulté de l’engagement à
vie là aussi se fait sentir.
Le statut du prêtre est
aujourd’hui en France peu
valorisant. De plus les
familles peu nombreuses ont
du mal à penser qu’un appel
pourrait s’adresser à un de
leurs enfants. Les vocations
sont comme les autoroutes.
On en dit le besoin, mais à
condition qu’elles passent
chez les autres. Des jeunes
rentrent plus âgés au
séminaire. Beaucoup ont fait
des études supérieures. On
constate que la plupart des
vocations viennent des
villes, et en particulier
des villes universitaires.
Ce qui est un problème
redoutable pour les diocèses
essentiellement ruraux.
Par contre, le diaconat
permanent progresse
puisqu’il passe de 853
diacres en 1993 à 1850
diacres en 2003.
Beaucoup de jeunes ne
fréquentent pas l’Eglise ou
même sont devenus étrangers
à la foi chrétienne. Ils
manquent cruellement de
culture religieuse. Dans les
collèges et les lycées, les
aumôneries font du bon
travail, mais les effectifs
dans les lycées sont très
faibles. De plus, dans
certains établissements la
création d’une aumônerie a
été refusée par le chef
d’établissement (ou le
conseil d’établissement) par
peur d’avoir à donner la
même autorisation aux
musulmans. C’est l’effet
pervers de la loi sur les
signes religieux : faire de
l’établissement public un
sanctuaire où les religions
n’entrent pas. Dans
l’Enseignement catholique,
l’ouverture à tous les
jeunes, le respect des
opinions de chacun se sont
souvent accompagnés d’une
proposition de la foi
réduite au minimum. La non
motivation de certains
professeurs ou de certains
parents n’a pas contribué à
modifier sensiblement les
données du problème. D’où
l’insatisfaction d’autres
parents dans tel ou tel
établissement. Il y aurait
aussi bien des choses à dire
sur la pastorale étudiante
et la situation des
mouvements apostoliques et
des mouvements éducatifs
(comme les différents
scoutismes par exemple)
L’influence de
l’environnement social sur
les catholiques n’a pas
simplement une dimension
quantitative (en termes de «
baisse ») Elle s’exerce
aussi sur les mentalités.
Les catholiques sont marqués
également par l’évolution de
la société dans laquelle
ils vivent. Ils sont touchés
par la fragilité de la vie
familiale (avec ses divorces
et ses familles recomposées)
Ils sont influencés par la
mentalité ambiante. Certains
se trouvent ainsi en
dissension avec
l’enseignement de l’Eglise,
sur les questions d’éthique
personnelle en particulier.
Je signale en particulier un
trait de la mentalité
actuelle : autrefois, il y
avait la loi et la
casuistique qui permettait
de résoudre des cas
particuliers de conflits de
devoirs. Aujourd’hui, il n’y
a que la loi et le cas
singulier. Pour justifier sa
situation personnelle, on
souhaite tout simplement
changer la loi.
Devant cette situation, on
comprend que des
observateurs du phénomène
religieux ont pu parler de
déclin de l’Eglise
catholique dans notre pays.
Certains chroniqueurs ont vu
dans la prise en compte de
ces phénomènes la mort
annoncée du catholicisme.
Vous ne vous étonnerez pas
si je vous dis que je ne
partage pas cette analyse et
ce diagnostic.
Je pense que l’accueil de
l’Evangile n’est jamais
acquis une fois pour toutes
dans une société et ceci
depuis le début de
l’aventure évangélique. Jean
nous parle de cette crise
qui traverse le groupe
naissant des disciples. Il
écrit : « A partir de ce
moment, beaucoup de ses
disciples s’en allèrent et
cessèrent de marcher avec
lui » (Jn 6, 66) et on
comprend que Jésus pose à
ses proches la question de
confiance : « Voulez-vous
partir, vous aussi ? » (id
v. 67) Et Pierre de répondre
: « A qui irions-nous,
Seigneur ? C’est toi qui as
les paroles de la vie
éternelle. » (v.68) Ce cri
de foi de Pierre est
particulièrement éclairant.
Au cours de son histoire,
l’Eglise n’a pu répondre aux
crises qui la touchaient que
par un sursaut de foi, une
prise au sérieux de l’appel
à la sainteté et une vigueur
missionnaire renouvelée. La
reconstruction de l’Eglise
en France au lendemain de la
Révolution en est un bel
exemple. Je crois que c’est
ce qui nous est demandé de
vivre aujourd’hui. Je pense
d’ailleurs que l’Eglise est,
certes, confrontée à un
terrible défi mais qu’elle
n’est pas sans ressources
pour l’affronter
positivement. Ma conviction
est que l’Eglise qui est
touchée par cette crise vit
aujourd’hui beaucoup plus
une réelle mutation qu’un
lent effritement.
II
– LA RELEVE DETERMINEE ET
SEREINE DE CE DEFI
Devant ce défi, l’Eglise qui
est en France ne baisse pas
les bras. Elle veut
résolument et sereinement le
relever. Elle répond à la
crise qu’elle rencontre par
une évangélisation
renouvelée, par une pratique
du dialogue et par une
réorganisation de ses
structures. C’est ce qu’il
nous faut voir maintenant.
une
évangélisation renouvelée
La Lettre aux catholiques de
France que nous avons
publiée en 1996 a beaucoup
insisté sur la nécessité
aujourd’hui de « proposer la
foi », et de la proposer à
nouveaux frais. Il faut
prendre ces termes non dans
un sens faible (« on a
peut-être un produit qui
vous intéresse…si vous avez
envie, vous pouvez venir
voir ») mais au sens fort :
mettre en contact avec
l’Evangile comme puissance
d’illumination, de
motivation et de
transformation intérieure.
Je trouve cette proposition
de la foi mise en œuvre de
multiples manières dans la
vie de l’Eglise. Citons-en
quelques-unes :
le soutien de l’engagement
des catholiques dans la
prise en charge de la vie
ecclésiale. On peut
constater depuis une
quarantaine d’années un fort
investissement des
catholiques pour prendre en
charge la vie et la mission
des communautés chrétiennes.
Certes la diminution du
nombre de prêtres a été
souvent le facteur
déclanchant de cet
investissement des laïcs
(aujourd’hui un curé seul
pour 15 paroisses…ne peut
plus porter tout seul la
charge curiale, que ce soit
dans la prise en charge des
services, des relais
paroissiaux, de la mission
pastorale elle-même) mais ce
n’est pas la seule
motivation. Il y a la
redécouverte des
responsabilités de la vie
baptismale mais aussi la
nécessité de proposer des
communautés chaleureuses,
priantes, célébrantes,
fraternelles, missionnaires
comme soutien d’une réelle
évangélisation. Certains
catholiques partent sur la
pointe des pieds, vont vers
des Eglises évangéliques en
plein essor ou vers les
sectes par défaut de
fraternité dans certains de
nos lieux d’Eglise. Cette
prise en charge de la vie
ecclésiale se vit aussi bien
dans la présence à la
pastorale des obsèques que
dans l’animation des
aumôneries scolaires,
qu’elles soient dans le
public ou dans le privé.
Une prise de conscience se
fait aussi chez beaucoup de
ces catholiques qu’il y a
une proposition publique de
la foi qui est à faire, une
invitation à lancer, sans
provocation ou prosélytisme
intempestif, mais avec
confiance. Je pense à ce
qu’a représenté la semaine
d’évangélisation de
Toussaint 2004 à Paris. Tout
un travail est encore à
faire sur ce point. Dans nos
méthodes apostoliques, il
faut joindre au levain
enfoui dans la pâte la lampe
qu’on met sur le lampadaire
et qui brille pour toute la
maison.
Le développement de la
formation et le
ressourcement spirituel.
Ces chrétiens engagés, mais
aussi tous ceux qui sont
confrontés aux multiples
questions que pose notre
société à la foi chrétienne
et à l’Eglise, ont une
demande forte de formation.
La réponse à cette demande
peut revêtir différentes
formes : catéchèse
d’adultes, formation plus
théologique ou de type
universitaire, formation
plus spécifiée à des tâches
ecclésiales. Dans la plupart
des diocèses ont été mis en
place des centres ou des
instituts de formation. On
constate que cette demande
de formation, loin de se
tarir, va en s’amplifiant.
Mais à côté de cette demande
de formation, on a vu
apparaître plus récemment un
besoin de ressourcement
spirituel, d’accompagnement
spirituel. On se rencontre
qu’il s’agit moins de se
noyer dans le faire mais de
grandir dans l’existence
spirituelle. Ceci me paraît
être d’ailleurs une réponse
non narcissique au besoin
d’épanouissement personnel
de l’individu, à son besoin
de parler, de se confier, de
discerner les chemins par
lesquels une fidélité au
Christ et à l’Evangile lui
demande de passer. Je suis
frappé de voir comment les
mouvements de jeunes
intègrent cette nécessité de
répondre à ce besoin
d’accompagnement spirituel
demandé par des jeunes. Mais
citons aussi dans ce domaine
du ressourcement spirituel
l’importance des
récollections (paroissiales,
de catéchistes, d’animateurs
pastoraux), des retraites
(par ex. celles proposées
par la Communauté de
l’Emmanuel l’été à
Paray-le-Monial), des
pèlerinages (comme occasion
de conversion ou de
renouvellement spirituel) et
de la fréquentation de
grands sanctuaires.
l’engagement dans une
pastorale des jeunes
renouvelée. On constate
dans tous les diocèses un
réel engagement pour
soutenir une pastorale des
jeunes. Certes, le défi est
grand – je l’ai dit plus
haut- mais il veut être
relevé, même si les
résultats en cette matière
restent numériquement
modestes. 85 évêques
français ont participé aux
Journées mondiales de la
Jeunesse et plus de 65 ont
souhaité être présents la
première semaine avec leur
délégation de jeunes dans
les diocèses allemands
d’accueil. On sent un
certain nombre de jeunes
aujourd’hui plus loin de
l’Eglise, moins familiers du
langage et des mœurs de la
tribu, mais aussi moins
critiques, plus disposés à
écouter une parole, à
condition que celle-ci
éveille quelque chose en
eux. Beaucoup de jeunes ont
une attente spirituelle, se
posent des questions sur
leur vie. Ils ont besoin de
points de repère, d’une
parole qui déploie une
intelligence et une
cohérence de la foi
chrétienne. Les évêques ont
été frappés de la qualité
d’écoute des jeunes pour les
catéchèses dans le cadre des
JMJ. On se rend compte que
pour vivre en chrétiens dans
une société sécularisée, il
est important de proposer à
des jeunes un enracinement
ecclésial, une nourriture
spirituelle et un
accompagnement personnel,
une formation chrétienne
solide et l’apprentissage à
savoir rendre compte de sa
foi. Je constate que le choc
que représente la rencontre
avec des jeunes musulmans
convaincus, sûrs et fiers de
leur foi, peut provoquer un
déclic bénéfique chez un
certain nombre de jeunes
catholiques.
Le développement d’une
pastorale de l’initiation.
On se rend compte que nous
sommes de plus en plus dans
une situation de première
évangélisation. Des jeunes,
des enfants, des adultes
arrivent dans des groupes
ecclésiaux sans aucun éveil
préalable à la foi.
Il n’y a plus chez un
certain nombre d’enfants la
première sensibilisation qui
se faisait dans le cadre des
familles (par la grand-mère
souvent) La catéchèse doit
se penser aujourd’hui dans
une dynamique missionnaire :
comment contacter des
familles ? Faire la
promotion du catéchisme ?
Accueillir des enfants qui
n’ont eu aucune première
approche de la vie
chrétienne ? Comment les
faire entrer dans les
différentes dimensions de
cette vie : expérience
ecclésiale, écoute de la
Parole, initiation à la
prière et la vie
eucharistique, apprentissage
de la conversion à laquelle
appelle l’Evangile ? Comment
animer une catéchèse avec
ces enfants (qui arrivent
d’ailleurs à différents
moments de leur parcours
scolaire) mais aussi avec
des enfants qui ont déjà
reçu, en particulier dans le
cadre de leur famille, toute
une formation ? Comment
éviter de leur donner, sous
prétexte d’initiation une
formation allégée, voire
nettement insuffisante ?
Voici des questions sur
lesquelles nous
réfléchissons et sur
lesquelles nous allons
poursuivre notre réflexion
lors de notre prochaine
assemblée plénière à Lourdes
en novembre prochain.
Mais il n’y a pas que les
enfants ou les jeunes qui
frappent à la porte. Il a
aussi des adultes qui
souhaitent se remettre en
route sur le chemin de la
foi, à cause d’une
interrogation personnelle,
d’un événement qui les a
fait réfléchir, de
l’éducation religieuse de
leurs enfants. Comment les
différentes communautés
chrétiennes vivent leur
propre responsabilité
d’accueil et
d’accompagnement dans la foi
? Celles-ci ont aussi une
responsabilité
d’engendrement dans la foi.
Nous travaillons comme
évêques à cette prise de
conscience si nécessaire.
Il est important de noter
aussi l’augmentation du
nombre de catéchumènes, du
nombre d’enfants ou de
jeunes qui demandent le
baptême en âge scolaire mais
aussi du nombre de jeunes
adultes qui demandent le
baptême, souvent après être
passés par des itinéraires
très compliqués Quel moment
fort pour un évêque que
celui de la rencontre avec
ces catéchumènes lors de
l’appel décisif !
accueillir l’aiguillon
des communautés nouvelles.
Les communautés
nouvelles sont dans nos
Eglises diocésaines une
source de dynamisme
communautaire, de vitalité
spirituelle et d’élan
d’évangélisation. Elles
invitent à ne pas rester au
sein de nos groupes
ecclésiaux mais à risquer à
l’extérieur une annonce
explicite du message
évangélique. Leur
intégration dans la vie des
diocèses se fait bien mieux
qu’il y a quelques années.
Si leurs relations sont
bonnes avec les autres
composantes de l’Eglise
diocésaine, elles peuvent
être un aiguillon précieux
pour l’ensemble de la vie du
diocèse. Il faut cependant
remarquer qu’un certain
nombre de ces communautés
ont une implantation urbaine
et que des zones rurales (ou
des diocèses ruraux) sont
moins touchées par elles.
Le
courage d’une parole et une
pratique du dialogue
Les catholiques en France
doivent résister à deux
tentations qui sont
exprimées dans l’Eglise par
deux courants antagonistes :
celle de la forteresse
assiégée où l’Eglise est
surtout occupée à se
défendre et oublie qu’elle
est porteuse d’un message
pour tous et celle de
l’alignement sur la
mentalité actuelle. Dans ce
dernier cas, on tolère mal
une Eglise qui ne pense pas
comme tout le monde. L’Eglise,
dit-on, si elle ne veut pas
se marginaliser, doit se
convertir à la modernité
(supprimer le célibat des
prêtres, se taire sur les
questions d’éthique
sexuelle, celles-ci étant
vues comme appartenant au
domaine de la vie privée,
uniquement régi par la
conscience individuelle,
revenir à un évangile
délesté, pense-t-on de son
armature dogmatique cf. Le
livre sur Marie de Jacques
Duquesne) Ce courant oublie
que la mentalité moderne
n’est pas la norme de la foi
mais que celle-ci se trouve
dans l’Evangile lu à la
lumière de toute
l’expérience ecclésiale.
Dans une société sécularisée
et pluraliste, il est
important de parler, à
la fois pour témoigner de
cette foi qui nous fait
vivre mais aussi pour
partager la conception de
l’homme qui nous habite, une
conception qui n’est pas une
position strictement
confessionnelle mais qui
peut être partagée avec
d’autres qui ne sont pas
forcément catholiques ou
croyants. Il nous faut
parler « à temps et à contre
temps » comme le dit saint
Paul, en faisant attention à
ne pas nous réfugier
paresseusement dans le
contretemps pour justifier
une non écoute ou un manque
de communication avec les
hommes de notre temps.
Cela nous invite à inscrire
notre parole dans une
pratique de dialogue et
de compagnonnage. Il y a le
dialogue quotidien dans les
multiples engagements que
l’on peut avoir. Les
enquêtes mettent rarement en
valeur un fait pourtant
marquant : le nombre
important de catholiques
engagés dans des domaines
très divers (éducatif,
social, professionnel,
politique, présence dans des
cités difficiles), mais
aussi dans la vie
associative (organisations
de quartiers ; organismes de
solidarité ou de secours ;
aide et présence au
Tiers-monde..)
Ce dialogue se vit avec les
autres Eglises chrétiennes
(je pourrais être témoin du
travail qui se fait dans le
Conseil d’Eglises
chrétiennes en France), avec
le Judaïsme et les
organisations juives. Nous
sommes redevables sur ce
point à tout ce qui a été
fait par le Cal Decourtray,
le Cal Etchegaray et le Cal
Lustiger et par bien des
acteurs de l’ombre. Depuis 2
ans, nous avons pris
l’initiative de colloques
avec le Congrès juif mondial
et des rabbins (en
particulier des universités
juives orthodoxes) à New
York. Mais il a aussi ce qui
se fait en France avec le
CRIF. Nous sommes en
relation avec le monde de
l’Islam mais la difficulté
d’avoir des partenaires à
l’autorité reconnue rend
plus difficiles (je ne dis
pas impossible) des contacts
réguliers.
Nous vivons aussi un
dialogue régulier avec les
pouvoirs publics dans le
respect d’une laïcité bien
comprise : à savoir la
reconnaissance de la non
confessionnalité de l’état
et de sa neutralité
religieuse. Autonomie,
neutralité ne veulent
cependant pas dire ignorance
ou manque de relations. Il
est de la responsabilité de
l’Etat d’assurer la liberté
de conscience et de garantir
le libre exercice des
cultes. Il doit veiller à ce
que chaque Eglise ou
religion puisse exercer ses
activités non seulement dans
la sphère privée des
consciences mais aussi dans
l’espace public comme
organisation. Nous sommes
reconnaissants à l’Etat
d’avoir mis en place, depuis
février 2002, une instance
officielle de dialogue avec
l’Eglise catholique.
Une
réorganisation ecclésiale
nécessaire
Pour faire face aux
conséquences des évolutions
de notre société sur notre
vie ecclésiale l’Eglise en
France a souhaité revoir son
propre fonctionnement
institutionnel.
Au niveau des diocèses,
on a vu dans la plupart
d’entre eux se mettre en
place une réforme des
paroisses face à
l’émiettement de la vie
paroissiale ou des
célébrations eucharistiques.
On a rassemblé des
paroisses, non pas
simplement pour modifier une
carte géographique qui tient
compte de la diminution du
nombre de prêtres, mais pour
aider à ce que se créent de
véritables communautés, avec
des services divers qui
doivent permettre une
certaine qualité et plus de
tonus à la vie paroissiale.
On assiste aujourd’hui à une
mutation, c’est le
quadrillage territorial qui
semble disparaître au profit
de pôles vivants de vie
ecclésiale.
Au niveau de la
Conférence des Evêques de
France, on a souhaité
travailler en provinces
ecclésiastiques. Celles-ci
ont succédé aux régions
apostoliques. Celles-ci
étaient neuf, les provinces
quinze. Elles sont plus
petites. Le but de la
réforme entreprise est non
seulement de permettre un
échange entre évêques mais
aussi de rendre possible une
entraide entre diocèses, des
collaborations communes, des
prises en charge
interdiocésaines. Il faut
noter que dans les années
qui viennent certains
diocèses n’auront sans doute
plus les forces apostoliques
nécessaires (prêtres et
laïcs) pour fonctionner de
façon purement autonome.
La réforme de la conférence
a contribué à doubler
l’assemblée plénière, en
Novembre et en avril. Les
évêques ont souhaité se
retrouver tous plus souvent
pour réfléchir ensemble sur
tous les défis qui se posent
à eux aujourd’hui – et dont
j’ai esquissé une rapide
présentation- et avoir une
méthode de travail plus
réactive pour aborder plus
rapidement des questions de
fond qui se posent à
l’Eglise aujourd’hui.
Il est temps de conclure. On
me pose souvent la question
: n’êtes-vous pas angoissé
devant l’avenir ? Je réponds
: non, je suis soucieux mais
pas angoissé. Je suis
soucieux en pensant à
l’équilibre nécessaire à
sauvegarder pour les laïcs
entre leur engagement
ecclésial et leurs
responsabilités dans le
monde, aux vocations
sacerdotales et religieuses,
à l’investissement des
chrétiens dans le domaine de
la culture, à l’équilibre de
vie et de ministère des
prêtres, à la possibilité de
survie de certains diocèses
dans les années qui
viennent, à ce que peut
entraîner comme
déséquilibres dans nos
sociétés le terrorisme
international.
Mais je ne suis pas
angoissé. Je suis habité par
l’expérience forte de
l’Evangile. Celle-ci est
au-delà des chiffres et des
stratégies. Elle est
toujours une expérience
neuve pour celui qui la vit.
Le Christ vient nous dire :
tu es aimé, tu es unique aux
yeux de Dieu. Laisse-toi
aimer. Si tu accueilles cet
amour, tu feras l’expérience
d’une transformation
intérieure, d’une lumière,
d’une flamme, d’un souffle,
d’une source d’eau vive au
cœur de ta propre vie. Et si
tu es aimé, tu es appelé à
ton tour à aimer. Prends
cette route de l’amour. Tu
feras l’expérience qu’elle
te conduira à la vie, à la
vraie vie, à celle qui ne
déçoit pas.
Je crois que cette Bonne
Nouvelle est aujourd’hui
beaucoup plus actuelle et
attendue qu’on ne croit.
† Jean-Pierre RICARD
Archevêque de Bordeaux
Président de la Conférence
Des Evêques de France
ZF05100411
Je souhaite envoyer cette
information à un ami
TOP
-
Documents web -
Interventions des pères
du synode lundi après-midi
ROME, Mardi 4 octobre 2005 (ZENIT.org)
– Il est possible de
consulter les résumés des
interventions des pères du
synode de lundi après-midi,
dans la section
Documents de la page web
de Zenit.
ZF05100412
Je souhaite envoyer cette
information à un ami
TOP
----------------------------------------
Pour offrir un abonnement à
Zenit, en cadeau, cliquez
sur :
http://www.zenit.org/french/cadeau.html
----------------------------------------
|
|
|
|